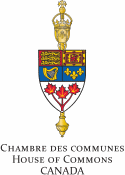:
Merci, madame la présidente.
[Français]
Je vous remercie de m'avoir invitée à m'adresser à vous cet après-midi.
Les agressions sexuelles au Canada sont une question qui me préoccupe énormément. J'espère que notre gouvernement va profiter de la présente occasion pour améliorer la vie des femmes.
[Traduction]
Étant donné que vous avez reçu mon mémoire, je vais aller droit au but et parler de ce que je considère comme le problème fondamental des réactions à la violence sexuelle, tant sur les campus qu'ailleurs, car les campus sont un miroir de la société en général. J'ai plusieurs autres idées à présenter sur la façon dont on pourrait régler ces problèmes.
Le principal problème est la reconnaissance de la violence sexuelle en tant que fait social. Au centre de mes recherches sur la violence sexuelle et la violence familiale — qui se recoupent fréquemment, même sur les campus —, il y a le fait qu'on maintienne que la violence sexuelle n'est que l'apanage de quelques indésirables plutôt qu'un phénomène culturel.
Certains choisiront peut-être d'appeler cela la « culture du viol ». Je n'ai pas vraiment d'opinion à ce sujet. On peut utiliser cette expression si cela revêt un certain sens et que c'est utile, mais je reconnais également que cette expression a acquis un poids politique considérable et que cet enjeu est devenu un véritable champ de bataille. Je vais donc parler de violence sexuelle en tant que fait social, en soulignant toutefois que le terme qu'on emploie est beaucoup moins important que de reconnaître son existence.
La reconnaissance de la violence sexuelle en tant que fait social ne signifie pas que tous les hommes sont des violeurs. Je ne saurai jamais trop insister là-dessus. Une telle reconnaissance signifie plutôt que nous admettons vivre dans une société qui, d'une part, jette la honte et le blâme sur les victimes et refuse de reconnaître la violence sexuelle qu'elles ont subie et qui, d'autre part, cautionne tacitement ou explicitement — et encourage, dans certains cas — la violence sexuelle.
Reconnaître que nous vivons actuellement dans une culture où règne la violence sexuelle ne diffère en rien de la reconnaissance, dans le passé, d'autres maux sociaux comme le racisme et l'homophobie. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que le racisme et l'homophobie systémiques et manifestes ont été et sont toujours des caractéristiques malheureuses de notre société. Admettre et dénoncer ces problèmes nous a permis et nous permet toujours de prendre des mesures, sur les plans législatif, social et systémique, pour les régler. Toutefois, tant que nous n'aurons pas pleinement reconnu l'existence du problème, nous ne pourrons pas faire grand-chose pour le régler et pour améliorer considérablement la vie des femmes et des jeunes filles.
Sur les campus, la violence sexuelle est une réalité. Elle fait partie intégrante des activités des semaines d'initiation et des initiations des confréries d'étudiants et des ligues universitaires, et même, malheureusement, du discours public de certains dirigeants d'universités. Les survivantes d'actes de violence sexuelle, et les femmes en général, sont les plus touchées par la culture de violence sexuelle. Elles ont de la difficulté à accéder aux services. Leurs plaintes, le cas échéant, sont accueillies avec scepticisme ou rejetées et, presque invariablement, les résultats des mécanismes officiels de signalement leur donnent l'impression d'être sans protection et d'être réduites au silence.
Toutes ces choses exigent des universités un sens de l'éthique rigoureux à l'égard d'une approche institutionnelle de gestion des risques. L'université — n'importe quelle université — n'a pas avantage à tenir un registre précis des cas de violences sexuelles, à encourager les survivantes à signaler les incidents ou à mettre en oeuvre une stratégie dynamique de prévention de la violence sexuelle, qui est à mon avis la tâche la plus importante. Pour une université, faire n'importe laquelle de ces choses voire toutes ces choses serait admettre que la violence sexuelle sur son campus et sa communauté est une réalité. Les dirigeants d'université sont réticents à admettre que leurs campus sont ce qu'on appelle des « campus du viol ». J'utilise cette expression entre guillemets, car c'est celle qu'utilise le mouvement étudiant pour souligner la gravité des problèmes observés sur les campus. Le risque d'être tenu responsable est plus faible lorsque le problème n'existe pas. C'est donc sans surprise que nous avons constaté, dans nos recherches, que les universités avaient l'habitude de nier l'existence de problèmes de violence sexuelle sur leurs campus, même lorsque les étudiants et les survivants nous disaient exactement le contraire.
Maintenant que le problème est établi, que pouvons-nous faire? Je dirais que dans mon monde idéal, nous serions capables d'admettre que la violence sexuelle est un aspect culturel de notre société qui se manifeste sur les campus. Nous avons cerné le problème; que peut-on faire pour le régler? Comment peut-on le régler?
Il n'y a pas de solution magique, évidemment, mais puisque j'ai l'attention de certains des décideurs les plus influents au pays, du moins pour les six prochaines minutes, environ, permettez-moi de m'inspirer des travaux de ce Comité et de faire quelques suggestions. Je m'intéresse particulièrement à l'attention que vous avez accordée à un plan d'action national axé sur la prévention, la continuité des soins et les mécanismes de signalement sûrs.
Comme vous le savez tous, la violence sexuelle n'est pas seulement un enjeu d'ordre criminel. Elle a une incidence sur l'accès à l'éducation et à la santé. Il s'agit essentiellement d'une question de droits de la personne et, dans le contexte de la violence sexuelle, cela signifie que c'est une question d'égalité entre les sexes.
La violence sexuelle porte atteinte aux droits de la personne des femmes au Canada. Si le Canada veut véritablement devenir une société fondée sur l'égalité des sexes, nous devons agir maintenant pour lutter contre la violence fondée sur le sexe.
Le gouvernement fédéral pourrait jouer le rôle de chef de file et collaborer avec les provinces à l'élaboration d'une stratégie nationale destinée aux collèges et aux universités favorisant l'adoption d'initiatives de prévention efficaces, principalement à l'aide d'une sensibilisation continue. C'est un facteur clé de la lutte contre la violence sexuelle. C'est ce que nous avons fait pour le racisme et l'homophobie; les gens ont appris que ce n'était pas acceptable. Cela a fait du Canada un pays transformé, et je dirais même un pays meilleur. En fait, le Canada est devenu un chef de file à l'échelle mondiale.
Après un incident de violences sexuelles, les survivantes ont besoin de soins. Je sais que les gouvernements et les institutions se concentrent sur les chiffres et insistent sur l'élaboration de cadres favorisant la production de rapports précis. J'en comprends la nécessité, mais d'un point de vue axé sur les survivantes, il faut savoir que souvent, les survivantes portent peu d'intérêt aux rapports; elles veulent plutôt des services. Elles ont besoin de soins de santé, de mesures d'adaptation liée aux études, qu'on assure la sécurité sur les campus, mais surtout, elles veulent être crues. Encore une fois, le gouvernement fédéral pourrait jouer un rôle essentiel à cet égard, non seulement en offrant du financement, mais aussi en veillant à l'établissement de normes nationales pour les soins de base offerts aux victimes, partout au pays.
Nous voulons que les survivantes signalent les incidents, il faut des mécanismes de signalement qui protègent les survivantes et qui sont adaptés à leurs besoins. Les services de police et les services des poursuites empêchent régulièrement les survivantes d'obtenir une décision et encore moins une occasion véritable d'obtenir une déclaration de culpabilité, étant donné la jurisprudence actuelle. Les survivantes qui se manifestent doivent constamment répéter leur histoire. Leur crédibilité est remise en question; on les qualifie de « menteuses » ou de « salopes ». On remet en question leur personnalité et leurs comportements antérieurs, y compris leur sexualité. Elles doivent subir tout cela dans le but d'obtenir une très improbable déclaration de culpabilité. Dans les affaires de violence sexuelle, le seuil du doute raisonnable est très difficile à atteindre, parce que la plupart des agressions sexuelles ont lieu en privé, sans témoins. Cela est devenu encore plus difficile dans ce que nous appelons maintenant l'« ère post-Ghomeshi », une ère où il est très difficile de trouver des survivantes prêtes à se lancer dans un processus pénal.
Il en va de même pour les mécanismes de signalement interne des universités et des collèges. Ce sont des processus fragmentaires pour lesquels on a fréquemment recours à des ordonnances de non-divulgation qui interdisent aux survivantes de discuter de leur dossier avec quiconque, sauf conformément au principe du besoin de savoir, un principe mal défini. Beaucoup de survivantes interprètent cette ordonnance comme une menace qui les empêche d'obtenir de l'aide, des conseils ou encore des services de consultation et de défense des droits.
Outre la réforme du droit, qui relève du gouvernement fédéral, un plan d'action national pourrait inclure la participation des provinces afin qu'elles aient des mécanismes de signalement et d'enquête uniformes adaptés aux besoins des survivantes. On n'entend pas par là une non-application régulière de la loi; cela signifie que nous pouvons mettre en oeuvre des processus de signalement et d'enquête plus conviviaux pour les victimes. L'enjeu de la violence fondée sur le sexe devrait être et doit être une priorité absolue pour la , la et la .
En fait, toutes ces mesures seraient vaines sans une surveillance et une transparence adéquates. Pour revenir au commentaire que j'ai fait plus tôt concernant la gestion des risques au sein des universités, les universités et les collèges doivent avoir des organismes de surveillance chargés non seulement de l'examen des cas signalés, mais aussi de la prestation des services et des stratégies de prévention sur les campus. Le gouvernement fédéral pourrait encore une fois jouer un rôle de chef de file pour la mise en oeuvre de mécanismes de surveillance uniformes, ce qui permettrait d'exiger que les universités qui ne respectent pas les normes nationales rendent des comptes. Je pense qu'on pourrait mettre la barre très haute.
L'initiative « Des villes sûres » proposée par les Nations unies pourrait être un bon point de départ. Le gouvernement actuel pourrait-il s'inspirer des initiatives des Nations unies pour mettre en oeuvre une stratégie sur des campus sûrs? On pourrait d'abord mener des projets pilotes dans des campus précis qui ciblent des initiatives novatrices en matière de sécurité, comme les services de signalement anonyme et la sensibilisation obligatoire et continue sur la culture du viol. On pourrait adopter des politiques qui obligent les intimés et non les survivantes à adapter leurs horaires de travail et de cours pour faire des campus des endroits plus sûrs pour les femmes, car dans le cadre de mes recherches, les survivantes ont indiqué avoir été obligées de quitter les résidences étudiantes, d'abandonner les cours, de refuser des emplois et même de mettre fin à leurs études universitaires pour assurer leur sécurité.
Je suis consciente que nous n'en sommes qu'au début d'une discussion que j'espère réfléchie et continue sur la façon dont le Canada peut incarner le principe de l'égalité entre les sexes en s'attaquant à son principal obstacle, la violence fondée sur le sexe.
Évidemment, en tant qu'universitaire, j'ai beaucoup d'autres choses à dire à ce sujet de même que sur l'enjeu de l'application de la loi des cas de violence familiale. Je pourrais continuer pendant des heures, mais, comme je l'ai indiqué, je pense que nous devons discuter. Donc, pour pouvoir en arriver là, je vais arrêter de parler. Je suis prête à répondre à toutes vos questions.
[Français]
Je vous remercie toutes et tous de votre attention.
:
Merci, madame la présidente. Bonjour à toutes et à tous.
[Traduction]
Madame la présidente, je vous remercie, vous et les membres du Comité permanent de la condition féminine, de me donner l'occasion de vous parler de l'enjeu de la violence envers les jeunes femmes et filles au Canada, en particulier la violence sur les campus.
Nous félicitons le Comité de se pencher sur cette question à la fois cruciale et d'actualité. Le discours actuel, en particulier au cours de la dernière semaine, témoigne de l'urgence d'agir à cet égard et de la nécessité de lutter contre les comportements et les attitudes misogynes et sexistes qui nuisent à la capacité des filles et femmes de mener une vie satisfaisante et épanouissante. Il s'agit d'une occasion que nous ne pouvons absolument pas nous permettre de rater.
En guise de contexte, la Fondation canadienne des femmes est une fondation publique nationale dédiée à l'amélioration de la vie des femmes et des filles. Notre action est axée sur trois aspects fondamentaux: mettre fin à la violence, éliminer la pauvreté et habiliter les femmes et les filles. Nous militons à l'échelle nationale pour l'adoption de stratégies et de politiques qui contribuent à l'égalité entre les sexes au Canada.
Au cours des 25 dernières années, nous avons investi dans 1 400 collectivités et aidé 250 000 personnes. Nos programmes sont axés sur la prévention de la violence, l'établissement de relations saines chez les adolescents, l'habilitation des femmes et des filles, le mentorat, l'expérience de travail, l'élimination de la pauvreté et le renforcement des capacités.
Notre vision, c'est que toutes les femmes au Canada puissent vivre à l'abri de la violence. Nous aidons les femmes du Canada à se sortir de la violence en finançant des refuges d'urgence et en offrant des programmes de prévention. Nous investissons aussi dans des programmes mixtes de prévention de la violence offerts en milieu scolaire pour inciter les filles, les garçons et les gens de tous genres à mettre fin à la violence. Nous sommes conscients que les investissements dans de tels programmes permettent d'améliorer le bien-être des femmes, leurs perspectives économiques et leurs conditions sociales, comme nous comprenons, à l'inverse, que l'inaction à cet égard, en particulier en ce qui concerne la violence, a des répercussions sur les plans personnel, social et économique.
Voici quelques faits sur la violence faite aux femmes au Canada.
La moitié des femmes au Canada ont été victimes d'au moins un acte de violence physique ou sexuelle. Soixante-sept pour cent des Canadiens connaissent une personne qui a déjà été victime de violence physique ou sexuelle. L'agression sexuelle est un crime fondé sur le sexe. Plus de 93 % des victimes adultes d'agressions sexuelles sont des femmes, et 97 % des agresseurs accusés sont des hommes. Les femmes de 18 à 24 ans sont celles qui subissent les plus hauts taux de violence sexuelle.
La grande majorité des agressions sexuelles n'est toujours pas signalée à la police. Dans un sondage, la raison la plus souvent invoquée par les femmes pour expliquer pourquoi elles n'avaient pas signalé une agression sexuelle était qu'elles se sentaient jeunes et impuissantes. Parmi les répondantes, 40 % ont indiqué qu'elles s'étaient tues parce qu'elles avaient honte, et 29 % se disaient elles-mêmes responsables.
Dans le même sondage, 71 % des survivantes qui ont signalé une agression sexuelle à la police ont indiqué avoir eu une expérience négative. Nous avons constaté que l'agression sexuelle est le seul crime violent au Canada qui n'est pas en déclin, et qu'en 2014, le risque de victimisation avec violence chez les femmes était de 20 % plus élevé que chez les hommes.
Il est intéressant de regarder à quels endroits on constate une baisse des taux de violence familiale déclarés par les services policiers. Cette baisse peut être attribuée à des facteurs atténuants, notamment l'indépendance financière, qui permet aux femmes de se libérer d'une relation violente tôt dans la relation, et les efforts soutenus de lutte contre la violence familiale menés par les organisations de femmes à l'échelle communautaire.
Si on compare la violence sexuelle et la violence familiale, on constate également qu'au Canada, les services d'intervention liés à la violence familiale — qu'on parle des systèmes policiers et judiciaires, de la coordination des services communautaires, de la disponibilité des refuges, etc. — sont beaucoup plus nombreux que les services liés à la violence sexuelle.
Ces indicateurs témoignent des besoins considérablement plus grands en matière de coordination à l'échelle communautaire pour modifier les attitudes et les comportements, et améliorer les interventions des institutions dans les cas de violence sexuelle.
Nous savons que l'apprentissage du cycle de la violence se fait tôt dans la vie. Les recherches indiquent que plus les enfants sont sensibilisés jeunes à l'importance des relations saines, plus les effets sont durables. Au cours des 15 dernières années, la fondation a concentré ses ressources sur des programmes de sensibilisation aux relations saines destinés aux adolescents. Les éducateurs considèrent que de tels programmes sont très utiles pour préparer des jeunes de 11,12 et 13 ans aux relations intimes avant qu'ils commencent à avoir des relations amoureuses.
Ces projets permettent aux adolescents d'acquérir des compétences, de reconnaître les signes avant-coureurs d'une relation malsaine et les comportements favorisant les relations saines, et de connaître les ressources d'aide qui leur sont offertes. Ce sont des programmes continus dont la prestation se fait en classe, sous forme de discussions et de jeux de rôle. Il y a également des cahiers qui peuvent être consultés en dehors des heures de classe. Tout cela est facilité par les enseignants, les membres de la communauté et les jeunes.
La participation des jeunes et des pairs contribue grandement à leur réussite. La recherche montre également qu'une participation significative des jeunes à la conception du programme contribue à la mise en place de services plus pertinents et plus efficaces et donne aux jeunes l'occasion d'acquérir des compétences,de se prendre en charge et de faire preuve de leadership. Elle les aide aussi à établir des liens sains.
Le programme est aussi conçu pour inclure les garçons à titre de leaders et les faire participer aux conversations et aux activités qui déconstruisent les rapports de pouvoir comme la race, la classe sociale, le sexe et le privilège en général. Il ne blâme pas les hommes et les garçons pour la violence. Dans l'enquête auprès des participants, 90 % des étudiants ont dit que les programmes les avaient aidés à entretenir des relations saines même après avoir terminé l'école et plus de 60 % ont dit que les programmes avaient eu une incidence sur leur choix de partenaires et les avaient aidés à se sortir d'une relation malsaine.
Nous croyons que le programme pour des relations saines destiné aux adolescents devrait être offert dans les écoles secondaires du Canada et qu'il serait utile pour l'élaboration des programmes de prévention sur les campus. L'intervention précoce souligne l'importance de parler des relations saines et égalitaires avec les jeunes avant leur entrée au collège ou à l'université; elle peut prévenir la violence sur les campus.
Comme nous le savons, la violence sur les campus se passe dans un contexte empreint d'idées conçues sur le blâme des victimes d'agression sexuelle, la normalisation des comportements sexistes, les comportements institutionnels, l'ignorance des lois sur le consentement, la piètre qualité des programmes de prévention et l'absence de mécanismes d'intervention en cas d'agression sexuelle.
Au cours des dernières années, les médias ont souligné l'absence d'approches proactives uniformes. En 2014, la fondation a fait une analyse sommaire de sept universités du Canada et a trouvé un ensemble disparate de procédures d'intervention en cas de violence sexuelle.
Notre travail nous a permis de déterminer que quatre étudiants universitaires de premier cycle sur cinq avaient été victimes de violence dans une relation amoureuse. Deux statistiques sont souvent utilisées, et sont très troublantes: un étudiant de sexe masculin sur cinq est d'avis qu'une relation sexuelle forcée est acceptable si l'on paie la sortie, si l'on a consommé de l'alcool ou de la drogue, ou si l'on fréquente une personne depuis longtemps; de plus, 60 % des hommes d'âge collégial ont dit qu'ils commettraient des agressions sexuelles s'ils étaient certains de ne pas se faire prendre.
La Fondation canadienne des femmes a aussi réalisé des sondages. Nous voulions savoir comment les femmes qui avaient été victimes d'agression sexuelle étaient perçues dans la collectivité; nous avons donc demandé aux répondants s'ils croyaient que les victimes étaient responsables de leur agression sexuelle. Notre sondage a révélé que 19 % des répondants croyaient que les femmes avaient peut-être provoqué ou encouragé l'agression sexuelle si elles avaient bu; en isolant le groupe des 18 à 34 ans, ce taux passe à 25 %.
Une enquête plus récente sur le consentement a révélé que bien que 96 % des gens croyaient que l'activité sexuelle entre les partenaires devait être consensuelle, les deux tiers des Canadiens ne comprenaient pas que cela signifiait une activité continue, positive et enthousiaste.
L'enquête a également révélé que nombre des jeunes Canadiens comprenaient mal l'idée du consentement lorsqu'il est question de technologie. Près d'un jeune sur cinq âgé de 18 à 34 ans — soit 21 % — croyait que si une femme envoyait un message texte à caractère sexuel, elle invitait son destinataire à prendre part à une activité sexuelle hors ligne.
Comme le montrent ces deux enquêtes, il faut créer et intégrer sur les campus des programmes qui visent à responsabiliser les jeunes, à leur apprendre leurs droits et par-dessus tout à développer une culture et un climat de consentement. Il faut donc une compréhension claire à l'égard du consentement sexuel et de la violence sexuelle en vertu du Code criminel du Canada.
Nous savons qu'une des façons de lutter contre les agressions sexuelles sur les campus consiste à favoriser l'établissement de politiques distinctes sur les agressions sexuelles. À l'heure actuelle au Canada, 24 collèges et universités sur 100 sont dotés de politiques distinctes qui reconnaissent que l'agression sexuelle diffère des autres types d'inconduite et qui énoncent des procédures précises pour le traitement des plaintes.
Le projet de loi 132 de l'Ontario comprend une disposition conditionnelle obligeant tous les collèges, universités et collèges d'enseignement professionnel publics et privés à se doter d'une politique distincte sur la violence sexuelle d'ici janvier 2017. Le projet de loi les oblige également à revoir leurs politiques tous les trois ans et à faire participer les étudiants au processus. Le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique y songent également; mais les politiques ne suffisent pas.
Comme l'a dit ma collègue dans son exposé, nous savons qu'il faut beaucoup plus de programmes adaptés qui traitent directement des besoins des victimes et qui offrent des solutions axées sur les victimes. Il faut que les victimes puissent participer à la création des politiques et des protocoles qui émanent des politiques distinctes, donc ce ne sont pas seulement les jeunes...
:
Merci à vous tous d'avoir invité METRAC à parler des questions de sécurité sur les campus. Nous savons que les campus d'enseignement postsecondaire du pays sont des lieux très dangereux pour les femmes de toutes origines et pour les personnes de genre non conforme.
Les recherches menées en Amérique du Nord indiquent qu'entre 15 et 25 % des femmes en âge de fréquenter le collège ou l'université vivront une forme ou une autre d'agression sexuelle pendant leurs études. METRAC Action on Violence travaille depuis plus de 30 ans sur les campus à faire en sorte que les institutions soient sûres pour tous et porte une attention particulière aux personnes et aux groupes qui risquent le plus de subir de la violence.
Aujourd'hui, je vais résumer le mémoire de METRAC qui a été soumis le 23 septembre en me concentrant sur trois enjeux: la culture du viol, la pauvreté sur les campus canadiens et la hausse de la traite de personnes sur les campus.
Je serai ravie de répondre à toutes vos questions après l'exposé.
La culture du viol découle de la prévalence de la violence sexuelle sur les campus, conjuguée à la normalisation de cette violence. Grâce aux statistiques, nous savons que la violence sexuelle est très courante sur les campus canadiens. Par exemple, nous avons tous entendu les statistiques peu réjouissantes selon lesquelles quatre étudiantes de premier cycle sur cinq ont subi de la violence dans le cadre de leurs fréquentations amoureuses. L'acceptation de cette violence sexuelle est ce que nous appelons la « culture du viol ». Cela décrit des convictions, idées, structures et pratiques sociales et communautaires qui, conjuguées, peuvent donner à croire que des taux élevés de violence sexuelle sont normaux, inévitables et acceptables; peuvent nous exposer au blâme et à l'incrédulité, et réduire au silence les personnes qui sont victimisées; se nourrissent de stéréotypes sexistes et de mythes sur le viol voulant que les hommes soient naturellement violents et que les femmes aient tort parce qu'elles les provoquent; et se nourrissent de stéréotypes sexuels au sujet de certains groupes, comme les Autochtones, les communautés racialisées et les personnes transgenres et transsexuelles, renforçant la conviction selon laquelle ces personnes risquent davantage de commettre des abus ou d'être à l'abri de la victimisation. La culture du viol peut aussi nous amener à croire qu'il est normal que nos politiques, nos pratiques, nos forces policières et nos tribunaux ne réagissent pas bien au problème. À cause de la culture du viol, nous demeurons mal équipés et ne savons pas comment soutenir les victimes ou les survivants.
La culture du viol se trouve partout, dans les convictions personnelles et les grandes structures sociales. Elle prend racine dans les tendances historiques et les liens de pouvoir entre les personnes; le colonialisme et le sexisme en sont. Même avec l'amélioration des lois contre la violence et les stéréotypes sexuels, cela est ancré dans notre culture et lié aux formes continues d'oppression que sont le racisme, l'homophobie et la discrimination fondée sur la capacité physique. Par conséquent, la culture du viol aboutit à de plus grands risques pour les groupes vulnérables repoussés en marge de la société — par exemple, les jeunes femmes, les femmes autochtones et les transgenres —, mais il n'y a toujours pas de mesures de soutien et de services appropriés pour les personnes marginalisées qui subissent de la violence.
L'enquête nationale sur l'éducation menée par Égale Canada en 2011 signale qu'environ deux tiers des étudiants allosexuels — ou queer — ou transgenres ont indiqué ne pas se sentir en sécurité à l'école. En 2009, 74 % des crimes haineux signalés par des étudiants sur les campus ont été motivés par l'orientation sexuelle d'un étudiant, et un tiers des étudiants ont subi du harcèlement sexuel. Ces formes de violence sont directement liées à la race, à la religion, à l'identité sexuelle et à l'orientation sexuelle. Par conséquent, il faut absolument se pencher sur les intersections de la violence sexuelle au moment de concevoir une stratégie de lutte contre cette violence. La stratégie ne peut être distincte d'une démarche visant à contester toutes les formes d'oppression.
Cependant, concevoir une stratégie de lutte contre la violence sexuelle sur les campus canadiens est une entreprise difficile. Le climat d'incertitude économique donne lieu à des campus peu sûrs où il est difficile d'établir une culture axée sur le consentement.
Voici ce que j'entends par l'incertitude économique: les frais de scolarité en hausse, la dette étudiante sans précédent, le coût élevé du logement, le coût élevé de la nourriture et la nature du travail sur le campus, qui est précaire ou non rémunéré pour bien des stages.
De nombreuses statistiques viennent étayer cela, mais je vais n'en mentionner que deux. Premièrement, l'Ontario Association of Food Banks a signalé l'augmentation du nombre d'étudiants de niveau postsecondaire qui utilisent régulièrement les banques alimentaires, dont 8 % des utilisateurs sont des étudiants et des aînés, et a aussi indiqué que tous les collèges et toutes les universités sans exception ont sur place une banque alimentaire ou un programme de lutte contre la faim. Deuxièmement, les étudiants étrangers dans les collèges et universités du Canada font face à des obstacles économiques encore plus importants parce que leurs frais de scolarité sont souvent trois fois supérieurs à la moyenne canadienne et qu'ils risquent de trouver encore plus difficile d'avoir du travail rémunéré en raison des stéréotypes négatifs, du racisme ou de la xénophobie.
Nous nous trouvons donc dans un contexte où les étudiants sont forcés de se tourner vers des moyens autres que les moyens traditionnels pour survivre. La pauvreté sur les campus est grave et bien réelle, et elle augmente le risque d'exploitation des étudiants vulnérables et marginalisés. Les universités et collèges, avec leur forte proportion de jeunes femmes sur des campus isolés, sont des sources de préoccupation particulière concernant la traite de personnes. Internet ajoute à ce problème, et la traite en ligne de jeunes femmes et de filles est un problème grave et croissant dans nos collectivités.
La semaine dernière, l'arrestation d'un gérant de l'équipe de football de l'Université d'Ottawa a fait les manchettes. Il se faisait passer en ligne pour un agent d'artiste afin de piéger des filles et les forcer à se prostituer. Au Canada, c'est particulièrement inquiétant pour les femmes autochtones, parce que la majorité des femmes victimes de la traite de personnes sont des femmes et des filles autochtones.
La traite sexuelle en vue de l'exploitation sexuelle de femmes et d'enfants, en particulier des filles, est un problème grave de criminalité et de droits de la personne qui sévit dans les centres urbains. L'Ontario est vu comme étant l'un des centres importants de traite sexuelle de femmes et d'enfants autochtones. C'est aussi en Ontario qu'on trouve la majorité des victimes de la traite internationale reconnues par Citoyenneté et Immigration Canada, et c'est la province où il y a eu le plus de poursuites pour traite de personnes au Canada. Il y a eu des cas d'étudiants étrangers qui ont été victime de la traite internationale en Ontario.
Le gouvernement doit prêter attention aux facteurs conjugués de l'augmentation de la pauvreté chez les étudiants, des nombres élevés d'étudiantes s'identifiant comme étant des femmes et de l'emplacement des campus dans des villes frontalières. Nous devons veiller à comprendre et à gérer les risques connexes de traite sexuelle dans les secteurs entourant les campus.
Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous faire part de stratégies efficaces de lutte contre la culture du viol et la violence sexuelle sur les campus.
Pour être efficaces, les stratégies de lutte contre la violence sexuelle doivent faire intervenir le campus en entier. Les gens qui étudient, travaillent et vivent sur le campus et ceux qui l'utilisent sont les experts de la sécurité dans ce lieu, parce que ce sont eux qui comprennent le mieux les préoccupations relatives à la sécurité. Les étudiants peuvent orienter la mise en oeuvre du processus de changement et y contribuer. Ce processus doit se concentrer sur l'équité, la diversité et l'inclusion, pour que tout le monde sur le campus soit à l'abri de la violence sexuelle.
Les audits de sécurité sur les campus réalisés par METRAC représentent une pratique prometteuse. Ces audits de sécurité explorent les facteurs matériels, la violence sexuelle, les comportements discriminatoires, l'accès, les pratiques et les politiques. Ils exigent un partenariat entre les étudiants, l'administration, les professeurs, les employés et la communauté en général pour cerner efficacement les besoins et les ressources en matière de sécurité des diverses populations des campus. Dans le cadre des audits, on examine les politiques et les pratiques, on évalue les ressources et les besoins locaux, on évalue la sécurité et on produit un rapport détaillé aux différents campus, accompagné de recommandations à mettre en oeuvre.
Il y a aussi l'éducation inclusive. Nous parlons d'éduquer tous les membres des communautés sur les campus — les étudiants, le personnel et les professeurs — sur la culture du viol, la violence sexuelle et la façon de favoriser une culture fondée sur le consentement, au moyen d'ateliers présentés sur place par des pairs formés par des partenaires de la collectivité extérieure.
Il y a enfin la formation en ligne de METRAC à l'intention des étudiants. METRAC offre un nouveau cours en ligne intitulé: « Campus Consent Culture: Preventing Sexual Violence E-Course for Students ». Ce cours autodirigé en ligne, combiné à une éducation inclusive, permet aux étudiants d'apprendre ces concepts d'une façon interactive.
METRAC félicite le Comité de consacrer du temps et des ressources à explorer le problème de la sécurité des femmes et des filles sur les campus, et nous vous remercions infiniment de nous avoir donné l'occasion de vous transmettre nos connaissances.
:
Merci beaucoup, madame la présidente.
[Traduction]
Veuillez me le dire si je parle trop vite.
[Français]
Je vous remercie beaucoup d'avoir invité Action ontarienne contre la violence faite aux femmes à vous livrer une présentation aujourd'hui.
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes est un regroupement féministe et provincial de maisons d'hébergement, de centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, soit les CALACS, et de programmes sur la violence faite aux femmes. Ceux-ci offrent des services en français aux femmes qui sont aux prises avec la violence en Ontario. Le mandat d'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes est de développer des ressources en français sur la violence faite aux femmes, d'offrir de la formation et de coordonner des campagnes de sensibilisation.
L'objectif de votre étude est extrêmement ciblé. Je vais donc limiter ma présentation à la violence à caractère sexuel que subissent les jeunes femmes et les filles, en particulier sur les campus. Je vais surtout insister sur la sensibilisation à cette forme de violence en parlant de la campagne intitulée « Traçons les limites ».
II existe relativement peu de statistiques sur l'incidence de la violence à caractère sexuel sur les campus, mais des études aux États-Unis ont montré qu'approximativement une étudiante sur quatre était victime d'agression sexuelle au cours de ses études postsecondaires, ce qui est tout de même significatif. Comme l'a dit Mme Ross-Marquette, toutes ces agressions sexuelles sont favorisées par une culture qui est présente dans notre société et sur les campus et que nous appelons généralement la culture du viol. Cette culture, qui est sexiste, machiste et basée sur de très nombreux stéréotypes, a pour effet de rendre les survivantes de l'agression sexuelle responsables de l'agression qu'elles ont subie et de les blâmer pour celle-ci. En outre, elle tend à déresponsabiliser totalement les agresseurs et à minimiser les agressions sexuelles.
Au cours des dernières années, cette culture du viol s'est exprimée à maintes reprises sur les campus en Amérique du Nord. Par exemple, certains collèges ou universités ont découragé très fortement des survivantes de dénoncer l'agression qu'elles avaient subie. Je présume que vous vous souviendrez de plusieurs cas où des activités extrêmement sexistes étaient organisées sur les campus, notamment pendant les semaines d'intégration.
Une des façons assez efficace de lutter contre la culture du viol, donc contre les agressions à caractère sexuel dans la société et sur les campus, en particulier, est d'abord de dénoncer cette culture et de faire de la sensibilisation. La campagne Traçons les limites a été créée en Ontario par Action ontarienne contre la violence faite aux femmes et par l'Ontario Coalition of Rape Crisis Centres. Mme Lalonde, qui est ici présente, a elle aussi participé à l'élaboration de cette campagne, qui a été créée en 2012.
L'un des premiers avantages de cette campagne, qui est extrêmement important pour moi, est qu'elle est entièrement bilingue et qu'elle a été créée simultanément en français et en anglais. Elle répond donc aussi aux besoins des francophones. De plus, cette campagne de sensibilisation a une approche féministe, c'est-à-dire que nous voyons la violence à caractère sexuel comme une forme de violence faite aux femmes, soit une violence liée au genre. Nous analysons la violence à caractère sexuel dans un contexte beaucoup plus large, soit en tant que problème social qui concerne tout le monde et qui est causé par l'inégalité entre les hommes et les femmes.
La campagne Traçons les limites s'adresse aux personnes de l'entourage. Nous avons choisi de nous adresser au public, soit aux hommes et aux femmes en tant que personnes de l'entourage, plutôt qu'aux femmes en tant que victimes et aux hommes en tant qu'agresseurs. Il est extrêmement important que nous procédions de cette façon. En effet, si nous nous adressons aux femmes en tant que victimes potentielles, nous risquons facilement de les blâmer ou de leur donner des conseils sur la façon d'éviter les agressions sexuelles en évitant de boire, en sortant en groupe, en évitant de faire du sexting et ainsi de suite.
Tous ces conseils renforceraient le mythe que les femmes pourraient éviter une agression sexuelle alors que ce n'est pas vrai. Peu importe ce qu'une femme fait ou fera, elle n'évitera pas une agression sexuelle.
Nous avons aussi décidé de ne pas nous adresser aux hommes en tant que potentiels agresseurs parce qu'on a démontré que ce n'était pas efficace, qu'il n'y avait pas d'effet sur les agresseurs et, surtout, que cela n'encourageait pas les hommes à s'engager comme potentiels alliés et comme personnes pouvant favoriser le changement. En fait, nous nous adressons aux hommes et aux femmes comme étant des personnes de l'entourage pouvant intervenir de façon efficace pour mettre fin à une situation de violence à caractère sexuel, soutenir efficacement et de façon empathique une survivante ou tenir responsable un agresseur.
Pour provoquer des changements sociaux profonds, il faut que le public se sente concerné et sache reconnaître les différentes formes de violence à caractère sexuel parce que, pour la majorité des gens, la violence à caractère sexuel reste uniquement le viol alors que nous savons que c'est beaucoup plus que cela. Il faut aussi non seulement reconnaître la violence à caractère sexuel, mais surtout savoir comment intervenir de façon sécuritaire et efficace pour y mettre fin. Si nous n'outillons pas les personnes de l'entourage de façon à pouvoir bien intervenir, ce ne sera pas efficace et nous n'irons pas jusqu'au bout de la pensée à ce sujet.
Avec la campagne Traçons les limites, nous avons fait le choix de créer différentes mises en situation qui couvrent tout le continuum de la violence à caractère sexuel. Par exemple, nous avons préparé des scénarios sur l'alcool et les agressions, la cyberviolence sexuelle, le viol conjugal, l'exploitation sexuelle et la violence dans la culture sportive ou dans la société. Ces scénarios permettent aux personnes de l'entourage d'être exposées à une situation réelle ou possible d'agression sexuelle, de réfléchir à la situation et surtout de voir ce qu'elles pourraient faire dans ces situations spécifiques.
Comme je l'ai précisé un peu plus tôt, l'intervention est extrêmement importante. En fait, dans chacun de ces scénarios, nous donnons aussi quelques exemples d'interventions possibles pour commencer à guider la réflexion.
Un des avantages de la campagne est qu'elle peut être mise en oeuvre de plusieurs façons. Elle peut être faite à la fois sur les médias sociaux ou être faite individuellement en recevant le matériel de la campagne. Je vous ai d'ailleurs apporté quelques exemplaires à ce sujet. Cela peut donc être une réflexion individuelle ou une réflexion collective et informelle entre amis ou avec la famille.
Cependant, selon moi, la méthode de sensibilisation la plus efficace est l'organisation d'ateliers qui sont organisés dans les écoles ou sur les campus et qui sont menés par des personnes qui travaillent dans les CALACS. Il est important que les personnes qui donnent les ateliers soient formées parce que quand de la formation est donnée sur la violence faite aux femmes et sur la violence à caractère sexuel, en particulier, il faut se préparer à avoir parfois des conversations un peu difficiles. Si la personne n'est pas prête à recevoir des commentaires et des réactions négatifs, elle peut se trouver en difficulté.
La campagne Traçons les limites est mise en oeuvre au jour le jour par les différents CALACS dans les provinces anglophones et francophone, sur les campus et dans les écoles secondaires. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de dialogues et que les ateliers favorisent la conversation. C'est ce qui est le plus efficace pour provoquer des changements profonds. Une affiche ou une publicité à la télévision ne sont pas suffisantes pour provoquer des changements d'attitude et de mentalité. Le plus important est d'en parler et d'avoir l'expertise d'une personne qui est en mesure de briser tous les mythes et de parler de la réalité de la violence à caractère sexuel.
Je vous remercie.
:
Moi aussi, je parle très rapidement, peu importe la langue. Je vais donc essayer de parler très lentement, et je vais faire attention aux formidables interprètes.
Merci infiniment d'avoir invité notre organisation. Nous sommes la première section d'Hollaback! au Canada, et nous existons depuis 2010. Nous trouvons très remarquable que le harcèlement de rue soit dans la mire du gouvernement fédéral. Cela nous emballe.
Je vais parler un peu de notre travail et de notre organisation, mais Maïra en a déjà beaucoup dit, alors je vais me faire l'écho de ses propos sur les stratégies efficaces.
Pour les gens qui ne connaissent pas Hollaback!, je tiens à préciser d'abord que nous n'avons rien à voir avec la chanson de Gwen Stefani.
Des voix: Oh, oh!
Mme Julie Lalonde: Les gens pensent toujours que c'est lié à Gwen Stefani. Sauf le respect que je lui dois, ce n'est pas le cas.
L'organisation a vu le jour vers 2005 à New York. Vous vous rappellerez qu'à l'époque, les téléphones cellulaires permettant de prendre des photos étaient des nouveautés technologiques. C'était très excitant. C'était terrible et imprécis, mais très excitant.
Une jeune femme était dans un métro de New York et s'en allait travailler quand quelqu'un s'est mis à se masturber devant elle. Cela lui était déjà arrivé, mais elle a réalisé que dans sa poche se trouvait un téléphone tout neuf muni d'un appareil photo. Elle a pensé qu'elle pourrait prendre une photo du type et que cela lui donnerait une preuve qui permettrait à la police de faire quelque chose. Elle a pris sa photo. Il a posé pour la photo: ce qu'il faisait était à ce point flagrant. Ce n'était manifestement pas la première fois qu'il faisait cela. Elle a apporté la photo à la police de New York et leur a demandé de bien vouloir arrêter ce type. Ils lui ont répondu qu'il y avait des millions de personnes à New York et lui ont demandé comment elle croyait qu'ils pourraient bien trouver ce type en particulier.
C'était avant les médias sociaux tels que nous les percevons maintenant. Elle a mis la photo sur Flickr qui est, comme vous le savez je l'espère, un site de partage de photos — un des premiers médias sociaux —, et la photo est devenue virale. Elle a abouti sur la Une du Daily News de New York. Il a fini par être arrêté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été relâché et qu'on l'a repris tout récemment à faire la même chose à quelqu'un d'autre.
L'important, dans cette histoire, c'est que quand une jeune femme a utilisé ce qu'elle avait à sa disposition pour lancer une discussion, cela a déclenché une énorme discussion dans la ville de New York. Des hommes disaient, « Comme si ça arrivait aux femmes... », et des femmes disaient, « Comme si vous ne saviez pas que c'est la réalité, quand il faut marcher sur la rue à New York et prendre les transports en commun ».
Un groupe de femmes et d'hommes de New York ont pensé que cette nouvelle technologie mobile était peut-être la réponse, parce que vous aviez un moyen d'immortaliser le problème à l'instant même. Initialement, le site a été lancé pour permettre aux gens de la ville de New York d'immortaliser de tels événements en temps réel, mais cela s'est rapidement transformé. Des gens de partout dans le monde leur ont dit que ce problème n'était pas propre à New York, mais que cela se passait en Inde, en Europe et en Amérique latine. Cela se produisait partout, et ils ont demandé de pouvoir aussi participer.
Maintenant, dans notre forme actuelle, n'importe qui dans le monde peut ouvrir une section. Nous sommes maintenant dans 60 villes, sur 5 continents — j'en ai fait le compte ce matin —, et pouvons compter sur le travail de plus de 300 militants, en très grande majorité des bénévoles. Plus de la moitié des personnes qui gère un site Hollaback! sont considérées comme étant jeunes — donc, âgées de moins de 30 ou 25 ans. Ce sont des jeunes qui mènent ce mouvement.
Quant à la façon dont cela fonctionne, nous avons une application que vous pouvez télécharger gratuitement. Nous avons une section, ici, à Ottawa. Vous pouvez soumettre votre histoire, par exemple, que vous marchiez sur la rue Rideau et qu'un homme en voiture a crié après vous, ou qu'un type vous a suivie en vous demandant sans relâche, sur une bonne distance, votre numéro de téléphone, et que cela vous a vraiment écoeurée. Vous nous soumettez votre histoire, nous l'approuvons, et en plus de se retrouver sur le site, il apparaît sur la carte un petit point, ce qui nous permet de commencer à voir où se produit le harcèlement de rue dans la ville. Cela nous donne de vraies données en temps réel sur ce qui se passe dans notre collectivité.
Cela nous a permis de présenter des données. Par exemple, lors des élections municipales, il y a quelques années, nous leur avons présenté le genre de choses que nous voyions et que nous vivions. Nous avons pu joindre tous les candidats et leur dire ce qui se passait dans leurs quartiers, puis leur demander ce qu'ils comptaient faire à ce sujet.
Voici ce qui m'importe. Quand nous avons commencé, les gens nous demandaient si nous craignions d'être poursuivis par les types dont nous prenions les photos parce qu'ils se comportaient comme des salauds. C'est ce dont ils présumaient. Il était question de libelle. Ils nous demandaient aussi quel pouvoir cela donnait de relater ce qui était arrivé à quelqu'un. Ils disaient: « Une fille vient de se défouler sur le site Web, mais qu'est-ce que cela fait? ». Eh bien, en créant un lieu qui permet aux gens de relater ce qui leur est arrivé, nous obtenons des données que nous n'avions pas avant.
Nous étions là depuis deux ans, puis nous avons décidé de nous pencher sur les thèmes qui revenaient sans cesse à Ottawa. Le transport en commun est nettement ressorti. C'est de cela que je veux vous parler très brièvement, parce que la plupart des gens, des étudiants, utilisent le transport en commun. Nous avons dans la ville la U-Pass. C'est courant sur les campus partout au pays: on présume que vous allez utiliser le transport en commun.
Le transport en commun à Ottawa — je peux le dire — demeure très dangereux pour les femmes et les jeunes, les allosexuels, les personnes handicapées et les aînés. Ce que nous avons constaté en particulier, c'est qu'un nombre ahurissant de cas sont liés à du harcèlement dans l'autobus, en attendant l'autobus, ou en descendant de l'autobus, en chemin vers la maison.
Nous avons soumis cette information à OC Transpo, la société de transport d'Ottawa, mais ils ont été plus qu'un peu méprisants. En réalité, ils étaient outrés que nous ayons le culot de dire sur notre site Web qu'il y avait beaucoup de harcèlement dans les autobus, parce qu'ils ne recevaient pas de signalements. Il faut dire que vous avez là un groupe de personnes privilégiées qui n'utilisent pas le transport en commun. Ce sont en majorité des hommes, et leur réaction, c'était: « Nous ne recevons pas de signalements de ce genre. Comment savoir, alors, si vous n'inventez pas tout cela? »
Nous avons tenu une assemblée publique. Nous avons amené des gens à raconter leurs histoires. Cela a tout simplement pris d'incroyables dimensions, dans la ville. Les femmes se présentaient et disaient qu'elles ne connaissaient pas une seule femme qui n'avait pas subi les regards lubriques d'un type pendant au moins les 40 minutes de leur trajet en autobus.
Nous avons continué à leur faire de la pression en recourant aux médias et en les rencontrant tous les mois. Ce que nous voulions, c’était une campagne portant sur l’intervention des témoins. Nous voulions des annonces disant aux gens qu’ils avaient un rôle à jouer s’ils voyaient une personne en harceler une autre. Nous avons dû accepter une campagne… Ceux qui utilisent le transport en commun auront vu des annonces disant « si vous vous sentez harcelée » ou « si vous vous sentez menacée ». C’est le résultat du travail que nous avons accompli avec eux pendant trois ans, à les pousser et à leur dire que s’ils reconnaissaient cela, les gens en parleraient.
Nous voulions aussi un mécanisme de signalement anonyme. Nous savions que la grande majorité des personnes ne voulaient pas faire de signalements parce qu’elles craignaient d’être stigmatisées, d’être blâmées en tant que victimes, et tout ce que mes collègues ont déjà mentionné. En fait, nous avions raison. Ottawa est la première ville à avoir un mécanisme de signalement anonyme au pays. Apparemment, ce mécanisme est peut-être le premier en Amérique du Nord, ce qui est très emballant. Croyez-le ou non, la plupart des événements qui leur sont signalés sont des choses qui n’avaient jamais été signalées avant, y compris les nombreux cas de regards lubriques et d’attouchements.
En fait, cela a mené à l’arrestation d’un prédateur sexuel récidiviste qui s’en prenait à des femmes et embrassait de jeunes filles alors qu’elles attendaient l’autobus pour se rendre à l’école. De nombreuses femmes l’ont signalé au moyen du mécanisme anonyme. Ils ont regardé les vidéos, ont constaté que c’était bien vrai, et il a été arrêté.
Encore une fois, vous créez un lieu où les gens peuvent relater leurs histoires, et les jeunes femmes veulent le faire, mais il faut faire quelque chose de cette information.
Je vais vous laisser avec quelques statistiques. L’administration centrale de Hollaback! se trouve à New York. Ils ont du financement. C’est la seule section dans le monde à recevoir des fonds pour faire son travail. Ils ont travaillé avec l’Université Cornell afin de recueillir des statistiques mondiales sur le harcèlement de rue, ce qui s’est révélé vraiment important.
Ce qu’ils ont constaté, c’est que 88 % de Canadiennes ont subi du harcèlement avant l’âge de 18 ans, ce qui signifie que 88 % des Canadiennes ont été harcelées au moins une fois avant d’atteindre l’âge de la majorité. Cinquante pour cent des répondantes ont subi des attouchements au moins une fois au cours de la dernière année, ce qui est vraiment considérable. Quarante pour cent des répondantes ont dit qu’à cause du harcèlement de rue, elles sont arrivées en retard à l’école, soit parce qu’elles ont dû faire un détour ou qu’elles ont dû reprendre leurs esprits avant d’entrer en classe.
À l’échelle locale, nous avons réalisé notre propre recherche. Elle n’a pas été financée par les gens formidables de Cornell, mais elle est quand même très solide. Ce que nous avons constaté — c’est très important et cela correspond à ce que Maïra a dit — , c’est que pour 6 % seulement des personnes qui ont été harcelées, quelqu’un est intervenu pour les aider. C’est très important, compte tenu de la nature du harcèlement de rue, qui se produit dans un lieu public. Si vous êtes en autobus, il y a au moins vous, l’agresseur et le conducteur. Si vous attendez l’autobus, il y a probablement d’autres personnes autour.
Les gens interviennent très peu parce qu’ils ne reconnaissent pas cela comme étant une forme de violence. Ils ne comprennent pas que le harcèlement de rue fait partie d’un continuum. Ils ont peur de l’escalade. Ils pensent que seuls les fous harcèlent les femmes aux arrêts d’autobus et que, s’ils interviennent, le fou va s’attaquer à eux. C’est une forme d’instinct de conservation.
Nous avons aussi constaté que les gens ne savent tout simplement pas quoi faire. Nous avons donc un programme, et notre réponse, ce n’est pas la criminalisation. Nous nous opposons en fait à la criminalisation du harcèlement de rue, parce que la plupart des choses que nous vivons sont déjà contraires à la loi. L’enjeu n’est pas là. L’enjeu, c’est d’amener les gens à intervenir, que cela comporte au pas le signalement.
Pour terminer, je veux vous parler de notre programme. Il s’appelle « I’ve got your back », ce qui signifie « Je suis là pour toi ». Nous enseignons les quatre options d’intervention: diriger, déléguer, distraire ou attendre.
Par exemple, si je vois que Maïra se fait harceler et que c’est à un degré assez faible — si le type ne fait que parler avec elle et que je me sens en sécurité —, je peux aller le voir et lui dire: « Elle ne vous connaît pas. Elle n’est pas intéressée, alors laissez-la tranquille. » Je peux aussi m’adresser à elle et lui dire: « Est-ce que vous le connaissez? Voulez-vous que j’appelle quelqu’un? » Je peux intervenir directement si c’est sûr.
Vous pouvez déléguer si la situation n’est pas sûre. Vous êtes peut-être très petite, contrairement à moi, qui suis grande et dont le travail est de crier après les gens pour dénoncer le patriarcat...
Des voix: Oh, oh!
Mme Julie Lalonde: … et donc, vous n'êtes pas nécessairement à l’aise d’intervenir. Vous pouvez déléguer. Vous pouvez le dire au conducteur, aller très discrètement à l’avant et lui dire qu’une femme semble très mal à l’aise et que vous croyez qu’il se passe quelque chose. Si vous êtes sur un chantier de construction, vous pouvez trouver le type qui porte le casque blanc et lui dire qu’un membre de son personnel harcèle quelqu’un. Si vous êtes au centre commercial, parlez au responsable de la sécurité du centre. Vous pouvez déléguer.
Vous pouvez créer une distraction, ce qui représente un moyen d’éviter la confrontation. Disons que je vois que Maïra subir du harcèlement. Je peux aller la voir et lui dire: « Dites, je dois descendre à l’arrêt de la rue Rideau. Savez-vous où aller? » Vous créez une distraction et indiquez à cette personne que quelqu’un voit ce qui se passe.
Vous pouvez aussi attendre, ce qui est aussi très important. Cela peut sembler inefficace, mais vous pouvez attendre que le moment soit passé, puis aller voir la personne et lui dire que vous avez vu ce qui lui est arrivé. Vous pouvez lui demander si tout va bien, lui dire que c’était vraiment dégoûtant, et lui demander si elle veut que vous appeliez quelqu’un ou que vous marchiez avec elle jusqu’à destination.
C’est ce que nous faisons. C’est ce que nous enseignons. Nous enseignons l’intervention des témoins, mais nous avons des moyens de nous rendre dans ces lieux. C’est ce que les campus veulent que nous fassions, et c’est ce que nous faisons avec les jeunes.
Encore une fois, je vous remercie de vous pencher sur le harcèlement de rue. C’est d’une très grande importance pour nous.