SRSR Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Sélecteur de publication par date
| Février | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
|
6
|
7
|
9
|
11
|
12
|
||
|
13
|
14
|
16
|
18
|
19
|
||
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
|||||
| Mars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|||
| Avril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
29
|
30
|
|
| Mai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
13
|
14
|
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
20
|
21
|
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
||||
| Juin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
3
|
4
|
||||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
10
|
11
|
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
| Juillet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
||||||
| Août | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|||
| Septembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
3
|
||||
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
23
|
24
|
|
|
25
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
| Octobre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
||||||
|
2
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
||||||
| Novembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
|
20
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
|
27
|
29
|
30
|
||||
| Janvier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|||||
| Février | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
3
|
4
|
||||
|
5
|
6
|
8
|
10
|
11
|
||
|
12
|
13
|
15
|
17
|
18
|
||
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
||||
| Mars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
5
|
6
|
8
|
10
|
11
|
||
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
22
|
24
|
25
|
||
|
26
|
27
|
29
|
31
|
|||
| Avril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
|
23
|
24
|
26
|
28
|
29
|
||
|
30
|
||||||
| Mai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
3
|
5
|
6
|
|||
|
7
|
8
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
14
|
15
|
17
|
19
|
20
|
||
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
31
|
||||
| Juin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
2
|
3
|
|||||
|
4
|
5
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
11
|
12
|
14
|
16
|
17
|
||
|
18
|
19
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
| Juillet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
|||||
| Août | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
| Septembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
19
|
21
|
22
|
23
|
||
|
24
|
26
|
28
|
29
|
30
|
||
| Octobre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
17
|
19
|
20
|
21
|
||
|
22
|
24
|
26
|
27
|
28
|
||
|
29
|
31
|
|||||
| Novembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
2
|
3
|
4
|
||||
|
5
|
7
|
9
|
10
|
11
|
||
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
21
|
23
|
24
|
25
|
||
|
26
|
28
|
30
|
||||
| Février | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
2
|
3
|
|||||
|
4
|
5
|
7
|
9
|
10
|
||
|
11
|
12
|
14
|
16
|
17
|
||
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
28
|
||||
| Mars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
20
|
22
|
23
|
||
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
||||||
| Avril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
7
|
8
|
10
|
12
|
13
|
||
|
14
|
15
|
17
|
19
|
20
|
||
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
|||||
| Mai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
3
|
4
|
||||
|
5
|
6
|
8
|
10
|
11
|
||
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
|
26
|
27
|
29
|
31
|
|||
| Juin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
5
|
7
|
8
|
||
|
9
|
10
|
12
|
14
|
15
|
||
|
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
||||||
| Juillet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|||
| Août | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
3
|
||||
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| Septembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
18
|
20
|
21
|
||
|
22
|
23
|
25
|
27
|
28
|
||
|
29
|
30
|
|||||
| Octobre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|
2
|
4
|
5
|
||||
|
6
|
7
|
9
|
11
|
12
|
||
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
23
|
25
|
26
|
||
|
27
|
28
|
30
|
||||
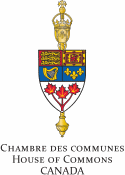
Comité permanent de la science et de la recherche
|
l |
|
l |
|
TÉMOIGNAGES
Le lundi 3 octobre 2022
[Enregistrement électronique]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]
[Français]
[Traduction]

