NDDN Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
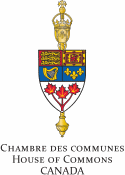
Comité permanent de la défense nationale
|
l |
|
l |
|
TÉMOIGNAGES
Le mercredi 14 février 2024
[Enregistrement électronique]
[Traduction]
La séance est ouverte. Je remercie mes collègues d’être venus aussi rapidement que possible. Nous n’avons qu’une dizaine de minutes de retard, ce qui est remarquable dans notre cas.
Nous accueillons aujourd’hui un vieil ami du Comité, M. Drapeau, qui est venu ici à maintes reprises, tout comme M. McSorley. Nous apprécions votre présence à tous les deux.
Nous accueillons également Richard Shimooka, agrégé supérieur à l’Institut Macdonald-Laurier, par vidéoconférence. Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd’hui.
Vous connaissez tous le fonctionnement des travaux du Comité. Nous accordons cinq minutes pour les déclarations préliminaires, puis nous passons aux questions. Puisque nous avons une séance de 90 minutes, je vais proposer de procéder à trois séries de questions dans l’ordre.
Sur ce, étant donné que les vidéoconférences sont fondamentalement instables — nous ne leur faisons pas confiance —, je vais demander à M. Shimooka de faire sa déclaration préliminaire de cinq minutes. Ce sera ensuite le tour de MM. Drapeau et McSorley.
Merci infiniment de me permettre de m’adresser au Comité aujourd’hui sur la transparence au sein du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. À mes yeux, c’est un sujet d’une grande pertinence pour bien des raisons, la plus importante étant sans aucun doute son incidence majeure sur ma capacité à mener des recherches sur les politiques et les stratégies en défense au Canada. Les outils les plus efficaces à ma disposition sont le régime de la Loi sur l’accès à l’information et les entretiens avec les décideurs.
Mon allocution va porter sur les changements survenus à cet égard au cours des 20 dernières années et leur incidence sur la transparence en général.
Pourquoi ces recherches sont-elles importantes? D’emblée, on dira que c’est une forme primordiale de reddition de comptes et de surveillance du gouvernement qui lui est extérieure. C’est le point de vue traditionnel. Pourtant, il y a d’autres avantages. Notre système de gouvernance manque de connaissances sur ses institutions. On oublie souvent les circonstances historiques qui ont mené à la création des politiques, même si ces politiques sont toujours en vigueur. Remédier à cette lacune peut aider les décideurs à établir de meilleures politiques à l’avenir.
Enfin, de telles recherches peuvent aider le gouvernement à mieux présenter ses politiques au pays et à l’étranger. Même les ministres les plus doués ont un nombre restreint d’occasions d’expliquer ces facteurs contextuels. L’analyse faite par des chercheurs indépendants peut s’avérer un important moyen de communication pour promouvoir la concrétisation des objectifs des politiques.
Malheureusement, depuis 20 ans, il est de plus en plus difficile d’entreprendre des recherches en matière de politiques publiques. J’ai commencé mes travaux vers 2002, quand la transparence et la surveillance étaient grandement influencées par les répercussions de l’enquête sur la Somalie. Elle a révélé des tentatives coordonnées à l’échelle du ministère de masquer les aspects de la crise, ce qui englobait l’accès à l’information. L’opacité du ministère l’a forcé à revoir ses opérations dans la décennie qui a suivi.
Au cours des 20 dernières années, l’inefficacité croissante du régime d’accès à l’information a nui à l’obtention de renseignements utiles en temps opportun. En 2002, une demande assez simple d’accès à l’information produisait normalement une bonne quantité de documents. Une série de demandes d’accès à l’information dont je me suis servie pour étudier l’intervention de 1996 au Zaïre s’est traduite par plus de 2 000 documents d’une très grande complexité, y compris un grand nombre de sources étrangères d’information, de conseils et de renseignements sensibles. Il fallait environ un an pour que la demande originale soit honorée et qu’elle fournisse un aperçu détaillé de ce qui s’est passé pendant cette opération. Aujourd’hui, ce serait impensable.
Année après année, le nombre de pages diminue, et les fonctionnaires ont souvent recours à des interprétations très restrictives dans le but d’empêcher la divulgation de certains documents, quand ils n’affirment pas carrément qu’aucun document du genre n’a été trouvé. Dans d’autres cas, on informe les demandeurs que la portée de leur demande est trop large et qu’on a été obligé de la réduire. Enfin, on compte souvent en années le temps nécessaire au traitement des demandes, ce qui diminue sérieusement la valeur de l’accès à l’information comme outil de recherche.
Ces raisons ne sont pas toutes forcément intentionnelles. Le régime d’accès à l’information dépend énormément des effectifs ministériels qui doivent évaluer les documents à divulguer, soit les mêmes employés qui ont déjà une surcharge de travail à gérer au quotidien. Cette approche est loin d’être la meilleure façon de gérer les demandes d’accès à l’information.
En plus de l’affaiblissement du régime d’accès à l’information, des efforts sont constamment déployés pour limiter la capacité des fonctionnaires à discuter des politiques avec les parties intéressées. Dans les années qui ont suivi l’enquête sur la Somalie, le ministère de la Défense nationale avait une politique de communication assez libérale, et il était assez facile d’accéder aux fonctionnaires. Les ministères mettaient à la disposition des intéressés des spécialistes d’une question donnée pour des fins de discussions, ce qui était l’un des aspects les plus utiles.
Toutefois, en 2005, la politique a radicalement changé, en partie parce que l’on a jugé nécessaire, dans le contexte de la guerre en Afghanistan, de s’en tenir à des messages précis, et parce que le gouvernement Harper préférait des stratégies de communication centralisées. L’accès à l’information a donc été réduit et replacé par des réponses superficielles à l’intention des médias formulées par les représentants des affaires publiques.
En outre, il est de plus en plus difficile de maintenir des relations de travail avec les fonctionnaires. L’une des plus graves ruptures s’est produite après 2015, quand le vice-amiral Mark Norman a été inculpé d’abus de confiance et que l’on a forcé les membres du projet de capacité des futurs chasseurs à signer un engagement de ne rien divulguer. Ces événements ont eu pour effet de pétrifier les fonctionnaires, puisque les gens avaient peur des possibles conséquences de s’exprimer à l’extérieur de l’appareil gouvernemental. Même si nous avons certes été témoins d’un plus grand engagement des fonctionnaires de la Défense au cours de la dernière année, une importante réticence à s’exprimer avec candeur demeure.
Où en sommes-nous aujourd’hui? Globalement, j’estime que la piètre transparence à la Défense est essentiellement contreproductive pour le gouvernement. La compréhension que la population a de l’armée n’a jamais été aussi mauvaise et elle contribue à son manque de soutien, ce qui est en partie attribuable au manque de renseignements accessibles et aux relations devenues confrontationnelles entre le gouvernement et les organes indépendants en matière d’accès à l’information.
Malheureusement, je n’ai pas de solution facile à ce problème. Il existe un point de vue bien arrêté voulant que l’approche actuelle soit la seule façon de bien gérer les relations publiques. Passer outre la situation actuelle au profit d’un avenir radicalement différent est difficile à vendre à tout gouvernement. Je crains qu’il faille un autre scandale de l’ampleur de celui sur la Somalie pour amener le gouvernement à changer d’optique, ce qui ne profitera à aucun parti ni au pays dans son ensemble.
Merci
Merci. C’est un honneur pour moi de comparaître devant ce comité.
Permettez-moi de commencer par une brève description de mon parcours.
J’ai servi dans les Forces armées canadiennes durant 34 ans, puis j’ai pris ma retraite en 1993. J’occupais alors le poste de secrétaire général du Quartier général de la Défense nationale. Peu de temps après, je suis allé à la faculté de droit. Après mon stage à la Cour d’appel fédérale, j’ai été admis au Barreau de l’Ontario, il y a exactement 22 ans aujourd’hui.
À pareille date, en 2002, j’ai ouvert le premier cabinet au Canada spécialisé en droit militaire. En 2009, l’Université d’Ottawa m’a nommé professeur associé à la Faculté de droit, où j’ai enseigné le droit militaire et le droit de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels. Depuis, j’ai cosigné un certain nombre de textes juridiques, dont un sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels au fédéral et un autre sur le droit militaire canadien.
En tant qu’avocat, j’utilise régulièrement le régime d’accès à l’information au nom de mes clients, tant des particuliers que des entreprises, afin d’accéder à de l’information et à des dossiers publics liés à leurs demandes. Pour vous donner une idée de l’ampleur de mon recours au droit de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, sachez que mon cabinet a présenté, depuis septembre 2007, un total de 4 645 demandes d’accès à l’information au titre de la loi fédérale sur l’accès à l’information et de certaines lois provinciales sur l’accès à l’information à plus de 250 institutions fédérales. Elles n’ont pas toutes été fructueuses, mais un bon nombre l’ont été. Comme vous pouvez l’imaginer, en cours de route, nous avons rencontré toutes les frustrations imaginables.
D’après mon expérience, les processus fédéraux d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels sont affligés de longs retards, qui sont aggravés — je ne pense pas que ce volet ait encore été discuté par votre comité — par le Commissariat à l’information et par le Commissariat à la protection de la vie privée. Ils sont chargés d’enquêter sur les plaintes et prennent, en moyenne, au moins un an pour mener à bien leurs enquêtes. C’est suffisant pour mettre à l’épreuve la persévérance et la patience de la plupart des utilisateurs du régime d’accès à l’information.
Je veux traiter de trois autres aspects.
Le premier concerne les griefs. Toujours dans le cadre de mes activités d’avocat, mon cabinet représente régulièrement des militaires qui ont des griefs. Dans un mémoire de six pages dont j’ai prévu la distribution aux membres en anglais et en français, je fournis des exemples que nous avons vus au cours des 90 derniers jours au cabinet, en particulier sur ce sujet et d’autres.
Le mauvais fonctionnement du système de règlement des griefs est, à mon avis, en grande partie attribuable au temps extraordinaire que prend l’autorité de dernière instance pour trancher. Qui est l’autorité de dernière instance? C’est le chef d’état-major de la Défense.
D’après mon expérience, il n’est pas inhabituel que le chef d’état-major de la Défense prenne entre quatre et cinq ans pour rendre une décision finale. Un délai aussi long entraîne une grande frustration et donne l’impression aux plaignants qu’ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Ce n’est que lorsque le chef d’état-major de la Défense signe la décision finale qu’un plaignant peut s’adresser à la Cour fédérale pour un contrôle judiciaire afin d’obtenir justice.
Enfin, je veux parler de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire. En tant qu’avocat, je dépose également des plaintes à la Commission au nom de mes clients. Je n’ai rien contre la Commission. Cependant, dans le cadre de son processus de traitement des plaintes, les plaintes sont d’abord envoyées au grand prévôt, dans la section appelée le Bureau des normes professionnelles, pour qu’il les examine. Ce processus prend des mois, voire des années. À titre d’exemple, j’ai écrit hier au président de la Commission pour lui expliquer que l’une des plaintes avait été soumise au Bureau des normes professionnelles il y a deux ans et quatre mois de cela, et que le plaignant attendait toujours une décision de la Commission.
Sur ce, je vais conclure. Je serai heureux de répondre à vos questions.
Merci, monsieur le président et mesdames et messieurs les membres du Comité, de m'avoir invité à témoigner aujourd'hui dans le cadre de votre étude sur la transparence au ministère de la Défense nationale.
Je suis le coordonnateur national de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, une coalition de 45 organisations canadiennes qui, depuis 2002, vise à lutter contre les répercussions des lois en matière de sécurité nationale et de lutte antiterrorisme sur les libertés civiles au Canada et à l'étranger.
Comme vous pouvez l'imaginer, travailler dans ce domaine nous amène souvent à lutter contre des problèmes liés au secret et à la transparence. Une grande partie de notre travail consiste à lutter contre l'étendue sans cesse croissante de la culture du secret et l'érosion constante de la transparence auxquelles on laisse cours sous prétexte de vouloir protéger la sécurité nationale.
La transparence en soi est essentielle à la reddition de comptes et à la protection des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Charte canadienne. Le secret engendre l'absence de reddition de comptes, ce qui mène immanquablement à des abus. C'est particulièrement troublant lorsque cela se produit dans des domaines comme la sécurité nationale et la défense nationale, dans lesquels on doit composer avec des problèmes des plus complexes et on risque souvent de commettre les plus graves violations des droits de la personne.
Compte tenu de notre mandat particulier, notre travail se concentre sur le Centre de la sécurité des télécommunications, ou CST, qui relève du ministère de la Défense nationale, ou MDN. Nous avons également suivi l'évolution récente des activités de collecte de renseignements du ministère de la Défense nationale et les plus récentes interventions du Canada en Afghanistan.
Le CST n'est qu'un des intervenants qui relèvent du ministère de la Défense nationale, mais il mène une vaste gamme d'activités qui ont trait notamment à la collecte de renseignements, à la surveillance et aux cyberopérations actives et défensives. Conformément à son mandat, le CST offre également du soutien au MDN et à d'autres ministères. Il s'agit par ailleurs de l'un des organismes les plus secrets au sein non seulement du MDN, mais de l'ensemble de l'appareil gouvernemental canadien.
Étant donné que nous nous préoccupons de la transparence et de la reddition de comptes, j'aimerais attirer votre attention sur la relation du CST et du MDN avec les organismes d'examen de la sécurité nationale, soit le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, ou CPSNR, et l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, ou OSSNR. Ce sont deux entités relativement nouvelles. Leur raison d'être est d'assurer le genre de reddition de comptes qui ne peut manifestement pas être offerte directement au public parce que le CST, les services de renseignement du MDN et d'autres organismes de sécurité nationale travaillent en secret. Ces organismes de surveillance visent essentiellement à rendre des comptes directement au public à la place de ces organismes de sécurité nationale.
Ces organismes d'examen et de surveillance sont tenus au secret et travaillent dans des installations sécurisées. Une grande partie de l'information fournie est elle-même caviardée lorsqu'elle est rendue publique. Compte tenu de toutes ces précautions, on s'attendrait à ce que le CST, le ministère de la Défense nationale et d'autres organismes coopèrent pleinement avec les organismes d'examen. Malheureusement, et à notre grande consternation, ce n'est pas le cas.
Le CPSNR et l'OSSNR ont tous deux déploré à maintes reprises que le CST soit particulièrement lent à fournir de l'information, qu'il ne donne pas accès aux dossiers de manière à permettre des recherches et des vérifications indépendantes et qu'il nuise fondamentalement à la capacité de ces organismes de faire leur travail.
Par exemple, le CPSNR a affirmé que les ministères et organismes sur lesquels il se penche, y compris le CST, ont refusé de fournir des renseignements en se fondant sur des motifs qui ne sont pas prévus par la loi ou ont tout simplement décidé d'eux-mêmes de ne pas fournir des renseignements pertinents. L'OSSNR a indiqué que le CST n'avait pas su mettre en place un système pour lui permettre d'accéder à l'information de façon indépendante, de telle sorte que c'était le personnel du CST qui déterminait lui-même quels renseignements fournir à l'OSSNR, rendant ainsi tout examen indépendant impossible. L'OSSNR a également signalé des retards importants dans la communication de l'information par le CST, ce qui a nui à la progression des examens et allait à l'encontre des obligations juridiques du CST envers l'OSSNR.
Nous avons soulevé ces questions à maintes reprises, mais, trop souvent, il n'y a eu ni intervention ni mesure de reddition de comptes à l'égard de cette obstruction.
Ces préoccupations vont au‑delà du CST. Il est important de rappeler que l'un des événements qui ont mené à la création du CPSNR est la question controversée et jamais résolue du transfert de détenus afghans des Forces canadiennes à l'armée afghane, et ce, malgré des allégations et des témoignages crédibles sur des cas de torture et de mauvais traitements. Ces organismes de surveillance, aussi imparfaits soient-ils — et nous pouvons discuter des façons de les améliorer — sont là pour veiller à ce que de tels abus ne puissent pas se produire en secret.
Lorsque les organismes de sécurité nationale retiennent illégalement de l'information, font de l'obstruction et retardent les examens, et ce, sans subir de conséquences, cela pose un risque grave non seulement pour les libertés fondamentales, mais aussi pour la sécurité et la vie des personnes partout dans le monde.
Mon temps est limité. J'ai d'autres recommandations dont nous pourrons discuter.
Je vais conclure en disant qu'on a dépassé les délais prévus pour l'examen par des comités parlementaires au titre de la loi qui a mené à la création du CPSNR et de la loi qui a mené à la création de l'OSSNR et du CST, la Loi de 2017 sur la sécurité nationale. Mener ces examens pourrait être une façon de cerner les problèmes et de les résoudre.
Merci.
Merci, monsieur McSorley.
Nous allons maintenant passer à notre série de questions de six minutes.
Nous allons commencer par M. Kelly.
Allez‑y, monsieur Kelly.
Merci, monsieur Drapeau.
Lorsque j'étais un nouveau député, peu après l'élection de ce gouvernement qui a fait campagne en promettant l'ouverture par défaut et le gouvernement le plus ouvert et le plus transparent de l'histoire, j'ai assisté à une réunion du comité de l'éthique où vous avez témoigné. Lors de cette réunion, vous avez parlé de la motivation et du manque de motivation lorsqu'il s'agit de répondre pleinement aux demandes au sein du gouvernement. Vous avez dit:
C'est parce qu'ils comprennent, perçoivent les signaux. Ils interprètent les signaux du centre, du greffier du Conseil privé, du sous-ministre, du sous-ministre adjoint ou du directeur général.
Les conséquences sont plus grandes si vous faites du zèle dans la divulgation des dossiers qui sont demandés et que vous les traitez avec rigueur, en excluant seulement ce qui doit être exclu, alors que vous avez le pouvoir discrétionnaire de ne pas exempter certaines parties et de divulguer l'information. Elles sont moins grandes lorsque vous dites, retardez ou invoquez des exceptions et laissez les demandeurs recourir au mécanisme de plaintes.
C'était il y a huit ans. Dans quelle mesure les choses ont-elles changé?
Comme je l'ai dit, monsieur Kelly, il n'y a pas de conséquences. Si une demande ne donne pas lieu à la divulgation de documents ou si on n'y répond pas — les deux cas se produisent —, le demandeur peut déposer une plainte. S'il dépose une plainte, il doit attendre au moins un an — normalement, c'est deux ans — avant d'obtenir une décision, qui peut lui être favorable ou non. En fait, c'est le mécanisme de plainte qui fait défaut.
Au même comité, j'ai dit que nous devrions peut-être avoir l'audace de fixer un délai à la commissaire à l'information pour qu'elle rende une décision sur une plainte, disons, dans un délai d'un an.
La commissaire a dit devant de nombreux comités que son bureau manque désespérément de ressources pour faire ce que vous avez décrit parce qu'il est submergé par les plaintes.
Je ne suis pas d'accord.
Au même comité, j'ai dit que c'est l'un des tribunaux où la haute direction est la plus lourde. Il y a trois commissaires adjoints et de nombreux directeurs généraux pour un personnel de 90 personnes, plutôt que davantage d'enquêteurs.
Y a‑t‑il encore une culture du secret au sein du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes?
Je n'appellerais pas cela une culture du secret — ce serait trop méchant —, mais c'est de l'inefficacité. Appelez cela comme vous voulez; le système ne fonctionne pas. Je pense que vous auriez tort de vous pencher seulement sur le ministère de la Défense ou l'organisation. Ils essaient de faire de leur mieux avec les ressources dont ils disposent.
Le système d'accès à l'information coûte, je crois, 90 millions de dollars par année aux contribuables, et en ce qui concerne le budget prévu depuis environ un an, je peux vous dire que, parmi les systèmes ayant un budget de cette ampleur que je connais au Canada, c'est le seul qui n'a jamais fait l'objet d'une vérification ou d'un audit par un vérificateur général visant à déterminer si les divers bureaux responsables des demandes d'accès à l'information dans diverses organisations ont le personnel et les procédures nécessaires et à examiner la façon dont ils peuvent fournir le produit demandé. Ils sont laissés à eux-mêmes, et c'est un problème.
Merci.
J'aimerais continuer, mais je voudrais aussi entendre l'avis de M. Shimooka à ce sujet.
Monsieur Shimooka, en 2019, vous avez produit un rapport publié par l'Institut Macdonald-Laurier qui s'intitule The Catastrophe: Assessing the Damage from Canada's Fighter Replacement Fiasco. Vous avez expliqué comment la persécution politique du vice-amiral à la retraite Norman par le gouvernement a jeté un froid sur le MDN.
Pourriez-vous nous dire à quel point les dénonciateurs potentiels ont peur?
Certainement. Je ne parlerais même pas de dénonciateurs potentiels.
Comme je l'ai dit dans ma déclaration préliminaire, je pense qu'il y a eu une baisse générale de la volonté des membres du personnel permanent de parler des problèmes quotidiens. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas nécessairement de problèmes controversés, mais il est certain que les deux événements — soit, comme je l'ai dit, les accusations portées contre Mark Norman et la consigne du silence qui a été imposée, une mesure assez considérable qui n'a pas du tout été bien accueillie au sein du MDN — ont amené des gens à se demander s'ils devaient parler de ce genre de choses et si cela pouvait faire l'objet d'un examen. Je pense que cela a vraiment causé des problèmes à beaucoup de chercheurs, alors qu'auparavant, les personnes-ressources étaient disposées à parler ou à discuter...
Vous avez mentionné le problème au sein même des Forces armées canadiennes. Comment un manque de transparence affecte‑t‑il le moral au sein des Forces armées canadiennes?
Je pense que c'est important. Je pourrais vous parler de cas précis où des personnes ont été atterrées par ce qui s'est passé. Dans bien des cas, nous confions à ces personnes...
Absolument. Je peux penser à des cas précis où des gens sont partis à cause de la consigne du silence.
Merci.
Avez-vous encore des demandes d'accès à l'information en suspens qui remontent à 2019 ou à plus loin encore?
Oui. J'en ai une qui a été présentée au début de 2019 et qui porte précisément sur l'achat des Super Hornet. Je n'ai jamais reçu de réponse.
Est‑ce courant? À notre réunion de lundi, M. Bezan semblait être la seule personne au Canada à avoir une demande d'accès à l'information en suspens, mais c'est aussi votre cas.
Savez-vous s'il y en a d'autres? Est‑ce que certains de vos collègues de l'Institut Macdonald-Laurier ont des demandes d'accès à l'information en suspens depuis 2019?
Il faudrait que je me penche là‑dessus. J'ai entendu la réponse du ministre, et ces cinq demandes sont peut-être les seules qui existent, mais cela me surprendrait.
Merci, monsieur le président.
Je remercie les témoins.
J'aimerais adresser ma question à M. Drapeau et à M. Shimooka, si vous me le permettez.
Tout le monde autour de cette table veut assurer la transparence et la reddition de comptes et réduire les temps d'attente. Nous essayons de nous attaquer aux causes sous-jacentes de ces problèmes, et nous voulons nous assurer de résoudre le bon problème.
Si vous me le permettez, j'aimerais faire une brève mise en contexte. Je pense que tout le monde autour de la table se souvient probablement de l'époque où, presque du jour au lendemain, des ordinateurs compacts pouvant recevoir et envoyer des courriels sont apparus sur tous les bureaux dans nos lieux de travail. On promettait que cela allait rendre les choses plus efficaces, accélérer les communications et améliorer l'échange de renseignements. Je pense que nous savons tous que cela a donné lieu à une prolifération de l'information — trop de courriels, de communications —, et nous nous sommes vite rendu compte que cette multitude de courriels et ces ordinateurs sur tous les bureaux on fait en sorte que nous ayons non pas moins de travail, mais davantage.
Ce que j'essaie de dire, c'est que l'une des causes des retards que nous observons, qui est parfois perçue comme un manque de transparence, c'est la quantité incroyable de données. Lorsqu'on demande à voir les échanges entre plusieurs personnes, on se retrouve avec une multitude de courriels qui vont dans toutes les directions, et on peut comprendre qu'il faille beaucoup de temps pour trouver tout cela.
Monsieur Shimooka, vous avez dit que vous aviez eu une excellente expérience en 2002, que votre demande avait été traitée avec une grande rapidité qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Encore une fois, nous sommes dans une situation où il y a beaucoup plus de données.
Je me demande si l'un d'entre vous, monsieur Drapeau ou monsieur Shimooka, pourrait nous dire ce qu'il pense du fait que la multiplication des informations contribue au problème auquel nous devons faire face.
Cela fait partie du problème, mais certains problèmes peuvent comporter différents aspects. Par exemple, il n'y a aucune raison au monde qui puisse expliquer le fait de ne pas accueillir une demande d'accès qu'on a présentée légalement en payant des frais de 5 $ et de ne pas en accuser réception. En fait, je pourrais vous donner des chiffres sur certaines de nos demandes. Trois d'entre elles ont été envoyées en septembre dernier, et nous attendons toujours un accusé de réception. Il n'y a aucune excuse pour cela.
Même si on considère toutes les demandes, quand on y pense, il n'y en a pas tant que cela pour une population de 40 millions d'habitants. Quand on compare cela aux centaines de milliers de demandes que des organismes des États‑Unis reçoivent, on constate qu'il est possible de gérer cela, mais il faut avoir une certaine discipline. Accueillir une demande et en accuser réception, c'est un des aspects à considérer.
Pour ce qui est du système de 30 jours que nous avons en place, je n'y tiens pas absolument. Il faudrait peut-être changer cela. Il serait préférable de fixer un délai de 60 jours et de le respecter plutôt que de prévoir 30 jours, mais ne pas respecter l'échéance.
Le Commissariat à l'information n'a pas le droit inaliénable de continuer de travailler comme il le fait actuellement. Aux États‑Unis, on peut non seulement présenter une demande à un organisme, mais aussi porter plainte auprès de l'organisme, et si on ne reçoit pas de réponse dans un certain délai, on peut s'adresser aux tribunaux.
Bon nombre de mes clients — dont certains sont des entreprises — sont frustrés, car, lorsqu'ils présentent une demande légalement, non pas en remettant une enveloppe brune, mais en passant par le régime d'accès afin d'avoir accès à des documents, ils n'obtiennent pas de réponse, ou s'il y en a une, elle fait l'objet d'une exemption. Quand ils portent plainte auprès du commissaire à l'information, ils doivent attendre un, deux ou trois ans. Une grande société pourrait avoir hâte de s'adresser aux tribunaux pour que ceux‑ci puissent se prononcer, mais cela lui est impossible tant que le commissaire à l'information n'a pas produit de rapport. Cela doit changer.
Il faudrait peut-être aussi remettre en question la présence d'un commissaire à l'information. Est‑ce nécessaire dans les circonstances?
Consultez les données statistiques publiées par le Commissariat sur le nombre de documents qui ont été rendus publics depuis environ une décennie. Le nombre de documents n'a pas changé. Environ 10 000 pages ont été rendues publiques, et le nombre de demandes est resté à peu près le même. Il y a eu moins de questions au cours des dernières années.
Pour répondre à votre question, à savoir s'il y a eu ou non... Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a beaucoup plus de documents. Notre société de l'information produit plus de documents, mais cela ne se reflète pas vraiment dans le nombre de documents qui sont produits ou rendus publics actuellement.
Je ne connais pas exactement la nature du problème. Je sais qu'il y a eu des problèmes concernant les discussions sur WhatsApp, les messages textes et les autres éléments visés par les dispositions législatives sur l'accès à l'information. À mon avis, ce sont là d'autres difficultés auxquelles le cadre législatif actuel ne répond pas complètement ou dont il ne peut pas tenir compte entièrement.
Aux États‑Unis, il y a beaucoup plus de personnes en mesure de participer à ce genre de discussion. On n'a pas à demander au personnel de première ligne de faire du caviardage. Il y a des gens qui sont en mesure de le faire en dehors du processus d'élaboration des politiques.
Merci à vous deux.
On a dit que la multiplication des données fait partie du problème, mais que ce n'est pas le seul problème, alors nous devons savoir comment mieux traiter les données. Il y a d'autres aspects à considérer. Plusieurs témoins nous ont parlé de l'importance de moderniser les systèmes que nous utilisons. On pourrait notamment moderniser la technologie ou embaucher plus de personnel.
J'aimerais terminer là où j'ai commencé en essayant de trouver des solutions. Ma question s'adresse aux trois témoins. Auriez-vous des recommandations précises pour améliorer la transparence et les délais? Nous vous en serions très reconnaissants.
Lors de certaines réunions de comité, des gens ont dit qu'un certain nombre de demandes de 2019 sont toujours sans réponse. Rien ne peut justifier cela. J'ai aussi des demandes datant de 2019. Nous avons déjà attendu cinq ans. Il y a aussi des demandes datant de 2021. Pourquoi? Il y a des lacunes dans la bureaucratie qui sont liées aux demandes de la gestion. Je ne pense pas que le problème soit attribuable au volume.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Je remercie les témoins de leurs remarques d'ouverture.
Monsieur Shimooka, vous avez dit que, au cours des 20 dernières années, il y a eu une évolution quant à l'accès à l'information. J'aimerais connaître votre opinion sur la façon de formuler des demandes.
Par exemple, y a-t-il une évolution quant au libellé à privilégier pour obtenir un document précis? Est-ce de plus en plus difficile de réussir à mettre le doigt sur ce qu'on veut exactement? A-t-on besoin de numéros de dossiers précis? Doit-on faire une recherche préalable, qui est de plus en plus difficile, pour bien établir ce qu'on recherche en vue de l'obtenir correctement? Bref, est-ce à peu près la même chose depuis une vingtaine d'années?
J'invite aussi messieurs Drapeau et McSorley à ajouter des commentaires, au besoin.
[Traduction]
Je pense que c'est beaucoup plus complexe. D'après mon expérience, et le colonel Drapeau peut probablement vous en parler beaucoup mieux que moi, il faut souvent savoir très précisément ce qu'on essaie de trouver, y compris le nom et le numéro du document. Malgré cela, j'ai vu des cas d'exclusion qui ont nécessité un grief, car nous savons que ces choses existent.
Nous en sommes au point où le régime d'accès à l'information est davantage perçu comme étant axé sur la confrontation. Il est clair que le gouvernement, à l'interne, ne veut pas rendre l'information publique dans certains domaines, et il faut savoir exactement ce qu'on cherche pour obtenir ce dont on a besoin.
C'est mon expérience personnelle.
L'information que vous demandez doit être suffisamment détaillée pour qu'un membre expérimenté du ministère puisse comprendre de quoi il s'agit et donner suite à la demande.
Lorsque j'enseigne l'accès à l'information, j'informe les étudiants de ce qui doit être fait. Je leur dis de ne pas jouer au chat et à la souris, de dire exactement ce qu'ils veulent et de présenter ensuite une demande. Il faut faire une mise en contexte et dire, par exemple: « À une certaine époque, on a fait une étude. C'est cela qui m'intéresse. » Ainsi, il n'y a aucune ambiguïté possible quant aux documents que vous recherchez.
Un demandeur qualifié saura comment obtenir ces documents. Info Source, une source d'information produite chaque année par le Conseil du Trésor, fournit une foule de renseignements sur les programmes et sur d'autres sujets, et cela permet au demandeur de s'informer et d'expliquer précisément ce qu'il cherche.
[Français]
Merci.
Prenons l'exemple de M. et Mme Tout-le-Monde qui n'ont pas les moyens d'aller voir un spécialiste. Devrait-il y avoir un mécanisme plus simplifié pour les gens qui souhaitent avoir accès à l'information?
Devrait-on mettre en place une façon de faire plus universelle, plutôt que d'avoir un processus réservé à un certain groupe d'employés qui connaît bien ce processus et qui sait comment se servir de la Loi sur l'accès à l'information?
La loi prévoit déjà que les coordonnateurs de chaque équipe d'accès à l'information ont le devoir d'assister un demandeur qui n'a pas la capacité de s'exprimer correctement.
Merci beaucoup.
Au sujet de la responsabilité des fonctionnaires qui gèrent les demandes d'accès à l'information, ces derniers semblent avoir tendance à ne pas vouloir divulguer trop d'information, par crainte de représailles. De plus, souvent, ils ne sont pas particulièrement bien formés pour traiter des demandes d'accès à l'information. C'est une petite partie de leur travail, qui est plus large.
Devrait-on prévoir une forme d'impunité dans les cas où trop d'information serait dévoilée, pour éviter que les gens soient incités à garder le plus d'information possible?
Je parle des gens qui sont sur le plancher des vaches, ceux qui traitent les demandes dès le départ. Devrait-on corriger le tir pour s'assurer que les fonctionnaires ne craignent pas de subir des représailles s'ils dévoilent trop d'information?
Je ne pense pas que ce problème existe présentement. Les équipes qui s'occupent des demandes d'accès à l'information font un travail formidable, compte tenu du nombre de demandes et du peu de soutien qu'elles reçoivent de leurs ministères respectifs.
C'est pour cela que je dis qu'il faut absolument que le vérificateur général procède à un examen pour savoir si ces équipes ont les bons outils, le bon nombre d'employés, et ainsi de suite. Cela n'a jamais été fait et cela devrait être fait.
[Traduction]
Je suis d'accord.
Je dirais qu'en général, l'utilisation de ressources humaines pour l'élaboration des politiques n'aide pas. C'est un lourd fardeau pour le personnel du ministère qui, comme je l'ai dit, est surchargé. Il n'y a pas assez de personnes qui peuvent faire le travail. Dans leur travail quotidien, ils vont pécher par excès de prudence, surtout si c'est un travail secondaire qu'ils font en plus de leurs tâches principales.
En ce qui concerne la vérification, il faudrait peut-être consacrer plus de ressources au système d'accès à l'information afin d'obtenir de meilleures réponses.
[Français]
Serait-ce une bonne solution d'affecter des gens exclusivement au traitement des demandes d'accès à l'information et de s'assurer que cela n'est jamais fait par des gens qui ont aussi d'autres tâches?
Je pense que la plupart des gens qui font ce travail présentement, en tout cas, ceux qui travaillent dans les bureaux d'accès à l'information, se consacrent exclusivement à cette tâche.
Monsieur McSorley, ma prochaine question concerne le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, ou CPSNR, et l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, ou OSSNR.
L'été dernier, M. David McGuinty a mentionné qu'il y avait des problèmes liés au fait que le gouvernement retenait plusieurs documents. J'aimerais avoir vos observations sur les solutions qu'on pourrait envisager, peut-être sur le plan juridique, afin que le CPSNR ait le pouvoir de réclamer ces documents. À moins que je vous aie mal compris au début de vos remarques liminaires, il n'y a pas vraiment de mécanisme, présentement.
Mon temps de parole étant écoulé, vous pourrez me répondre au deuxième tour de questions.
[Traduction]
Merci, madame Normandin. Je vous remercie de respecter le temps imparti.
Monsieur McSorley, vous avez quelques minutes pour réfléchir à cette question maintenant.
Madame Mathyssen, vous avez six minutes.
Ce sera peut-être un peu moins que quelques minutes, parce que c'est moi qui pose la question, comme d'habitude.
Monsieur McSorley, je pense que cela fait partie des recommandations dont vous avez parlé et que vous n'avez pas eu le temps de formuler dans votre allocution d'ouverture. En ce qui concerne le mécanisme d'examen requis et la nécessité d'un contrôle parlementaire accru, pourriez-vous nous en parler pour répondre à nos deux questions?
Je pense qu'il y a plusieurs possibilités.
Nous sommes convaincus que le CPSNR et l'OSSNR devraient avoir plus de pouvoir pour exiger des documents. À l'heure actuelle, les organismes sont tenus par la loi de fournir les documents dès que possible et d'y donner accès, mais aucune conséquence n'est prévue. Un peu comme pour le commissaire à la protection de la vie privée, nous aimerions que l'on étudie la possibilité de faire en sorte que ces organismes respectent leur travail. Ainsi, il faudrait s'adresser aux tribunaux pour obtenir des ordonnances exécutoires afin que les organismes fournissent les documents dont ils disposent ou qu'ils respectent les lignes directrices en vigueur.
Pour le CPSNR, en particulier, l'une des questions qui se posaient lors de sa création, c'était qu'il s'agissait d'un comité de parlementaires et non d'un comité du Parlement, et que sa capacité à s'exprimer au Parlement de même que son privilège parlementaire étaient limités. D'ailleurs, une procédure judiciaire est en cours à cet égard. Il s'agit d'une contestation constitutionnelle. Nous pensons que le fait d'en faire un comité du Parlement permettrait aux députés de s'exprimer plus librement et de soulever davantage de questions.
À l'heure actuelle, si l'on examine les rapports du CPSNR, on constate qu'ils sont même limités dans ce qu'ils peuvent dire à savoir qui retient quel type d'information et où ils veulent en venir. Nous pensons que le fait de changer la nature du comité et d'en faire une révision constituerait une autre façon d'aborder cet enjeu.
Enfin, l'autre aspect porte sur les ressources dont ils disposent. Le CPSNR et l'OSSNR pourraient tous les deux obtenir davantage de ressources pour travailler encore plus étroitement avec les organismes afin de développer ces relations. Ils ont affirmé qu'ils ont parfois l'impression de faire face à de l'obstruction ou encore qu'il s'agit d'établir des relations au sein des organismes de sécurité nationale afin d'avoir un meilleur accès à ces documents. Des ressources supplémentaires pourraient également contribuer à amoindrir cet enjeu.
Monsieur McSorley, vous avez parlé dans votre allocution d'ouverture des énormes difficultés que nous avons vécues avec le transfert des prisonniers afghans, c'est‑à‑dire la torture, le secret et le manque de transparence à cet égard. On a ensuite vu la même chose se répéter dans l'affaire de la Somalie. Les parallèles sont nombreux.
Les documents relatifs au transfert des prisonniers afghans n'ont toujours pas été publiés. L'affaire de la Somalie a donné lieu à des appels en faveur de la création d'un organisme civil indépendant de surveillance ayant le pouvoir d'exiger des documents et, une fois encore, de faire rapport au Parlement.
J'aimerais entendre les observations des trois témoins, puisque vous vous êtes tous exprimés sur la nécessité d'une plus grande surveillance civile de l'armée. Que pensez-vous de la création d'un organisme indépendant de surveillance?
Nous sommes tout à fait favorables à la création d'un nouvel organisme civil de surveillance pour le ministère de la Défense nationale.
Les mandats du CPSNR et de l'OSSNR sont limités à la sécurité nationale, et il y a de toute évidence des questions de défense plus larges qui ne relèvent pas de ces mandats, même s'il y a recoupement. Il faudrait travailler sur la manière dont ils peuvent interagir en matière d'accès à l'information.
Même à l'heure actuelle, nous pensons que le CPSNR serait mieux à même de faire face à une situation comme le scandale du transfert des prisonniers afghans, mais en même temps, des restrictions demeurent à la fois du point de vue de son mandat et du type de renseignements auxquels il a accès. Cela pourrait l'empêcher de mener une enquête approfondie, même si quelque chose du genre devait se produire aujourd'hui. Ce serait beaucoup mieux et beaucoup plus limpide... À mon avis, il n'en résulterait pas les mêmes types de querelles politiques qu'à l'époque, quoiqu'il y ait encore des lacunes qu'un organisme civil de surveillance pour le ministère de la Défense nationale serait en mesure de combler.
Le rapport d'enquête sur la Somalie, qui a été préparé par mon ami le juge Létourneau, recommandait la création d'un inspecteur général. Il a également recommandé la création d'organismes de surveillance: le comité militaire des griefs externes et la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire.
Ces organismes ont été créés. Cependant, au cours des deux dernières années, au lieu de les considérer comme des organisations civiles indépendantes, les dirigeants de chacun de ces deux organismes sont des juges-avocats généraux à la retraite. Or, qu'ils conservent ou non leur indépendance, ce n'est pas la façon dont j'aurais voulu que les choses se passent.
Il nous faut assurément un organisme de surveillance indépendant qui rende compte au Parlement en tant qu'agent du Parlement, à savoir un inspecteur général. On peut lui donner le nom qu'on veut, mais c'est ce qui a été recommandé, et je maintiens cette recommandation.
Je proposerai rapidement un point de vue différent. Le type d'organisme qu'on crée ou la manière dont il est organisé n'est pas nécessairement au cœur de la question. Je pense que la question est de savoir quel pouvoir on donne à cet organisme.
Prenons l'exemple des États-Unis, de la façon dont fonctionnent les comités du Congrès et de l'efficacité avec laquelle ils obtiennent des réponses de la part des représentants des ministères. De toute évidence, le Congrès a beaucoup plus de pouvoir que ces comités, mais on obtient une réponse beaucoup plus claire et décisive, alors qu'au Canada, j'ai vu plusieurs représentants ministériels témoigner devant un comité — celui‑ci ou celui des opérations gouvernementales — en brouillant quelque peu la question sur laquelle ils étaient interrogés ou en ne fournissant pas les réponses qu'ils devraient être tenus d'apporter.
Pour tout organisme de surveillance, il s'agit vraiment d'être en mesure d'obtenir les renseignements voulus, d'avoir du pouvoir et d'imposer des conséquences en cas d'absence de réponse directe.
Merci.
Nous passons maintenant à la deuxième série de questions.
Madame Gallant, vous disposez de cinq minutes.
Monsieur Drapeau, joyeux anniversaire.
Je vais faire appel à votre expérience dans les affaires d'agression sexuelle.
Le gouvernement — c'est‑à‑dire le Parti libéral — a fait volte-face sur la recommandation de la juge Arbour selon laquelle toutes les affaires d'agression sexuelle devraient être traitées par les tribunaux civils. Cela étant dit, je me demandais quelle était votre expérience en ce qui concerne le transfert des dossiers de la police militaire aux tribunaux civils et quand cela se fait. Dans les affaires impliquant des militaires, les enquêteurs de la police militaire ont-ils déjà exclu certaines parties des transcriptions des entretiens avec la victime ou l'accusé?
Non, pas que je sache. Il se peut que cela se soit produit.
J'ai une opinion bien arrêtée sur le transfert des affaires d'agression sexuelle à des civils. Voilà 13 ans que je plaide en ce sens.
En ce qui concerne la qualité des vidéos dans les affaires d'agression sexuelle, avez-vous déjà eu l'occasion de constater qu'il manquait des parties à une vidéo de l'entretien avec la victime ou l'accusé, c'est‑à‑dire qu'elle n'était pas complète lorsqu'elle a été remise aux autres avocats?
Je n'en sais rien. Je soupçonne que cela s'est produit, mais il est difficile de le savoir à moins de disposer de la vidéo. Si l'on ne dispose pas d'une partie qui a été caviardée, on n'a aucun moyen de savoir si c'était répréhensible ou inutile.
J'aimerais que vous vérifiiez également auprès de vos partenaires qui peuvent être impliqués dans ces affaires. Y a‑t‑il des cas où vous savez qu'il y a eu une coupure dans la vidéo, qu'elle a été reconstituée ou que des parties en ont été retirées?
D'après votre expérience, est‑il arrivé que des prélèvements d'ADN ne soient pas effectués après une agression sexuelle?
Connaissez-vous des cas où les prélèvements d'ADN n'ont pas été comparés à l'ADN de la personne accusée de l'agression?
Connaissez-vous des cas où l'accusé n'a pas subi de tests de dépistage de maladies transmissibles sexuellement?
Pas que je sache.
Je représente en ce moment même une victime de viol, et aucun prélèvement d'ADN n'a été effectué parce qu'aucun test de ce type n'était disponible lors du déploiement à l'étranger.
D'accord. C'était lors d'un déploiement et pas nécessairement dans un centre de formation au Canada.
Dans les affaires impliquant l'armée, avez-vous déjà constaté que des pseudonymes ou des mots codés ont été utilisés pour dissimuler des preuves?
Je suppose que c'est le cas. Dans le cas du vice-amiral Norman, les médias en ont parlé. Cela ne m'étonne donc pas du tout. Il est courant que les militaires utilisent un langage codé dans le cadre de diverses opérations et dans diverses circonstances. Je ne suis donc pas choqué par une telle utilisation. Ce qui me choque, c'est de l'utiliser de manière inappropriée ou illégale.
Comment les militaires peuvent-ils être protégés contre les représailles de leurs supérieurs lorsqu'ils demandent l'accès à l'information?
Très bien.
Quels sont les défis auxquels les membres du ministère de la Défense nationale ou des Forces armées canadiennes sont confrontés lorsqu'ils souhaitent dénoncer des actes répréhensibles?
Ils doivent eux aussi faire appel à un avocat.
Tout d'abord, la loi qui encadre les actes répréhensibles — dont j'oublie la désignation — exclut les militaires, qui ne bénéficient d'aucune protection s'ils veulent dénoncer quelque chose. La culture du milieu veut que les militaires passent par la chaîne de commandement, qui peut en réalité être en cause. Dans ce cas — et je ne plaisante pas —, ils doivent s'adresser à un conseiller juridique pour connaître la marche à suivre.
Faut‑il vraiment qu'un membre des Forces armées canadiennes assume des frais juridiques pour exposer un acte répréhensible?
C'est de plus en plus le cas. Certains éléments de mon mémoire le suggèrent. Le militaire est laissé à lui-même dans l'armée ou dans les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes et ainsi de suite, à moins de faire appel à un conseiller juridique pour défendre ses droits. Il n'y a pas de syndicat ni d'organisme pour parler en votre nom. Le militaire est laissé à lui-même, et, le seul moyen dont il dispose, c'est de déposer un grief qui doit passer par la chaîne de commandement.
Merci, monsieur le président.
J'aimerais remercier tous les témoins de leur présence pour répondre à nos questions.
Je commencerai par M. Drapeau.
Vous avez parlé brièvement du processus des griefs des Forces armées canadiennes. On nous a dit au Comité qu'il s'agissait d'un problème, que ce processus prenait beaucoup de temps et que s'il était amélioré, la transparence et la confiance au sein des Forces armées canadiennes s'en trouveraient elles aussi améliorées.
Je vous demande si vous avez des recommandations ou des suggestions en particulier — qui ne concernent pas nécessairement la commissaire à l'information ni les autres commissaires, car je poserai une question à ce sujet par la suite — sur la manière d'améliorer le processus des griefs en ce qui concerne l'accès à l'information ou aux ressources.
Si votre question porte sur l'amélioration du processus des griefs par rapport à l'accès à l'information, je ne pense pas que les deux soient liés. Je veux dire qu'ils ne le sont pas. En tant que demandeur, vous n'êtes pas obligé d'être militaire. Si vous n'êtes pas militaire, vous n'avez pas accès au processus des griefs. Vous n'avez accès qu'au processus de plainte. Les deux ne sont pas liés.
Supposons que je sois le sous-ministre de la Défense pour une journée et que je veuille essayer d'examiner la résilience. Je suivrais certainement mes recommandations en demandant à un vérificateur de l'examiner. Que fait‑on? Quelle est la charge de travail? Quelle est la meilleure façon de procéder? Quel système doit être modifié? Quels sont les niveaux décisionnels à attribuer au personnel de l'accès à l'information? Il s'agit de tout cela, y compris de savoir s'il est nécessaire ou non d'exiger des frais d'accès de 5 $. Est‑ce vraiment nécessaire? Cela crée de la bureaucratie, des dépenses et ainsi de suite.
Je pense qu'il faut revenir aux principes de base. Cela ne peut se faire au sein d'une organisation ou d'une institution. Il faut le faire à l'échelle du système. En 2024, devons-nous vraiment insister sur un délai de publication de 30 jours? Est‑ce raisonnable de nos jours? Je préférerais avoir 60 jours et m'y tenir plutôt que d'avoir 30 jours qui finissent par devenir 90 ou 120 jours. Il nous faut quelque chose d'aussi simple que cela.
Cela améliorera également le moral du personnel de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. On peut imaginer ces personnes, des gens bien, se rendant au travail en sachant qu'elles ont une tâche impossible à accomplir pour satisfaire leur patron, leurs clients, les décrets et ainsi de suite, parce qu'elles ont la tâche impossible d'essayer d'obtenir des documents, de les examiner et de les publier dans un délai de 30 jours.
Vous avez également dit que, l'un des principaux problèmes, c'est que le Commissariat à l'information et le Commissariat à la protection de la vie privée prennent jusqu'à un an, voire plus, pour mener à bien une enquête.
Il faut compter plus d'un an.
Vous avez laissé entendre une chose avec laquelle je ne suis pas certaine d'être d'accord. J'aimerais vous demander ce que vous voulez dire ou quelles solutions de rechange vous pensez qu'il pourrait y avoir.
Vous avez dit que le Commissariat à l'information n'était pas nécessairement un commissariat. Je me demande si vous avez envisagé d'autres moyens par lesquels le gouvernement pourrait se doter d'un organisme pour rendre des comptes...
En 1997, un livre vert du Parlement sur l'accès à l'information a examiné diverses options. Devrions-nous avoir un commissaire de type ombudsman ou faire comme les États-Unis? Nous avons choisi d'avoir un commissaire à l'information.
Le Commissariat à l'information de l'époque, avec M. Grace, John Reid et d'autres, était une organisation différente de celle d'aujourd'hui. À l'époque, près de 90 % du personnel était composé d'enquêteurs. Ils réalisaient des enquêtes. Ils s'adressaient aux organisations pour examiner les documents, pour en vérifier la présence et pour savoir s'ils avaient été publiés adéquatement. Ensuite, l'organisme a été déménagé à Gatineau. Tout se fait par courriel ou par téléphone. La plupart des membres du personnel s'occupent maintenant des documents administratifs. Il s'agit d'une structure de gestion très lourde qui réduit le nombre d'enquêteurs. Je me pencherais également sur cette question.
Voilà quelques bonnes suggestions. Avez-vous des suggestions précises? Si nous devions rédiger des recommandations sur la manière d'améliorer ce processus, que diriez-vous?
La première chose que je ferais si je pouvais le faire simplement en claquant des doigts — ce qui serait le cas avec une petite modification de la loi —, c'est de confier au commissaire à l'information la tâche de rendre ses décisions dans un délai d'un an. Si l'on demande aux organisations de publier des documents dans un délai de 30 jours, on peut sûrement demander au commissaire à l'information de faire son travail dans un délai d'un an. Si un an s'écoule sans qu'une décision soit rendue, on aurait alors le droit de s'adresser à la Cour fédérale au besoin.
[Français]
Merci beaucoup.
Monsieur Drapeau, j'aimerais revenir sur les questions que Mme Lambropoulos a posées, parce que j'ai peut-être mal compris quelque chose. Vous me corrigerez si je me trompe.
J'ai cru comprendre que, lorsqu'un grief est en cours, cela peut prendre des années, parce que c'est le chef d'état-major qui va rendre la décision. Or, pendant ce temps, il n'est pas possible de faire de demande d'accès à l'information sur le dossier.
Est-ce exact?
D'accord, merci.
Peut-on supposer que, dans le contexte du transfert des demandes vers le civil pour les cas d'inconduite sexuelle, le fait que le dossier soit judiciarisé au civil n'empêchera pas non plus de faire des demandes d'accès à l'information?
Cela ne devrait pas poser de problème. Est-ce bien le cas?
D'accord, je vous remercie. J'avais mal saisi; je voulais être sûre d'avoir la bonne information.
Monsieur Shimooka, j'aimerais vous entendre parler du niveau de déclassification qui existe dans d'autres pays par rapport à ce qui se passe ici. Pour des dossiers plus anciens, il y a la règle prescrivant un délai de 50 ans ailleurs.
Peut-on comparer le Canada à des pays du Groupe des cinq? Où en est-on en cette matière? Y a-t-il du rattrapage à faire? Pouvez-vous formuler des recommandations à cet égard?
J'aimerais vous entendre parler de cette question de façon plus large.
[Traduction]
Je tiens à souligner que je suis tout à fait d'accord avec le colonel Drapeau lorsqu'il parle du délai de 30 jours au lieu de 60 ou 90 jours. Je pense que le délai de 30 jours est censé être l'un des plus rapides. Lorsqu'il y a prolongation après prolongation, comme vous l'avez dit, je préférerais avoir la documentation... pour bien faire les choses à un certain moment plutôt que d'avoir ce processus spécial.
Un élément qu'on a pu constater dans la discussion, en particulier aux États-Unis avec ce qui s'est passé avec Snowden et d'autres, c'est la question de savoir si tout cela doit être classifié. Quelle proportion de la documentation devrait vraiment être classifiée?
Je sais que le système finlandais stipule spécifiquement que rien n'est classifié à moins d'être spécifiquement défini comme tel. Cela change la dynamique du fardeau qui pèse sur l'accès à l'information. Je pense que le Canada a, en théorie, un processus libéral très poussé à cet égard. Je ne le dis pas dans un sens négatif, mais dans le sens où il devrait fournir la documentation rapidement, ce qui n'est pas le cas dans la pratique. Le processus comporte les problèmes dont nous avons discuté aujourd'hui.
Monsieur Drapeau, je crois que Mme Gallant a commencé à poser des questions sur le transfert au système civil des dossiers d'infractions criminelles d'ordre sexuel traités par les militaires. Le ministre a promis une mesure législative pour résoudre ce problème. J'ai d'ailleurs un projet de loi qui pourrait être adopté rapidement à cet égard.
Pouvez-vous indiquer au Comité les modifications législatives que vous jugez nécessaires pour préserver l'indépendance de ces enquêtes et assurer leur transparence?
Pour passer à la compétence des tribunaux civils, il faut modifier l'article 70 de la loi en y ajoutant une seule ligne à l'endroit où ils n'ont pas la compétence requise. Cela peut être fait en trois minutes. C'est très simple.
Dès lors, les victimes pourraient appeler le 411. Si une victime d'agression signale le crime, on laisserait les autorités civiles fédérales, provinciales ou municipales enquêter et les tribunaux se chargeraient du dossier. Ce n'est pas de la magie noire. Jusqu'en 1999, les agressions sexuelles ne relevaient pas de la compétence des forces armées. Du jour au lendemain, à la suite de l'enquête sur la Somalie, dans la loi adoptée en 1998 qui est entrée en vigueur en 1999, le ministère de la Défense nationale a hérité de la responsabilité des dossiers d'agression sexuelle.
À l'époque, la police militaire n'était pas du tout formée dans ce sens. Les juges n'avaient jamais reçu de formation. Les procureurs n'avaient jamais plaidé de cas d'agression sexuelle. Ce fut une sorte d'épisode d'apprentissage qui s'est étalé sur plusieurs années. Au cours de ce processus, les victimes ont perdu confiance dans l'indépendance et les compétences de la police militaire et des procureurs.
Je pense que le temps a montré — et les juges Fish et Arbour ont été très éloquents à ce sujet — que le transfert devait être effectué et que le plus tôt serait le mieux.
Cependant, un problème subsiste. Les affaires commencent maintenant à être traitées dans le système civil. Celles qui ont été entamées dans le système de justice militaire sont alors perdues. L'absence de mesure législative à cet égard a été considérée comme un élément de ce problème. L'avez-vous constaté dans votre pratique?
C'est le cas. Certains de nos clients sont essentiellement tiraillés entre les deux systèmes. Cela ne fonctionne pas.
Oui, mais il y a d'autres aspects dont on ne parle pas. Si la cause d'une victime d'agression sexuelle est instruite par le système militaire, la victime doit comparaître devant une cour martiale. Or, cette dernière se déroule dans le secteur de l'accusé. Lorsque la victime témoigne devant le public, celui‑ci est composé de ses collègues avec lesquels elle continuera à servir pour le reste de sa carrière. Le déroulement de l'audience et le comportement ou les réactions de la victime n'ont rien de confidentiel. C'est quelque chose qu'on ne souhaiterait à personne.
Merci, monsieur le président.
Je tiens à remercier nos témoins de leur présence aujourd'hui.
J'aimerais éclaircir quelques points.
Colonel Drapeau, vous avez indiqué avoir servi, à la fin de votre carrière militaire, dans les bureaux du quartier général. L'une de mes demandes d'accès à l'information à laquelle je n'ai pas encore reçu de réponse portait sur quelque chose d'assez simple, à savoir le changement de politique apporté au « Chapitre 205 — Indemnités des officiers et militaires du rang » et aux « Directives sur la rémunération et les avantages sociaux. ».Pourquoi semble‑t‑il difficile d'obtenir une réponse? J'ai déposé cette demande le 13 octobre 2017.
Il n'y a aucune raison pour que ces renseignements ne m'aient jamais été transmis.
Monsieur Shimooka...
Il est possible que si la publication en question est publique, les demandes d'accès à l'information ne s'y appliquent pas.
À l'époque où nous avons demandé ces renseignements, nous avons cru comprendre qu'ils n'étaient pas publics. Bien qu'ils le soient peut-être aujourd'hui, ils ne nous ont toujours pas été communiqués. Le 17 janvier de cette année, soit six ans et demi après la demande, on nous a confirmé que celle‑ci n'avait toujours pas été traitée.
Monsieur Shimooka, vous avez indiqué que les renseignements relatifs au dossier des avions de chasse faisaient l'objet de consignes de non-divulgation sans précédent. Vous avez également rédigé un rapport sur l'ébauche du troisième rapport du vérificateur général intitulé « La force aérienne de combat du Canada — Défense nationale ». J'ai fait une demande d'accès à l'information afin d'obtenir les notes de service, les courriels, la correspondance et les notes d'information concernant le rapport du vérificateur général et le projet de rapport sur la flotte d'avions de chasse du Canada. Cette demande a été reçue le 6 mars 2019. Je n'ai toujours reçu aucune confirmation que cette demande suit son cours.
Pouvez-vous expliquer en détail si vous avez traité des demandes d'accès à l'information sur ce rapport, l'étude que vous avez faite et, enfin, les effets des consignes de non-divulgation sur votre travail à titre d'analyste des politiques?
Ce n'est pas le cas, et je ne m'étendrai pas sur le sujet.
À mon avis, en ce qui concerne l'ordonnance de non-divulgation — et je donnerai plus de détails à ce sujet —, celle‑ci était sans précédent dans la mesure où la plupart des membres des Forces armées canadiennes qui travaillent dans ce domaine savent déjà très bien ce qui est confidentiel et ce qui ne l'est pas. Nous leur donnons accès à des renseignements techniques très délicats et hautement confidentiels, et le fait qu'une politique de non-divulgation leur soit imposée a eu une incidence sur la manière dont ils percevaient leur travail et leur fonction. Je pense qu'en général, un grand nombre d'entre eux sont convaincus de l'importance de leur travail et de leur rôle, compte tenu de leur ancienneté dans l'armée ou dans la fonction publique.
Dans le cas précis du dossier des avions de chasse et des circonstances qui l'ont entouré, que je décris en détail dans le rapport, cela a été perçu comme sans précédent. Comme le colonel Drapeau l'a expliqué à plusieurs reprises, les membres des forces armées n'avaient pas la possibilité de sortir de leur chaîne de commandement. Je pense que c'est ce qui a commencé à poser problème, car cela a changé la façon dont les militaires percevaient leur poste. Au Canada, nous n'avons tout simplement pas cette culture de fuites.
Il y a déjà la Loi sur la protection de l'information et la Loi sur la défense nationale. Sachant que les membres des Forces armées canadiennes et les employés de la Défense nationale doivent obtenir différentes cotes de confidentialité, pourquoi avoir recours à des accords de non-divulgation?
Ma question s'adresse à M. McSorley et à M. Drapeau. S'agit‑il d'ordonnances de non-divulgation? Est‑ce nécessaire pour assurer la sécurité nationale? Les lois en vigueur ne prévoient-elles pas déjà ce degré de protection et ne permettent-elles pas à ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité nationale de faire preuve de jugement et de prendre eux-mêmes ce type de décision?
Cela revient à peu près à ce que vous avez dit. Lorsqu'ils sont recrutés, les membres des Forces armées doivent notamment prêter un serment de loyauté envers la Couronne et...
Monsieur McSorley, considérez-vous que le recours à un accord de non-divulgation constitue un bâillon?
C'est ce qu'il nous semble. Comme le colonel Drapeau vient de l'expliquer, en plus de ce que vous avez indiqué, les membres des Forces armées doivent prêter serment. Ce qu'ils peuvent communiquer est déjà très limité, et il semble donc qu'un accord de non-divulgation revienne à un bâillon.
Merci, monsieur le président.
Bienvenue aux témoins.
Monsieur Drapeau, pendant près d'un quart de siècle, j'ai travaillé dans le cadre du régime de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de l'Ontario. L'une des principales critiques dont cette loi faisait l'objet était que celle‑ci n'avait pas été mise à jour depuis des dizaines d'années. La loi équivalente à l'échelon fédéral fait l'objet des mêmes critiques. J'aimerais connaître votre avis, car vous connaissez bien ces démarches. À quelle fréquence ces lois doivent-elles être mises à jour?
Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Sur le plan structurel, le projet de loi initial était l'une des meilleures mesures législatives que j'aie connues. Bien qu'il soit possible de se pencher sur certains aspects clés de celle‑ci, comme la règle des 30 jours et la nécessité d'imposer un délai au commissaire à l'information, je pense qu'il faut s'en tenir à l'essentiel et à la simplicité. C'est une loi quasi constitutionnelle que le grand public a tout intérêt à connaître et à pouvoir invoquer. Les citoyens doivent pouvoir faire une demande depuis le confort de leur foyer et payer les frais de 5 $. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de compliquer les choses; au contraire, il faut les simplifier.
En ce qui concerne la fréquence des mises à jour, je crois que la loi provinciale fait allusion à des CD‑ROM et à d'autres supports obsolètes...
La mesure législative renferme normalement une disposition qui prévoit que la loi soit revue tous les cinq ans environ, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de compliquer les choses. Aujourd'hui, cette loi est presque encombrante en raison de sa complexité.
D'accord.
Aujourd'hui, on a fait de nombreuses comparaisons avec des lois similaires dans d'autres pays. Y a‑t‑il des leçons à tirer des pays qui se heurtent aux mêmes problèmes en matière d'accès à l'information et de ceux qui font ce qu'il faut?
Je pense que oui. À la lumière de votre réflexion, la loi canadienne ne fonctionne pas. Pour quelqu'un qui fait une demande en vertu de cette loi quasi constitutionnelle, elle ne permet pas d'obtenir les résultats visés. Il faut refaire nos devoirs et déterminer ce qui doit être modifié. Il ne s'agit pas de tout modifier, mais de modifier uniquement les aspects qui l'exigent.
Je reviendrai sur le délai de 60 jours. Celui‑ci permettrait peut-être de mieux répondre aux besoins du public que le délai de 30 jours. Il faut non seulement répondre aux besoins du public, mais il faut aussi fixer un objectif réaliste pour les membres du Bureau d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.
Monsieur, à de nombreuses reprises, vous avez souligné l'importance de rendre l'information rapidement et librement accessible. Dans le cadre de mes fonctions aux échelons provincial et fédéral, j'ai pu constater l'importance de rendre l'information accessible. Les données ouvertes sont d'autant plus importantes que nous essayons aujourd'hui de trouver des moyens de soutenir les médias traditionnels. Bien entendu, les journalistes ont pour mission d'obliger le gouvernement à rendre des comptes et à informer le public afin de renforcer la démocratie et la confiance de la population dans le gouvernement. Si cette information n'est pas rapidement et librement accessible...
Je constate qu'avec l'évolution de la technologie, de plus en plus de gens se tournent vers d'autres sources d'information. Ils se tournent vers les médias sociaux, qui, comme nous le savons, ne sont pas des médias à proprement parler.
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de l'importance des délais, un point sur lequel vous avez insisté à plusieurs reprises aujourd'hui? En quoi est‑il important de veiller à ce que les médias traditionnels soient en mesure d'informer le public?
C'est absolument essentiel. C'est l'un des principaux aspects de la protection de la primauté du droit. Nous ne souhaitons pas retourner à l'époque des enveloppes brunes et des personnes qui se sentaient obligées de laisser filtrer de l'information pour attirer l'attention sur certains dossiers. Quiconque doit pouvoir exercer son droit quasi constitutionnel d'accéder aux documents du gouvernement dans un délai d'environ 30 jours, ce qui devrait être la règle et non l'exception. Actuellement, ce n'est pas le cas.
Il y a quelques semaines, nous avons reçu une réponse à quatre demandes, indiquant que l'organisme avait reçu l'autorisation de prolonger 1000 fois le délai de 60 jours. Qu'avons-nous fait? Nous avons dû porter plainte au commissaire à l'information. Il faudra deux à trois ans pour obtenir l'information que nous avons demandée.
Il n'y a là aucune divulgation. Cela revient à créer une voie parallèle pour accéder à l'information. C'est ce qui arrivera.
J'ai une dernière question, très brève, sur les coûts. Je sais que, par le passé, vous avez formulé des recommandations sur la modification de la structure tarifaire pour les demandeurs. Pouvez-vous nous faire part de vos recommandations à cet égard?
Étant donné qu'il s'agit d'un des rares droits quasi constitutionnels dont jouissent les Canadiens, je ne crois pas qu'il faille imposer des frais. Je pense qu'on ne devrait pas facturer de frais aux demandeurs. C'est le gouvernement qui devrait en assumer le coût. C'est déjà ce qu'il fait dans une certaine mesure, car une demande coûte bien plus que 5 $. En fait, traiter le paiement des frais de 5 $ coûte probablement autant au gouvernement.
Merci, monsieur Collins.
Cela conclut la deuxième série de questions. Pour la troisième série de questions, M. Fast, Mme Lalonde, Mme Normandin, Mme Mathyssen, M. Bezan et M. Fisher auront la parole.
Monsieur Fast, vous avez cinq minutes. En passant, je vous souhaite la bienvenue au Comité.
Je suis heureux d'être ici.
Monsieur Shimooka, en 2019, l'Institut Macdonald‑Laurier a publié un rapport sur les dommages causés par le fiasco du remplacement des chasseurs canadiens. Vous en êtes l'auteur. Vous y expliquez comment les poursuites politiques engagées contre le vice‑amiral à la retraite Mark Norman ont dissuadé les dirigeants du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes de dénoncer les décisions qui ont été prises dans le dossier des avions de chasse, ce qui risque de nuire irrémédiablement à la force aérienne de combat.
Pourriez-vous expliquer en détail dans quelle mesure cela a dissuadé les dénonciateurs du ministère de la Défense et des Forces armées canadiennes?
C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans une certaine mesure. Cela nous ramène à la discussion que j'ai eue avec M. Bezan et aux réponses que le colonel Drapeau a données. Les membres des Forces armées canadiennes sont certainement au courant de leurs droits. Ils connaissent les exigences de leur poste et sont très pointilleux à ce sujet. Comme j'ai tenté de l'expliquer plus tôt, au Canada — contrairement à d'autres pays, comme les États‑Unis ou le Royaume‑Uni —, il n'existe pas vraiment de culture d'enveloppes brunes et de fuites de documents dans le but d'influencer les politiques ou les perceptions du public.
Je pense que le caractère astreignant du bâillon qui a été imposé a amené de nombreux employés de ce ministère à remettre en question le degré de confiance qui leur était accordé, sachant qu'ils servent leur pays en acceptant une responsabilité illimitée, et ils ont très mal pris ce qui s'est passé. C'est ce qui est ressorti de mes entretiens avec des personnes qui étaient visées par ce bâillon, ou qui considéraient déraisonnable que d'autres employés y soient soumis.
Non, il s'agit du bâillon qui visait les employés qui participaient au projet de capacité des futurs chasseurs, dont l'objectif était de remplacer les CF‑18, et dans le cadre duquel on a fini par acheter des F‑35. Je crois que cela visait également les employés qui participaient à l'achat des Super Hornets, un projet provisoire, et plus tard, à l'achat des F/A‑18A excédentaires de l'armée de l'air australienne.
D'accord.
Professeur Drapeau, vous avez fait allusion aux dénonciateurs. Vous avez indiqué que les dénonciateurs devraient faire appel à des conseillers juridiques afin de donner suite à leurs plaintes, ce qui, bien entendu, entraîne des frais.
À votre avis, que pourrait‑on faire pour remédier au problème des frais juridiques, qui dissuadent les dénonciateurs d'aller de l'avant alors qu'ils devraient probablement le faire?
Je l'ignore, à moins que les conseillers juridiques aient accès à une autre source de financement pour prendre en charge ces coûts.
Il me semble contre-productif d'imposer des coûts à des dénonciateurs, sachant que cela les empêcherait ou les dissuaderait de soulever de graves allégations d'inconduite au sein du ministère de la Défense ou des Forces armées canadiennes.
Dans ces conditions, les dénonciateurs ont un choix à faire. Ils doivent préserver leur carrière et leur réputation. Ils peuvent agir seuls ou en collaboration avec leur chaîne de commandement, ce qu'ils sont tenus de faire de par leur formation. Il y a des risques. Bien que chaque situation soit unique, ils ont certainement intérêt à faire appel à des conseillers juridiques.
Quelle que soit l'issue des démarches entreprises avec des conseillers juridiques, le fait de pouvoir se faire rembourser les frais juridiques engagés changerait la donne.
Monsieur McSorley, vous avez indiqué que le Centre de la sécurité des télécommunications et le ministère de la Défense font souvent obstruction aux organes de surveillance comme le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement pour des motifs qui enfreignent probablement la loi. Vous avez également indiqué que vous aviez d'autres recommandations à formuler. Quelles sont ces recommandations, ou les avez-vous déjà faites dans le cadre de vos observations?
J'ai formulé quelques-unes de ces recommandations. Il y en a d'autres que nous pourrions faire.
Je pense qu'à l'heure actuelle, ceux qui se soustraient à leurs obligations légales vis‑à‑vis du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ou de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ne font l'objet d'aucune sanction. L'adoption d'une mesure législative qui érigerait en infraction le fait de refuser de communiquer des renseignements ou d'entraver le travail de ces organes permettrait de faire en sorte que les personnes concernées soient tenues de rendre des comptes et d'assumer leurs responsabilités.
Il y a aussi la question...
Malheureusement, le temps de M. Fast est écoulé. Je suis certain que vous serez en mesure de poursuivre votre réponse.
Madame Lalonde, vous avez cinq minutes, s'il vous plaît.
Merci beaucoup.
[Français]
Je remercie tous les témoins d'être avec nous.
[Traduction]
Je pense que je vais partir des questions que mes collègues ont posées et je vais essayer d'aller un peu plus loin.
On a fait allusion au lien de confiance qui existe entre les agences, l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Comme la plupart d'entre vous le savent, ces agences sont relativement nouvelles. Bien que je félicite le gouvernement de cette initiative, ces agences peuvent avoir des habitudes bien ancrées, et c'est certainement le cas au ministère.
Pouvez-vous indiquer au Comité comment des agences comme le Service canadien du renseignement de sécurité ou le Centre de la sécurité des télécommunications devraient collaborer avec ces agences nouvellement créées?
Je peux essayer de faire quelques recommandations.
L'une des choses que nous avons constatées, c'est que de nombreux ministères ont établi de bonnes relations de travail, et ce n'est pas dans tous les ministères que ces problèmes se posent. Au Centre de la sécurité des télécommunications, ces questions ont été soulevées à maintes reprises; il faut donc se demander s'il s'agit de tisser des liens plus étroits ou de se pencher sur des questions de classification excessive et de culture du secret à l'interne, surtout au Centre de la sécurité des télécommunications, mais aussi, dans une certaine mesure, au Service canadien du renseignement de sécurité. Je me suis entretenu avec des membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, et je sais que celui‑ci a collaboré étroitement avec ces agences afin de tisser des liens, et nous reconnaissons que cela prend un certain temps.
Une chose pourrait être améliorée... Par exemple, il y a le Groupe consultatif sur la transparence de la sécurité nationale. Celui‑ci pourrait avoir pour rôle de collaborer plus étroitement avec ces agences pour insister sur l'importance de la transparence, et peut-être même de proposer de la formation afin de favoriser celle‑ci.
Il est vrai que cela prend du temps, mais nous avons relevé des différences entre les agences. On peut donc se demander pourquoi certaines agences ont mis peu de temps à adhérer à cette culture de transparence alors que d'autres refusent toujours de partager de l'information.
Est‑ce que quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole? J'ai une autre question à poser.
Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point. Pour instaurer un climat de confiance — et je pense que cela revient à ce que vous avez dit, M. McSorley — les organismes doivent lever le voile sur leur façon de travailler tout en continuant à protéger les renseignements hautement confidentiels et à tenir compte de la nature délicate de leur travail. Pendant la guerre en Ukraine, nous avons vu des alliés comme la Grande‑Bretagne et les États‑Unis classifier des renseignements presque en temps réel.
J'apprécierais énormément que l'un d'entre vous fasse des recommandations sur la manière dont les agences canadiennes pourraient améliorer leurs pratiques.
En ce qui nous concerne, brièvement, nous avons étudié l'exemple de la Finlande et nous avons étudié la possibilité de passer d'un système de classification par défaut à un processus de classification rigoureux et clairement établi. Ce serait un grand pas en avant. Cela suppose évidemment un changement de culture, mais nous pensons que c'est nécessaire pour remédier au problème actuel de classification excessive. C'est un sujet qui était récemment au cœur des discussions de la Commission sur l'ingérence étrangère, et on a pu constater très clairement que la classification excessive suscitait des inquiétudes. Il faut que cela change.
Je dirais que l'une des principales différences que j'ai observées entre le Canada et, par exemple, les États‑Unis, c'est que tout renseignement provenant de sources étrangères ou tout ce qui y a trait de près ou de loin est immédiatement classifié ou fait l'objet d'un examen beaucoup plus minutieux en vue de sa classification. Dans certains cas, cela entraîne une classification excessive de renseignements très habituels. Aux États‑Unis, le ministère de la Défense publie régulièrement ce type d'informations dans les médias, alors qu'au Canada, celles‑ci sont classifiées du fait qu'elles proviennent de l'étranger...
Monsieur Drapeau, vous nous avez transmis des informations dont nous n'avons malheureusement pas encore pu prendre connaissance en raison de la traduction. Avez-vous des observations rapides à faire sur ces documents?
Ma réflexion porte sur la procédure de règlement des griefs. Le seul recours dont dispose un militaire est de déposer un grief, que celui‑ci soit rétrogradé, libéré de manière anticipée ou qu'un problème se pose au niveau de ses indemnités ou de son rapport d'évaluation du rendement. Tout s'arrête tant que le processus de règlement de grief n'a pas franchi les trois étapes, et ce n'est qu'à l'issue de ces trois étapes que le militaire peut en saisir la Cour fédérale. À ce moment‑là, il doit faire appel à un avocat, et la procédure est très longue.
Il se voit refuser les droits dont jouissent les autres Canadiens. En effet, lorsqu'on subit un préjudice en raison d'une décision qui a été prise, on peut faire appel aux tribunaux pour obtenir réparation. Ce n'est pas le cas des militaires.
Je vous remercie, madame Lalonde.
Je cède maintenant la parole à Mme Normandin pour deux minutes et demie.
[Français]
Merci, monsieur le président.
Monsieur Drapeau, ma prochaine question porte sur les décisions qui sont rendues par les gens qui travaillent à la divulgation des renseignements. J'imagine que ces décisions sont considérées comme étant de nature administrative.
J'aimerais que vous me parliez du degré de motivation nécessaire pour répondre aux décisions concernant une prolongation de délai ou un refus de fournir des documents, par exemple.
Existe-t-il une obligation de préciser les motifs pour lesquels on refuse de fournir des documents? Le cas échéant, est-elle respectée?
Il en existe très peu.
Dans la brève présentation que j'ai faite, je parle justement du cas d'une personne faisant l'objet de mesures disciplinaires susceptibles de causer son licenciement obligatoire sous peu.
Or, une vidéo enregistrée lors d'une activité sociale au club de golf pourrait disculper cette personne de l'inconduite dont on l'accusait. Nous en avons donc demandé une copie. Une ou deux semaines après le dépôt de notre demande, nous avons reçu une lettre disant que la vidéo au complet était exclue du dossier et qu'on ne pouvait pas nous la donner. Aucune autre explication n'a été fournie. C'est à n'y rien comprendre.
La carrière de cette personne est en jeu.
D'ici à ce que le temps nécessaire pour recevoir les résultats de la plainte soit écoulé, la personne sera probablement libérée obligatoirement et elle subira tout le reste.
La décision est prise ainsi. Notre seul recours n'est pas d'aller en cour, même si c'est ce que nous aimerions faire, mais bien de suivre le processus de plainte.
[Traduction]
Avant que vous ne démarriez le chronomètre, je tiens à préciser que les mémoires mentionnés par le colonel Drapeau ont été transmis au greffier, mais qu'ils n'ont pas encore été distribués aux membres du Comité. Est‑ce exact?
D'accord, très bien. Je tenais simplement à m'en assurer.
J'aimerais revenir sur la question des documents concernant le transfert des détenus afghans. Il s'agit d'un cas flagrant de mauvaise gestion de la part du gouvernement, ainsi que d'un manque de transparence à l'égard du Parlement et de la population canadienne.
Certaines mesures auraient dû avoir été apportées à l'époque, mais n'ont toujours pas été mises en place. Ma question s'adresse au colonel Drapeau et à M. McSorley. Quelles mesures recommandez-vous pour l'avenir?
C'est une bonne question.
Je pense que nous avons déjà abordé ce point lors de notre discussion concernant les organismes de surveillance civils indépendants, lesquels ont mis en place plusieurs restrictions en matière de renseignements. Par exemple, l’OSSNR et le CPSNR ont tous les deux mis en place des restrictions concernant l'accès à de vastes catégories de renseignements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale et à la défense du Canada. Par ailleurs, l'accès aux renseignements liés à des enquêtes en cours est fortement limité.
Il existe des moyens de contourner ce problème. Si ce genre de restrictions peuvent nuire à une poursuite pénale, il faut s'en tenir à cela. Dans le cas d'une enquête menée par le ministère de la Défense et circonscrite dans le temps, les comités parlementaires sont tenus d'éviter toute forme d'ingérence, mais sont autorisés par la suite à commencer leur propre enquête.
À l'heure actuelle, voilà le genre de lacunes qui continuent selon nous à entraver la capacité des comités à mener une enquête approfondie sur le scandale des prisonniers afghans et d'autres dossiers du même genre.
Je vous remercie.
Monsieur le colonel, vous avez parlé de l'utilisation de noms de code au sein des FAC. Par exemple, le pseudonyme « Kraken » aurait été utilisé pour faire référence au vice-amiral Norman et contourner certaines demandes d'accès à l'information. Est‑ce un acte illégal selon vous?
La Loi ne prévoit aucune mesure punitive pour ce cas de figure, mais tout individu commettant une infraction à une loi fédérale devrait faire l'objet de mesures disciplinaires.
Des médias ont rapporté les propos d'un commandant impliqué dans ce scandale: « Ne vous en faites pas, ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit. ». Cette réplique laisse croire qu'au sein du ministère de la Défense et des FAC, il n'est pas rare que des officiers se servent de noms de code pour contourner certaines demandes d'accès à l'information.
Les FAC se sont dotées d'un programme complet de mesures correctives, qui vont du simple avertissement à la mesure de mise en garde et de surveillance. Ce programme permet aux FAC de protéger la primauté du droit, notamment le droit d'accès à l'information.
Monsieur Drapeau, vous avez écrit dans un article que la liberté d'accès à l'information permet de garantir la reddition de comptes, d'endiguer la corruption, d'améliorer plusieurs domaines des droits de la personne, et de faciliter la participation de tous les secteurs de la société aux activités du gouvernement. Par ailleurs, en ce qui concerne la sécurité nationale, améliorer la transparence mène à une reddition de comptes accrue et permet à des analystes des politiques comme M. Shimooka de faire leur travail. La transparence facilite également le travail des médias, améliore l'accès à l'information dans la population générale, et aide les parlementaires à faire respecter les principes démocratiques.
J'aimerais parler des restrictions s'appliquant à l'information pour des raisons de sécurité nationale. Je parle ici des différents niveaux de classification des renseignements — niveau secret, très secret, et renseignements non classifiés —, ainsi que de la responsabilité, en vertu de la Loi sur la défense nationale, de ceux et celles qui ont fait le serment de servir le Canada au sein du ministère de la Défense nationale ou des Forces armées canadiennes. À part cela, y a‑t‑il des changements législatifs que nous devrions apporter en vue de protéger notre démocratie?
Le seul changement pertinent que je préconise est de fournir à la commissaire à l’information des pouvoirs accrus de surveillance et d'enquête par rapport à certains fichiers, documents, dossiers de plainte, et autres types de dossiers qui lui sont confiés.
Monsieur Shimooka, auriez-vous quelque chose à ajouter à titre d'analyste des politiques? La culture du secret qui s'est développée au cours des huit dernières années a‑t-elle entravé votre capacité de faire votre travail et de fournir des conseils aux parlementaires et aux fonctionnaires par rapport à différents programmes gouvernementaux, notamment les programmes d'approvisionnement pour les FAC?
Tout à fait. Comme je l'ai dit, il nous est de plus en plus difficile d'obtenir l'accès à plusieurs types de documents.
J'aimerais revenir à la remarque de M. Collins concernant les médias en général. Nous constatons l'affaiblissement graduel d'un grand nombre d'institutions qui jouent un rôle essentiel en matière de surveillance exercée sur les activités du gouvernement. Il est fréquent que des représentants ministériels se montrent évasifs dans leurs réponses, ou refusent tout simplement de répondre aux questions qui leur sont posées, ce qui fragilise notre démocratie.
Je pense que pour obtenir un portrait plus précis de la situation, nous devons réfléchir non seulement à l’AIPRP, mais aussi à tous les volets de l'obligation de rendre des comptes. Il existe des problèmes de reddition de comptes par rapport à plusieurs programmes gouvernementaux, et je pense notamment aux controverses entourant l'application ArriveCAN. Bref, nous devons accroître les activités d'examen et de surveillance.
Je vous remercie.
Monsieur McSorley, en ce qui concerne votre rôle dans la défense des libertés civiles, j'aimerais revenir sur le commentaire de M. Fillmore selon lequel les communications électroniques compliquent le processus d'accès à l'information et de reddition de comptes. Pensez-vous que les communications électroniques devraient faciliter les demandes d'accès à l'information, ce que réclame la population canadienne?
En théorie, les communications électroniques devraient faciliter les demandes d'accès à l'information et les interactions avec le gouvernement en général. De même, il devrait être plus facile pour le gouvernement de mener des recherches et d'obtenir toute documentation devant être transmise aux médias, et donc à la population. Il est vrai que nous n'avons jamais produit autant d'information qu'aujourd'hui, mais il existe également des technologies de pointe qui permettent de trier et de rendre accessible cette vaste quantité de renseignements.
Mercredi dernier, nous avons adopté deux motions qui tombaient à point nommé et qui devaient faire l'objet d'un rapport. La première motion concerne bien entendu la crise du logement et la pénurie de logements pour les membres des FAC. La situation est particulièrement problématique à Halifax en raison de conditions hivernales difficiles pour les personnes qui n'ont pas accès à un logement. La deuxième motion concerne le don de roquettes CRV7 excédentaires à l'Ukraine. Les militaires ukrainiens demandent à recevoir ces roquettes le plus rapidement possible pour lutter contre l'envahisseur russe.
Monsieur le président, j'aimerais savoir pourquoi ces deux motions n'ont pas encore été déposées à la Chambre. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, je suis tout à fait disposé, à titre de vice-président, d'effectuer les démarches nécessaires.
On m'a informé que ces deux motions venaient tout juste d'être traduites aujourd'hui, et c'est pourquoi elles n'ont pas encore été déposées à la Chambre.
Je suis conscient que les procès-verbaux peuvent être longs, mais il s'agit dans le cas qui nous occupe de motions très courtes. Je m'attendais donc à ce qu'elles soient traduites plus rapidement.
Je suis désolé, mais nous devons attendre la traduction de ces documents avant de passer aux prochaines étapes du processus.
Monsieur Fisher, la parole est à vous pour les cinq dernières minutes.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Je tiens tout d'abord à remercier nos invités pour leurs témoignages fort intéressants.
Monsieur le colonel, je vous remercie d'avoir servi notre pays.
Monsieur Shimooka, vous avez déploré, tout comme M. McSorley, l'expansion de la culture du secret au sein du gouvernement fédéral. Vous dites que c'est sous le gouvernement Harper que les restrictions en matière d'accès à l'information ont commencé à se mettre en place. Pouvez-vous nous donner un aperçu du moment où vous avez commencé à observer ce genre de changements?
C'est difficile à dire.
Les restrictions en matière d'accès à l'information ont été mises en place de manière graduelle, et il n'existe à mon avis aucun moyen de démontrer de manière empirique qu'il y a eu un changement de politique. À partir de l'année 2002, j'ai commencé à constater des réticences toujours plus grandes à fournir des renseignements à grande échelle de la part des quatre gouvernements majeurs qui se sont succédé. Il fallait de plus en plus faire des pieds et des mains pour réussir à obtenir certains renseignements.
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'aimerais à présent poser une question très brève à M. Drapeau.
Le pseudonyme « Kraken » a‑t‑il été utilisé comme nom de code pour désigner le commandant de la Marine royale canadienne? J'ai cru comprendre qu'il s'agit d'un qualificatif affectueux qui témoigne du respect des militaires envers leur commandant. À l'heure actuelle, je pense que c'est le commandant Topshee que l'on qualifie de « Kraken ».
Il ne s'agirait donc pas d'un nom de code comme on en retrouve dans le monde interlope. Qu'en pensez-vous?
Comme j'ai fait carrière au sein de l'Armée canadienne, je ne suis pas familier avec toutes les expressions utilisées dans la Marine royale canadienne. Je peux toutefois vous confirmer que je n'ai jamais entendu le terme « Kraken ».
Je crois comprendre qu'il s'agit d'un surnom affectueux plutôt que d'un nom de code.
Monsieur le président, je vais céder le reste de mon temps de parole à Mme Mathyssen.
Je vous remercie.
Colonel Drapeau, en raison de votre expertise sur le sujet, j'aimerais vous demander quelles réformes sont encore nécessaires pour aider les victimes d'inconduite sexuelle et de traumatismes à obtenir justice.
Je pense qu'il suffit de déposer un projet de loi visant à simplifier et à clarifier le processus de dénonciation. Pour l'instant, c'est la confusion qui règne. Certains cas sont transférés aux autorités civiles, tandis que d'autres demeurent entre les mains du MDN, et les plaignantes ne savent parfois plus vers qui se tourner. À l'heure actuelle, je sais que la police militaire est tenue de demander aux plaignantes de choisir entre ces deux systèmes. Mme Arbour s'oppose à cette procédure, et moi aussi.
Les plaignantes ne devraient pas être mises devant un pareil dilemme. Cette procédure tend à les mettre sur la sellette, étant donné qu'elles font partie des FAC et qu'elles relèvent donc de la chaîne de commandement. Les plaignantes ne savent pas si leur loyauté sera remise en question si elles choisissent de poursuivre leur agresseur devant un tribunal militaire plutôt qu'un tribunal civil.
Ce n'est pas aux victimes de choisir, car elles ne sont pas familières avec les différences considérables entre le système civil et le système militaire.
Tout à fait, d'autant plus que la grande majorité d'entre elles n'ont pas accès aux services d'un avocat pour prendre une décision éclairée.
Merci beaucoup.
Monsieur McSorley, vous aviez une recommandation finale à formuler à l'égard de Mme Lalonde, mais le son a été coupé. Souhaitez-vous reprendre la parole?
J'essaie de me rappeler de quelle recommandation il s'agit.
Nous n'insisterons jamais assez sur la nécessité de mener ce genre d'examens législatifs. Nous disposons déjà de certains renseignements, mais il me paraît essentiel que le CPSNR et l'OSSNR puissent mener un examen législatif afin de mieux comprendre la situation. Cela permettra également aux parlementaires et à la population de débattre du type de changements à apporter pour parvenir à des résultats concrets.
Voilà donc ma principale recommandation pour la séance d'aujourd'hui.
Je vous remercie, madame Mathyssen.
Monsieur Drapeau, je tiens à vous féliciter pour vos 22 années de pratique du droit. Étant moi-même avocat, j'ai longtemps réfléchi aux enjeux posés par la notion de conclusions défavorables. Pour faire court, si certains délais ne sont pas respectés par la plaignante, cela peut donner lieu à des conclusions défavorables à son sujet.
Est‑il raisonnable de mettre une plaignante sur la sellette simplement parce qu'elle n'a pas pu répondre en temps opportun, et ce, pour des raisons qui lui appartiennent?
Si vous avez des suggestions à faire concernant la question des conclusions défavorables, je pense que cela pourrait nous être utile.
Lorsqu'un ministère demande une prolongation de plus de 60 jours par exemple, au lieu des 1 000 jours auxquels je faisais référence, ou à la période habituelle de 300 à 500 jours, nous devrions acquiescer à cette demande. Dans ce cas, il n'est même pas nécessaire de s'adresser à la commissaire à l'information, puisqu'il est possible de présenter l'affaire devant la Cour fédérale.
La plupart du temps, ce que nous demandons — et ce que nous avons demandé lors des quatre requêtes adressées au ministère —, est suffisamment important, mais nous n'obtiendrons pas de décision le cas échéant. Si tel est le cas, une décision judiciaire sera alors nécessaire. Cela devrait permettre de contourner le mécanisme normal qui consiste à passer par le commissaire à l'information, ce qui prend une éternité.
Nous pourrions fixer un plafond de 100 jours par exemple. Si elle dépasse ce délai, la plaignante aurait la possibilité de contourner le mécanisme d'examen établi par l'intermédiaire de la commissaire à l'information, et procéder à un examen judiciaire devant un tribunal civil. Dans ce cas, le nombre de demandes de prolongation au‑delà d'un certain nombre de jours risque d'être nettement moins élevé.
En effet, si la commissaire à l'information ne présente pas de rapport avant la fin de l'année, il sera alors possible d'obtenir le feu vert pour engager une procédure de révision judiciaire, bien que certains pourraient ne pas choisir une telle option.
Je vous remercie.
Sur ce, chers collègues, je souhaite remercier tous nos témoins. Ce fut une discussion très enrichissante, et nous vous en sommes reconnaissants.
Nous allons passer à huis clos pendant quelques minutes pour discuter des travaux du Comité.
La séance est suspendue.
[La séance se poursuit à huis clos.]
Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
En traitement...

