AGRI Rapport du Comité
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
L'ABORDABILITÉ DE L'ÉPICERIE : UN EXAMEN DE L'AUGMENTATION DU COÛT DES ALIMENTS AU CANADA
Introduction
En septembre 2022, la hausse d’une année à l’autre du prix des aliments achetés en magasin, mesurée par l’Indice des prix à la consommation (IPC), a atteint 11,4 %, un sommet depuis 1981. Ce pourcentage surpassait largement le taux d’inflation moyen calculé dans l’ensemble de l’économie canadienne (6,9 %) au cours de la même période. Bien que le rythme général de l’inflation ait commencé ralentir en février 2023, les prix à la consommation des produits alimentaires sont restés élevés, le taux d’inflation dans cette catégorie d’une année à l’autre ayant été supérieure ou égale à 10 % pour un septième mois consécutif[1].
À l’autre bout de la chaîne d’approvisionnement, les agriculteurs et d’autres producteurs doivent composer avec de fortes augmentations du prix des céréales fourragères, du carburant, de l’engrais et d’autres intrants essentiels, qui ont entraîné une hausse de 16,1 % de leurs dépenses d’exploitation[2]. De même, les petites et moyennes entreprises de transformation des aliments, qui composent la majeure partie du secteur, font face à une augmentation des prix du transport et de l’emballage des aliments, sans oublier les pénuries de main‑d’œuvre et les problèmes qui perdurent dans la chaîne d’approvisionnement.
Le secteur de l’épicerie est le principal intermédiaire entre les producteurs d’aliments et les consommateurs. En 2019, les Canadiens ont acheté en magasin près des trois quarts des aliments qu’ils ont consommés[3], ce qui fait du commerce de détail un marché essentiel pour les producteurs agroalimentaires qui souhaitent vendre leurs produits aux consommateurs canadiens. Or, ce secteur compose avec les mêmes tensions sur les coûts, attribuables aux problèmes dans la chaîne d’approvisionnement et aux pénuries de main‑d’œuvre. Cependant, à peu près à la même période, les magasins d’aliments et de boissons ont également enregistré une augmentation de leur revenu net, qui a culminé à 1,8 milliard de dollars au premier trimestre de 2021 et qui demeure à ce jour supérieur à un milliard de dollars et une marge de profit (profit net en pourcentage du revenu total) moyenne de 2,87 % au quatrième trimestre 2022 par rapport à 1,57 % au quatrième trimestre 2019[4]. Cette situation a amené des groupes de consommateurs et d’autres parties prenantes à s’interroger sur la manière dont les coûts croissants sont répartis dans la chaîne d’approvisionnement et sur le fait que les cinq plus grands détaillants du Canada, qui contrôlent 80 % du marché de l’alimentation, pourraient se livrer à des pratiques de « gonflement des prix » ou utiliser leur pouvoir de marché pour augmenter les prix plus rapidement que la croissance de leurs coûts de production.
Constatant la nature extraordinaire de ces hausses de prix et leurs effets sur les producteurs, les transformateurs et les consommateurs, le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes (le Comité) a adopté la motion suivante le 5 octobre 2022[5] :
Que, conformément à l’article 108(2) du Règlement, le comité entreprenne une étude sur l’inflation dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et l’augmentation du coût des produits d’épicerie, alors que les grandes chaînes font des profits; que le comité examine les profits des grandes chaînes d’épicerie par rapport aux salaires des employés et au coût des produits d’épicerie au Canada; que le comité examine également la capacité des grandes chaînes d’épicerie de tirer parti de leur taille pour réduire les revenus des agriculteurs canadiens; que le comité explore les moyens par lesquels la chaîne d’approvisionnement alimentaire peut contribuer à réduire la hausse du coût des aliments; et que le comité invite des témoins ayant des connaissances précises sur l’inflation et les intervenants concernés de l’industrie, notamment des dirigeants d’épiceries et de chaînes d’approvisionnement alimentaire, des économistes, des syndicats et des agriculteurs ou des organisations représentatives[.]
Le Comité a tenu huit réunions sur le sujet entre le 5 décembre 2022 et le 19 avril 2023, lors desquelles il a entendu 58 témoins, dont des représentants des secteurs de la production primaire, de la transformation des aliments et des boissons et de la vente au détail de produits alimentaires, ainsi que des représentants de groupes de la société civile. Le présent rapport résume les constatations du Comité et recommande au gouvernement du Canada des moyens d’atténuer les impacts des pressions inflationnistes sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, notamment sur les producteurs, les consommateurs et les communautés.
L’Inflation alimentaire et ses impacts
Mesurer l’inflation
L’évolution des prix est mesurée grâce à l’Indice des prix à la consommation de Statistique Canada. Les représentants de l’agence statistique ont expliqué au Comité que l’IPC « suit l’évolution des prix à la consommation d’un panier fixe de biens et de services d’une quantité et d’une qualité constantes[6] ». Ce panier comprend notamment les principaux coûts assumés par les ménages comme l’alimentation, le transport, le logement, l’énergie, les soins de santé et les loisirs.
Évolutions de l’Indice des prix à la consommation
Le prix des aliments achetés en magasins a augmenté plus rapidement par rapport à l’ensemble des produits de l’IPC. La figure 1 présente l’évolution de ces indices depuis mars 2020 et met en évidence cette tendance.
Figure 1 — Variations d’une année sur l’autre des prix à la consommation au Canada (de mars 2020 à mars 2023)
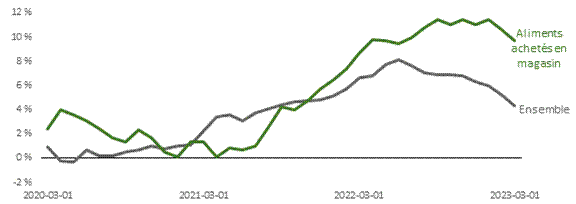
Source : Figure préparée par le Comité à partir de données tirées de Statistique Canada, « Tableau 18‑10‑0004‑01 : Indice des prix à la consommation mensuel, non désaisonnalisé », base de données, consultée le 15 mai 2023.
Entre février 2022 et février 2023, les aliments représentent la catégorie de biens dont le prix a augmenté le plus rapidement, suivis par les dépenses consacrées aux soins de santé, au logement et aux transports (figure 2).
Figure 2 — Évolution des prix des principales catégories de l’Indice des prix à la consommation au Canada (de février 2022 à février 2023)
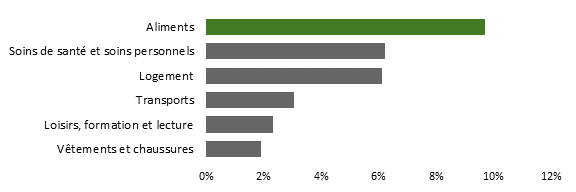
Source : Figure préparée par le Comité à partir de données tirées de Statistique Canada, « Tableau 18‑10‑0004‑01 : Indice des prix à la consommation mensuel, non désaisonnalisé », base de données, consultée le 3 avril 2023.
Les fonctionnaires de Statistique Canada ont indiqué que l’augmentation du prix des aliments touchait l’ensemble des grandes catégories de biens alimentaires[7]. Toutefois, Tyler McCann, directeur général de l’Institut canadien des politiques agroalimentaires, a noté des variations parmi les 190 produits alimentaires que composent l’IPC, notant que « les pâtes coûtaient 20 % plus cher en décembre 2022 qu’un an auparavant, mais le prix du porc frais et congelé avait baissé de presque 1 % ».
Comparaisons internationales
De nombreux témoins ont rappelé que le phénomène d’inflation du prix des aliments est global. Jodat Hussain, vice-président principal, Financement, Vente au détail des Compagnies Loblaw limitée a par exemple estimé que le Canada s’en sortait plutôt bien par rapport aux États-Unis, notant qu’à « aucun trimestre depuis le deuxième trimestre de 2020, l’inflation des prix de l’alimentation n’a été plus élevée au Canada qu’aux États‑Unis ». Plusieurs témoins ont à ce titre considéré que le Canada était moins touché par l’inflation alimentaire que ses principaux partenaires[8]. Selon les données de l’OCDE, en janvier 2023, l’augmentation du prix des aliments était inférieure à la moyenne de l’inflation alimentaire enregistrée en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et proche de celle mesurée aux États‑Unis. La figure 3 présente les chiffres de l’inflation des produits alimentaires des pays qui composent le G7.
Figure 3 — L’Indice des prix à la consommation (IPC) pour les produits alimentaires dans les pays du G7 (pourcentages)
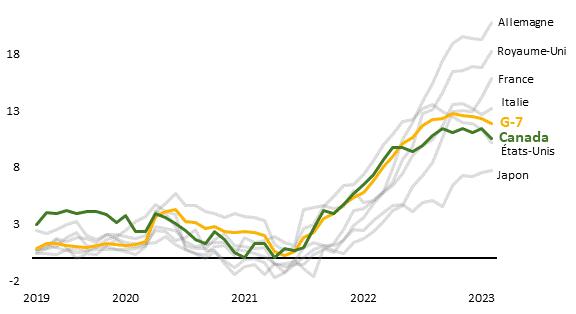
Source : Figure préparée par le Comité à partir de données tirées de l’Organisation de coopération et de développement économiques, Inflation (CPI), base de données, consultée le 3 avril 2023.
Autres mesures de l’augmentation des coûts et des prix
Les représentants des producteurs et transformateurs ont souligné que l’augmentation des prix payés par les consommateurs ne reflète pas entièrement celle des coûts croissants assumés en amont dans la chaîne d’approvisionnement. Selon Martin Caron, président général de l’Union des producteurs agricoles, l’IPC a augmenté moins vite que le prix des intrants agricoles, en outre il rapporte qu’entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2022 « [t]rois des principaux intrants de production, soit l’alimentation des animaux, les engrais et le carburant, ont connu des croissances de prix de 56 %, de 84 % et de 82 % respectivement, ce qui est beaucoup plus élevé que l’Indice des prix à la consommation ».
Ces augmentations se traduisent par une croissance du prix des denrées agricoles utilisées par les transformateurs alimentaires. Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, rapporte par exemple des augmentations successives de près de 50 % du prix du blé entre avril et novembre 2021 puis entre mars et juillet 2022. Philip Vanderpol, président du Conseil d’administration de l’Association des transformateurs laitiers du Canada, a également indiqué que l’augmentation des prix des produits laitiers de 9,5 % enregistrés entre 2020 et 2022 pour les consommateurs était inférieure à l’augmentation des coûts des intrants dans son industrie. Il estime par exemple que le « coût du lait cru a augmenté de 10,6 %, celui de l’énergie a plus que doublé, les emballages et les matériaux ont augmenté de 24 %, tandis que le coût des machines et de la main-d’œuvre a augmenté de plus de 10 % ».
Les témoignages ont permis de mettre en évidence que les produits de la gestion de l’offre ont dans l’ensemble connu une inflation plus limitée. L’Association des transformateurs laitiers du Canada l’illustre en comparant l’augmentation du prix de l’ensemble des aliments qui s’est élevé à 27 % dans les dix dernières années à celle des produits laitiers qui n’était que de 11 % sur la même période[9]. Illustrant l’intérêt de ce système pour maintenir la stabilité des prix, M. Caron a mis de l’avant que le prix des œufs a moins augmenté au Canada qu’aux États-Unis, ce qui démontre, selon lui, que « la gestion de l’offre est un outil vraiment performant » pour prévenir les fluctuations des prix.
Au-delà de l’IPC, d’autres indicateurs de Statistique Canada permettent de comprendre le phénomène de l’inflation comme l’Indice des prix des entrées dans l’agriculture ou l’Indice des prix des produits industriels. Toutefois, M. McCann, directeur général de l’Institut canadien des politiques agroalimentaires, a regretté qu’à l’inverse des États-Unis, le Canada ne dispose pas d’autant d’indicateurs permettant d’analyser en profondeur la structure du coût des aliments. Il a pris en exemple le programme de recherche « Food Dollar Series » du département de l’agriculture américain qui analyse la répartition des coûts des produits alimentaires de façon détaillée, permettant ainsi de déterminer la part du prix des produits alimentaires attribuable aux coûts de production, de transformation, d’emballages ou d’énergie. Il recommande qu’Agriculture et agroalimentaire Canada ou un autre organisme recueille des données similaires et effectuer des analyses aussi poussées qu’aux États-Unis et rende ces résultats publics.
Recommandation 1
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada prenne les mesures nécessaires pour recueillir et rendre publiques les données sur les coûts au sein de la chaine d’approvisionnement agro-alimentaire canadienne, y compris les données ventilées selon les coûts des secteurs de la production primaire, de la transformation d’aliments et boissons et de la vente au détail, à l’image de ce qui est réalisé par le service de recherche économique du département de l’Agriculture des États-Unis dans le cadre son programme de recherche Food Dollar Series.
Impact de l’inflation alimentaire sur les individus et les communautés
De nombreux témoins entendus au cours de l’étude on fait savoir que l’augmentation du coût des aliments affecte directement la vie de nombreux Canadiens. Plusieurs intervenants ont témoigné d’une augmentation des problèmes d’insécurité alimentaire au pays, et notamment de la vulnérabilité particulière des ménages à faibles revenus et des peuples autochtones.
Hausse de l’insécurité alimentaire
Jim Stanford, économiste et directeur du Centre for Future Work, a observé une diminution de la quantité de produits d’épicerie achetés par les Canadiens, ce qui représente selon lui un « un signe de stress et de faim dans les ménages canadiens ». Michael H. McCain, président-directeur du conseil d’administration et chef de la direction d’Aliments Maple Leaf inc., a cité des recherches internes sur la sécurité alimentaire qui ont démontré que près du quart des Canadiens sont « très inquiets pour leur capacité de s’alimenter ». De même, M. McCann rapporte de son côté que plus la moitié des répondants d’une étude de l’Institut Angus Reid estimaient avoir de la difficulté à nourrir leur ménage, une proportion qui s’élève à 71 % pour les personnes dont le revenu est inférieur à 25 000 $. Le Comité a aussi entendu que les banques alimentaires font face à un afflux inédit et récent de clients qui occupent un emploi à temps plein, mais dont les revenus ne suffisent plus à subvenir à leurs besoins alimentaires[10].
Pour Rebecca Lee, directrice générale des Producteurs de fruits et légumes du Canada, l’augmentation du prix des fruits et légumes entraîne une diminution de leur consommation alors qu’avant la pandémie près de 80 % des Canadiens avaient déjà une consommation de fruits et légumes inférieure aux recommandations du Guide alimentaire canadien. Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième récolte Canada, a étayé cet argument en ajoutant que les mauvaises habitudes alimentaires peuvent entraîner des conséquences négatives sur la santé :
[U]ne mauvaise alimentation entraîne de nombreux effets néfastes sur la santé, notamment des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, certains cancers et le diabète de type 2, sans parler de l’incidence de l’insécurité alimentaire sur la santé mentale et le comportement cognitif. Chez les enfants, une mauvaise alimentation se traduit par de moins bons résultats scolaires et des problèmes de développement physique, émotionnel et psychologique qui les accompagneront tout au long de leur vie. L’augmentation du prix des aliments plonge davantage de Canadiens dans l’insécurité alimentaire à court terme, mais les conséquences de l’impossibilité d’acheter des aliments sains dureront bien plus longtemps que la pression inflationniste à laquelle nous faisons face aujourd’hui.
Le chef Byron Louis, de la Bande indienne d’Okanagan, a attiré l’attention des membres du Comité sur la situation unique des Premières Nations et des autres peuples autochtones en ce qui a trait à la sécurité alimentaire. Selon Statistique Canada, 13,9 % des Autochtones âgés de 16 ans et plus vivaient sous le seuil de la pauvreté en 2021, soit presque le double de la population non autochtone correspondante (7,4 %)[11]. Le chef Louis a expliqué que, même si, traditionnellement, les membres des communautés des Premières Nations compensaient leurs revenus plus faibles par la chasse, la pêche et le piégeage afin de se procurer de la nourriture, ce qu’il a appelé des « politiques coloniales » et la dégradation de l’environnement dans lequel vivent les populations d’animaux sauvages avaient amoindri leur capacité en cette matière. De l’avis du chef Louis, l’effet cumulatif de ces changements a été une diminution de la souveraineté alimentaire des Premières Nations et une plus grande dépendance à l’égard des systèmes alimentaires du marché pour la nourriture.
Cette dépendance accrue à l’égard des sources de nourriture externes a contribué à la hausse des prix des aliments dans les communautés des Premières Nations. Le coût du transport des produits alimentaires par avion vers les régions éloignées et dans le Nord fait augmenter considérablement le prix des aliments de détail dans ces régions, aggravant ainsi davantage l’effet de l’inflation sur celui que l’on observe en région urbaine. Le chef Louis a décrit l’expérience d’acheter du saumon, un poisson qui a déjà été abondant à l’état sauvage, dans sa collectivité des Premières Nations du Yukon :
J’ai constaté, lorsque j’étais à Old Crow, la collectivité la plus septentrionale du Yukon, qu’un petit morceau de saumon coho, une portion individuelle, coûtait 26 $. Pour une famille de cinq personnes… faites le calcul. Donc, pour cette famille, un repas de saumon coûte bien plus de 100 $. Imaginez les conséquences, lorsqu’on a un revenu fixe, et imaginez le coût réel du transport.
D’après l’Étude sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement chez les Premières Nations, un sondage traitant d’enjeux liés à la sécurité alimentaire dans les communautés des Premières Nations, réalisé entre 2011 et 2018 par l’Assemblée des Premières Nations, l’Université de Montréal et l’Université d’Ottawa, près de la moitié (47,1 %) des ménages des Premières Nations vivant dans des réserves dont les membres ont été sondés connaît l’insécurité alimentaire. Ce taux est presque quatre fois plus élevé que le taux de prévalence moyen s’appliquant à la population canadienne, qui est de 12,2 %[12]. Les taux d’insécurité alimentaire étaient particulièrement élevés dans les trois territoires. En effet, Statistique Canada rapporte que, en 2020, le taux d’insécurité alimentaire était de 46,8 % chez les Autochtones de 16 ans et plus dans les territoires, comparativement à 12,6 % chez les non‑Autochtones[13].
Le chef Louis a suggéré au gouvernement de mettre en place des « initiatives de lutte contre l’insécurité alimentaire dirigées par les Premières Nations, y compris des stratégies visant à renforcer la résilience des Premières Nations contre les répercussions de l’inflation du prix des aliments[14] ».
Recommandation 2
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada fournisse un financement supplémentaire aux initiatives gérées par les Autochtones des régions éloignées et du Nord, visant l’amélioration des infrastructures qui favorisent la sécurité alimentaire de leurs communautés.
Neil Hetherington, président-directeur général, Daily Bread Food Bank, a rappelé au Comité que le Canada s’est engagé sur à assurer la sécurité alimentaire de sa population en signant la Déclaration universelle des droits de l’homme qui consacre un « droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation » :
[J]e rappelle que le Canada a signé l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de la personne des Nations Unies, et que nous souscrivons ainsi au droit à l'alimentation. Nous pensons que chacun devrait avoir les moyens de se nourrir avec des aliments adaptés à sa réalité culturelle et qui répond à ses besoins. La question est de savoir de quelle manière respecter cet engagement que nous avons déjà pris.
Faire face à l’insécurité alimentaire
Un certain nombre d’initiatives ont été avancées pour permettre de faire face à l’insécurité alimentaire au Canada. Plusieurs témoins ont souligné que les problèmes d’insécurité alimentaire sont avant tout des problèmes de revenus et que le gouvernement devrait s’assurer que des mesures soient en place afin que « ceux qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts puissent compter sur l’aide du gouvernement pour le faire[15] » à travers un « filet social de sécurité plus résistant[16] ».
Pour M. McCain, il est nécessaire de trouver des solutions systématiques aux causes profondes de l’insécurité alimentaire, notamment les problèmes de santé mentale, de littéracie alimentaire et de handicap. M. Hetherington a alerté le Comité sur la situation précaire des personnes handicapées fournissant l’estimation qu’une personne handicapée en Ontario peut recevoir 1 229 $ par mois du gouvernement provincial alors que le seuil de pauvreté est fixé à 2 100 $. À ce titre, il s’est félicité de l’adoption à la Chambre des Communes du Projet de loi C‑22 : Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées qui vise à fournir une aide supplémentaire aux personnes handicapées en âge de travailler. Il a par ailleurs estimé qu’il était temps d’avoir un « débat sérieux sur l’instauration d’un revenu garanti », considérant qu’une telle mesure pourrait « aider beaucoup de gens à sortir de la pauvreté[17] ».
Pierre Lynch, président de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées a notamment alerté sur la situation précaire des aînés vulnérables notamment ceux bénéficiaires du Supplément de revenu garanti. Cette prestation est indexée sur le niveau global de l’IPC, toutefois l’inflation plus forte du prix des aliments par rapport à l’ensemble du panier de l’IPC entraine un appauvrissement des personnes touchant cette prestation dont la part de l’alimentation dans le budget total est plus importante dans le panier de consommation des ainées en situation de précarité.
Les banques alimentaires représentent une des dernières lignes de défenses pour les Canadiens qui font face à des problèmes d’insécurité alimentaire. M. Hetherington a expliqué que la demande a explosé pour les services de son organisation:
À Toronto, dans les banques alimentaires desservies par Daily Bread, nous avions l'habitude d'accueillir quelques 65 000 clients par mois. La pandémie a fait passer ce chiffre à 120 000, et entre janvier 2021 et aujourd'hui, nous avons enregistré 270 000 visites par mois. Nous sommes donc passés de 65 000 à 270 000 clients par mois. Si vous ne retenez qu'une chose de mon témoignage d'aujourd'hui, j'espère que ce sera ce chiffre étonnant et effarant.
C’est pourquoi Mme Nikkel a recommandé au gouvernement de rétablir le Programme de récupération d’aliments excédentaires qui a accordé des contributions à des organisations, notamment Deuxième récolte Canada, afin de faciliter la gestion et l’acheminement des surplus existants vers les organisations de lutte contre l’insécurité alimentaire et ainsi éviter que ces produits excédentaires ne soient gaspillés. Elle a aussi recommandé le rétablissement du Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire qui prévoyait un financement pour les organismes de lutte contre l’insécurité alimentaire. Enfin, Mme Nikkel a également prôné l’élimination des dates de péremption comme méthode de réduction de l’insécurité alimentaire et de réduction du gaspillage :
Les dates de péremption sont souvent mal comprises. Il ne s’agit pas de dates d’expiration. Ces dates font référence à la fraîcheur maximale d’un produit. Alors que les Canadiens peinent à mettre de la nourriture sur la table, ils sont également convaincus que les dates de péremption sont une question de sécurité et jetteront de la bonne nourriture pour se protéger et protéger leur famille. L’élimination des dates de péremption permettrait d’éviter que des aliments sûrs et consommables soient jetés et permettrait aux Canadiens d’économiser de l’argent sur leur facture d’épicerie.
L’emballage de plastique des aliments et des boissons joue un rôle important pour garantir la salubrité et la qualité des produits alimentaires, en particulier dans le cas des aliments frais; l’emballage empêche la perte et le gaspillage des produits comestibles à mesure qu’ils franchissent les différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement. Le gouvernement fédéral a pris des mesures récemment visant l’élimination des articles de plastique à usage unique, y compris de certains récipients alimentaires en plastique à usage unique, dans le cadre du Programme zéro déchet de plastique du Canada et du Règlement interdisant les plastiques à usage unique. Toutefois, certaines personnes ont fait part de préoccupations quant à la portée des changements et à l’incidence que ceux-ci pourraient avoir sur le gaspillage alimentaire. Une étude menée récemment par le National Zero Waste Council, une initiative de Metro Vancouver visant à créer une « économie circulaire » qui prévient le gaspillage grâce à la réutilisation et au recyclage des ressources existantes, a fait ressortir que les émissions de gaz à effet de serre produites par les pertes alimentaires étaient beaucoup plus importantes que celles liées aux matériaux d’emballage. Les responsables de cet organisme croient que, au lieu de viser l’élimination du plastique, il faut innover encore plus dans le secteur de l’emballage pour que les producteurs d’aliments aient accès à d’autres matières[18].
Plusieurs témoins ont fait remarquer que le prix des produits d’emballage pour les aliments et les boissons, y compris les articles en plastique, avait augmenté considérablement au cours des derniers mois[19], mais que des produits de remplacement n’étaient pas suffisamment disponible à grande échelle. Olivier Bourbeau, vice-président, Fédéral et Québec, Restaurants Canada, a demandé au gouvernement fédéral de prolonger le calendrier de mise en œuvre de l’élimination des articles en plastique à usage unique et de travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs de produits d’emballage pour que des produits de remplacement soient accessibles « en quantité suffisante, à temps et à prix raisonnable ».
Recommandation 3
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, lutte contre le gaspillage alimentaire en :
- Menant un examen au sujet de l’élimination de la date de péremption Affichée sur les produits alimentaires et de l’impact de cette mesure pour les Canadiens;
- Élaborant, en partenariat avec des organismes sans but lucratif et les grands détaillants, des programmes qui réacheminent des surplus alimentaires aux Canadiens qui souffrent d’insécurité alimentaire; et
- S’assurant que ses exigences en matière de réduction des plastiques sont réalisables, en prolongent le délai de mise en œuvre de l'interdiction des plastiques à usage unique et en collaborant étroitement avec les fournisseurs de produits alimentaires pour veiller à ce que des produits de remplacement commercialement viables, en particulier pour les emballages qui visent à étendre la durée de conservation des aliments et limiter le gaspillage alimentaire, soient disponibles en quantités nécessaires.
Les facteurs de l’inflation
Les témoins des secteurs de la production primaire et de la transformation ont mis en évidence plusieurs facteurs qui ont entraîné une augmentation de leurs coûts de production au cours des trois dernières années. Nombre de ces facteurs – notamment les perturbations de la chaîne d'approvisionnement internationale et les fluctuations des prix mondiaux des intrants tels que les aliments pour animaux, les carburants et les engrais – sont des phénomènes mondiaux. D'autres, tels que les pénuries de main-d'œuvre et les phénomènes météorologiques extrêmes, sont présents à des degrés divers dans de nombreux pays, mais se manifestent différemment dans chaque cas. Les témoins ont identifié un certain nombre de ces pressions et suggéré des moyens par lesquels le gouvernement du Canada pourrait s'attaquer à leur impact sur le système alimentaire canadien.
Hausse du coût des intrants
De nombreux témoins ont mentionné la hausse du coût des intrants employés dans la production alimentaire tel que les pesticides, les aliments pour animaux et les engrais[20]
Comme le comité l’a déjà noté, les prix internationaux des engrais ont commencé à augmenter en 2021 en raison de plusieurs facteurs, notamment la diminution de la capacité de production pendant la pandémie de COVID‑19 et les restrictions commerciales chinoises sur les exportations d'engrais. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture rapporte que le prix au comptant de l'urée de la mer Noire, une référence internationale pour les prix des engrais azotés, est passé de 245 $ USD la tonne en novembre 2020 à 901 $ USD la tonne en novembre 2021[21].
L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a causé davantage de perturbations à la chaîne d’approvisionnement mondiale des engrais et des prix mondiaux des aliments. Karl Littler, vice-président principal du Conseil canadien du commerce de détail a illustré ce point :
Le plus grand méchant identifiable est l’invasion fomentée par Poutine, qui nuit aux exportations de céréales et d’engrais de deux des plus grands producteurs mondiaux – l’Ukraine et la Russie – et fait grimper les prix mondiaux de ces produits. Les céréales sont indispensables à la fabrication des aliments de base tels que le pain, les pâtes, les céréales et les huiles, ainsi que de la majorité des produits sur les principaux rayons des épiceries. Bien entendu, les céréales servent également à nourrir la plupart des animaux élevés pour leur viande ou pour la production d’œufs et de lait.
À la suite de l’invasion, le 2 mars 2022, le Canada a pris la décision d’émettre un décret de retrait du tarif de la nation la plus favorisée pour la Russie et le Bélarus, astreignant toutes leurs importations à des droits de douane de 35 %[22]. Cette décision a exacerbé l’augmentation des coûts des engrais dans les régions qui dépendent des importations russes et biélorusses, notamment toutes les provinces à l’Est du Manitoba. Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires et professeur à l’Université Dalhousie, dit comprendre « le raisonnement géopolitique de cette décision », mais indique que pénaliser « les producteurs peut compromettre notre sécurité alimentaire, pas seulement au Canada, mais également ailleurs dans le monde ».
Pour Mary Robinson, présidente de la Fédération canadienne de l’agriculture, a noté que les agriculteurs n’ont pas de solution de rechange à moindre coût aux fertilisants, les obligeant à prendre des « décisions difficiles » comme celles de retarder les investissements susceptibles de rendre leur exploitation plus efficace et plus durable sur le plan environnemental. Mme Robinson estime que les droits de douane collectés par le Canada sur les importations d’engrais russes devraient être remis aux agriculteurs par l’intermédiaire de « programmes qui aident à atténuer certaines des répercussions de la hausse des coûts » notamment ceux des engrais et du carburant. Dans son budget 2023, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il verserait 34,1 millions de dollars – le montant qu'il déclare percevoir par le biais des droits de douane sur les engrais – sur trois ans à son Fonds d'action à la ferme pour le climat afin d'aider les agriculteurs de l'Ontario, du Québec et du Canada atlantique à adopter des pratiques de gestion de l'azote qui réduiront leur besoin d'engrais[23].
Recommandation 4
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada rembourse directement les agriculteurs et les détaillants qui ont payé un droit de douane de 35 % sur leurs importations d’engrais russes depuis le 2 mars 2022 et qu’il retire cette mesure pour l’avenir.
Pour soutenir les producteurs confrontés à la hausse du coût des intrants, le gouvernement a décidé le 23 juin 2022 de faire passer la tranche exempte d’intérêts du Programme de paiements anticipés de 100 000 $ à 250 000 $ pour les années 2022 et 2023[24]. Le 10 mai 2023, la ministre de l’Agriculture et de l’agroalimentaire a annoncé une nouvelle augmentation de ce plafond à 350 000 $ pour l’année de programme 2023[25]. Dans le cadre de ce programme, les producteurs peuvent obtenir une avance de fonds sans intérêt en fonction de la valeur de leur production à venir ou en stock, permettant ainsi à ceux-ci d’obtenir des liquidités le temps de vendre leur production[26]. Les représentants de la Fédération canadienne de l’agriculture et l’Union des producteurs agricoles ont salués le rehaussement de la tranche exempte d’intérêt du programme. Ils ont toutefois appelé le gouvernement à étendre cette mesure dans le temps afin que les agriculteurs puissent maintenir cet accès facilité aux liquidités pour leur permettre de passer à travers cette période de forte inflation[27].
Recommandation 5
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada aide les producteurs agricoles et l’industrie agroalimentaire à réduire leurs coûts et qu’il s’assure qu’ils ont accès à des liquidités suffisantes pendant cette période de forte inflation en :
- Facilitant l’accès au crédit à court terme et à faible coût pour les entreprises;
- Maintenant le seuil accru applicable aux paiements sans intérêt versés dans le cadre du Programme de paiements anticipés.
Perturbations de la chaîne d’approvisionnement
La chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale a subi un nombre sans précédent de perturbations dans les dernières années et cet enjeu à fait l’objet d’un rapport récent du Comité. Mme Cloutier a rappelé certains des irritants qui ont affecté la chaîne d’approvisionnement au Canada et son lien avec l’augmentation des prix :
Les confinements pendant la pandémie de la COVID‑19, les blocus ferroviaires en 2020, les grèves au Port de Montréal en 2020 et en 2021 ainsi que la fermeture du pont Ambassador en février 2022 ont complexifié la logistique et le transport, autant par bateau que par train, et ont gonflé les prix.
Le gouvernement a mis en place un Groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement en janvier 2022 afin d’analyser ces perturbations. Le groupe de travail a publié son rapport final le 6 octobre 2022 et recommandé des mesures afin de répondre aux défis à courts et long terme qui affectent la fluidité de la chaine. De nombreux témoins ont recommandé de mettre en œuvre les recommandations du groupe de travail afin de réduire les pressions inflationnistes liées aux coûts de la logistique et du transport[28]. En outre, Mme Lee a souligné l’importance de reprendre la recommandation du groupe de mettre en place un « bureau fédéral de la chaîne d'approvisionnement qui regroupera les activités pertinentes du gouvernement fédéral ».
Recommandation 6
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, mette en œuvre sans tarder les recommandations du Groupe de travail sur la chaîne d’approvisionnement, surtout celles qui ont une incidence sur la chaîne d’approvisionnement agro-alimentaire, y compris :
- Investir dans les infrastructures de transport essentielles;
- Soutenir la numérisation des chaînes d'approvisionnement;
- S'attaquer aux pénuries chroniques de main d’œuvre dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des transports;
- Établir un bureau de la chaîne d’approvisionnement, comme le prévoit le budget de 2023, pour faciliter l’adoption d’une approche pangouvernementale de ces questions.
Multiplication des évènements climatiques extrêmes
La multiplication des évènements climatiques extrêmes attribuables aux changements climatiques a également contribué à affecter la stabilité des chaînes d’approvisionnement alimentaire dans le monde, mais aussi au Canada. Le représentant du Conseil canadien du commerce de détail a expliqué que les récentes sécheresses et vagues de chaleur en Californie et dans l’Ouest du Canada ont eu un impact direct « sur les rayons de produits frais, mais aussi sur les légumes et les fruits en conserve, congelés ou en boîte, les sauces, les jus et tous les produits dont ils sont des ingrédients[29] ». Au-delà des catastrophes naturelles, le changement climatique peut également entraîner la migration des ravageurs vers le nord comme l’a illustré Patrice Léger Bourgoin, directeur général de l’Association des producteurs maraîchers du Québec :
[N]ous ne pouvons plus parler des changements climatiques au futur, car ils sont là. En effet, les maraîchers les vivent au quotidien. L’été dernier, au Québec, des récoltes entières ont été ravagées par des invasions de pucerons en provenance des États‑Unis, ce qui a fragilisé la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Il faut donc mettre en place, dès maintenant, une stratégie nationale pour atténuer l’impact des changements climatiques.
Disponibilité de la main d’œuvre
La disponibilité de la main-d’œuvre a été évoquée par des intervenants de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement comme un irritant majeur favorisant l’inflation des prix des produits alimentaires. Michael Graydon, chef de la direction de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada, a expliqué que les fabricants d’aliments qui manquent d’employés dans leurs usines sont en plus affectés par la pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans le secteur du camionnage dont ils dépendent pour s’approvisionner et commercialiser leurs produits. Pour M. Bourbeau « une augmentation de 20 % des frais » des restaurateurs est attribuable à la pénurie de main-d’œuvre. M. McCann a détaillé les mécanismes par lesquels le manque d’employés se répercute sur les prix payés par le consommateur :
[P]lus un produit contient d’ingrédients, plus la part de l’agriculteur est faible et plus l’argent du consommateur va aux coûts de la main-d’œuvre. Par conséquent, plus un produit est complexe, plus il est probable que les coûts augmentent en raison de la hausse du coût de la main‑d’œuvre.
Plusieurs pistes de solutions ont été avancées par les témoins. Alors que le Programme des travailleurs temporaires étrangers a été unanimement reconnu comme d’une importance cruciale pour l’ensemble du secteur, Dimitri Fraeys, vice-président, Innovation et affaires économiques du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, a insisté sur la nécessité de réduire les délais de traitement des demandes à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada en allouant plus de ressources à ce ministère et en simplifiant les demandes et en employant les technologies numériques. Pour les Producteurs de fruits et légumes du Canada, il faudrait mettre en œuvre une simplification des processus de vérification pour les employeurs qui ont un historique de respect des modalités du programme à travers un « programme des employeurs reconnus[30] ». Restaurants Canada propose de revoir la manière dont la Classification nationale des professions est utilisée pour limiter les permis de travail à certaines activités. Selon l’organisme, ces exigences empêchent les restaurateurs de faire évoluer leurs employés au sein de leur entreprise et de leur confier de nouvelles tâches[31]. Restaurants Canada prône également plus de flexibilité pour les permis de travail fermés, de sorte que les restaurants ayant plusieurs établissements aient la possibilité « de faire bouger les employés d’un restaurant à l’autre[32] ».
Recommandation 7
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada réduise les délais, la paperasse et les coûts du programme des travailleurs étrangers temporaires en accélérant la mise en œuvre du modèle d’employeur de confiance qu’il a proposé dans le budget de 2022.
L’enjeu de la main-d’œuvre ne doit toutefois pas être analysé sous le seul prisme de l’immigration selon Pierre St-Laurent, chef de l’exploitation à Empire Company Limited qui insiste sur l’importance d’améliorer la productivité « tant pour les agriculteurs, les industriels que pour [les détaillants] ». Faisant écho à ce commentaire, James Donaldson, président‑directeur général de BC Food and Beverage, a recommandé d’octroyer du financement pour les technologies et l’automatisation chez les transformateurs d’aliments et de boissons afin de permettre que ce secteur « maîtrise les coûts, neutralise les risques touchant la main-d’œuvre, passe à une échelle supérieure et croisse ». Il a notamment appelé le gouvernement à repenser la manière dont les subventions à l’innovation sont octroyées pour mieux couvrir les besoins du secteur agricole et agroalimentaire :
La plupart des subventions à l’innovation et à la technologie octroyées par l’État ne s’appliquent pas à nos entreprises d’aliments et de boissons. Il faut élargir la définition d’« innovation » pour accorder à ce secteur un meilleur accès au financement par subventions et aux programmes spéciaux de financement qui lui seraient destinés.
Recommandation 8
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada encourage l’innovation dans le secteur agricole et agroalimentaire en :
- Lançant un programme d’incitation et de soutien à l’innovation technologique et à la mécanisation des productions agroalimentaires, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises;
- Consacrant un financement spécifique au secteur canadien des serres à l’aide du Fonds stratégique pour l’innovation par l’entremise d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Fiscalité
Les témoins ont partagé avec le Comité leurs opinions du rôle que la fiscalité joue en période inflationniste.
Selon certains témoins, le gouvernement devrait alléger la fiscalité pour limiter le fardeau financier sur les entreprises du secteur. Par exemple, M. Bourbeau a appelé au gouvernement fédéral à « freiner l’escalade de la taxe d’accise sur l’alcool » dont, à l’époque de son témoignage, l’augmentation était prévue à 6,3 %. En vertu de la Loi sur l'accise et de la Loi de 2001 sur l'accise, les taux du droit d'accise applicables aux boissons alcoolisées sont automatiquement indexés en fonction de l'Indice des prix à la consommation au début de chaque exercice (soit au 1er avril). Pourtant, dans son budget de 2023, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il plafonnera l'ajustement inflationniste des taux du droit d'accise applicables à la bière, aux spiritueux et au vin à 2 %, pour un an seulement, à compter du 1er avril 2023. M. Bourbeau a aussi demandé le gouvernement fédéral de « réduire le taux d’imposition fédéral des petites entreprises de 9 à 8 % ». Selon lui, ces mesures sont nécessaires pour pallier les difficultés auxquelles font face le secteur de la restauration.
Les systèmes de tarification de la pollution par le carbone au Canada représentent également un coût supplémentaire qui contribue à l’inflation selon plusieurs témoins[33]. Ian Boxall, président des Agrucultural Producers of Saskatchewan, a détaillé comment la redevance sur les combustibles fossiles affecte les profits des producteurs de la Saskatchewan :
Les coûts liés à cette taxe qui augmente le 1er avril de chaque année depuis quelques années rognent directement nos profits. Nous ne pouvons pas vraiment les transférer à quelqu'un d'autre. Nous colligeons des données sur ces coûts. Les chiffres montrent que les exploitations agricoles en Saskatchewan déboursent en moyenne un montant allant de 14 000 à 25 000 $ pour la taxe sur le carbone. Ces montants ne représentent que les données que nous avons colligées. Nous savons objectivement que la taxe sur le carbone est imposée à tout ce qui est transporté par train ou par camion.
Ne prenant pas position pour ou contre le système de tarification de la pollution par le carbone, M. Charlebois a toutefois appelé le gouvernement à étudier son impact sur « l'abordabilité des aliments à long terme ».
Les profits des entreprises
Malgré l’éventail des tensions inflationnistes dont il a été question précédemment, dans certains secteurs, les dirigeants de grandes sociétés ont déclaré des profits jamais vus, ce qui a amené certaines personnes à se demander si les sociétés ne contribuaient pas elles-mêmes à l’inflation en faisant augmenter les prix. Plusieurs économistes ont abordé ce sujet devant le Comité, mais leurs opinions variaient. Certains voient les profits réalisés récemment comme un indice que les grandes sociétés des principales industries tirent avantage du manque de concurrence pour faire d’énormes profits sur le dos des consommateurs. D’autres rejettent ce point de vue et croient plutôt que ces variations sont la preuve que les dirigeants des sociétés essaient simplement de s’assurer d’avoir des marges de profit stables dans un contexte économique difficile.
Rendement financier du secteur de l’épicerie
Les chaînes d’épicerie ont affirmé que leurs prix de détail reflétaient l’augmentation des coûts des ingrédients de base, de l’emballage, du transport et d’autres intrants. Elles ont rejeté les allégations selon lesquelles elles se servaient des perceptions du public relativement à l’inflation et aux problèmes dans la chaîne d’approvisionnement comme prétexte pour gonfler artificiellement leurs prix.
M. Littler a observé que la vente d’aliments au détail est un secteur à fort volume et à faible marge et que les grands détaillants ont habituellement des marges bénéficiaires faibles, mais stables, de l’ordre de 2 à 4 %. Une entreprise a estimé que sa marge bénéficiaire de 4 % correspondait, en moyenne, à un bénéfice d’un dollar pour chaque tranche d’achats de 25 dollars en magasin[34]. Cette analogie masque toutefois quelque peu le fait que les produits ont des marges différentes et que les épiceries ont diversifié leur offre, qui ne se limite plus aux produits alimentaires, pour inclure des articles à plus forte marge tels que les produits de santé et de beauté et les vêtements.
Loblaw a attribué l’amélioration de ses résultats financiers postpandémiques à la hausse des ventes de cosmétiques et de produits pharmaceutiques en vente libre, deux catégories de produits qui, selon ses explications, ont des marges bénéficiaires plus élevées que les produits alimentaires[35]. Galen G. Weston, président du conseil d’administration et président, Les Compagnies Loblaw limitée, a affirmé que son entreprise vendait à perte certains produits alimentaires de base, tels que le lait, l’huile végétale, le beurre et certains fromages, afin de rester concurrentielle. Metro a également fait état des ventes solides de sa division de pharmacie comme facteur principal expliquant ses récents bénéfices; selon l’entreprise, les marges plus importantes dans ce secteur lui permettaient d’absorber les marges plus serrées dans celui des aliments[36].
Les trois plus grandes chaînes d’épiceries du Canada ont indiqué que leurs rapports financiers trimestriels étayaient leurs affirmations selon lesquelles leurs marges bénéficiaires globales n’ont pas tellement changé depuis quatre ans. Même si les sociétés cotées en bourse qui exploitent ces chaînes produisent des rapports publics vérifiés pour se conformer à la réglementation provinciale sur les valeurs mobilières, ces documents visent surtout à fournir des informations financières aux actionnaires et aux autres investisseurs; ils ne portent généralement pas sur les ventes de produits alimentaires des entreprises. Comme l’a fait valoir un représentant de Loblaw[37], la chaîne fournit une analyse qualitative, mais non quantitative, des ventes d’aliments dans ses rapports financiers trimestriels. Par exemple, elle décrit la croissance des ventes au moyen de termes généraux tels que « modeste[38] » ou « nulle[39] ».
M. Charlebois a fait remarquer que son organisation avait examiné les bénéfices des chaînes d’épiceries à la lumière des données fournies dans les rapports financiers publiés par les entreprises ces cinq dernières années : « Nous n’avons pas trouvé de preuve de profitabilité sur tous les plans. » Le rapport d’étude indique cependant que la façon dont les grandes chaînes déclarent leurs ventes d’aliments ne permet pas de tirer de conclusions sur le rôle que jouent les marges sur les produits alimentaires dans leur rendement financier global. Il note, par exemple, que Loblaw regroupe en une seule catégorie ses ventes de produits alimentaires, de produits de santé, de produits de beauté, de vêtements et d’autres marchandises générales, ce qui rend impossible de démêler le rôle que les ventes d’aliments ont joué dans ses récents bénéfices trimestriels[40].
En réponse au manque relatif de données publiques concernant ces entreprises, certains ont cherché à analyser les tendances à l’échelle de l’industrie en utilisant un tableau de Statistique Canada qui regroupe les données de l’état des résultats financiers pour le secteur de la vente au détail d’aliments et de boissons. M. Stanford a déclaré au Comité que, selon son analyse, le revenu net du secteur avait augmenté de 120 % au cours des quatre derniers trimestres par rapport à 2019, et ce, même si le volume global des ventes des supermarchés avait diminué au cours de cette période. Ces données comprennent toutefois les ventes d’un large éventail de détaillants visés par le code 445 (magasins d’alimentation) du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), y compris les épiceries, mais aussi de détaillants de produits alimentaires spécialisés, tels que les boucheries, les marchés de fruits et légumes frais et les magasins d’alcools.
Profits des entreprises dans les secteurs au service de la chaine d’approvisionnement agro‑alimentaire
M. Stanford a expliqué que, d’après son analyse des données de Statistique Canada sur les profits des sociétés, 15 « secteurs stratégiques » de l’économie canadienne, dont ceux du pétrole et du gaz, des institutions bancaires, de la vente d’aliments et de boissons au détail, ainsi que de la production d’aliments et de boissons, avaient enregistré une augmentation de 142,9 milliards de dollars de leur revenu net annuel depuis 2019, tandis que l’ensemble des profits dans 37 autres secteurs avait diminué au cours de la même période.
D. T. Cochrane, économiste et chercheur en politiques, Canadiens pour une fiscalité équitable, a exposé son point de vue sur ce phénomène :
[L]a marge bénéficiaire des entreprises canadiennes a bondi considérablement en 2021. D’une marge moyenne avant impôt de 9 % au cours des deux décennies précédentes, elle est passée à près de 16 % en 2021. Les données préliminaires de 2022 portent à croire que les marges bénéficiaires sont restées élevées. Les entreprises ne se contentent pas de refiler leurs hausses de coûts aux consommateurs. Nombre d’entre elles profitent des turbulences de l’économie mondiale pour augmenter leurs marges bénéficiaires… La question de savoir qui peut refiler des coûts plus élevés au suivant, qui doit absorber des coûts plus élevés et qui peut refiler des coûts plus élevés encore au suivant dépend de l’équilibre des pouvoirs et du mode de redistribution. À l’heure actuelle, certaines des plus grandes entreprises du Canada ont un grand pouvoir de fixation des prix. Il n’est pas surprenant qu’elles en profitent, au détriment des Canadiens.
James Brander, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique, présent comme témoin à titre individuel, a reconnu que certaines entreprises, y compris les grandes chaînes de supermarchés, pouvaient avoir connu une hausse temporaire des profits, mais il a expliqué que, à son avis, de telles fluctuations étaient normales dans une optique de libre marché :
Les augmentations de prix agissent comme un signal. Souvent, de gros profits temporaires peuvent être réalisés, mais cela incite des concurrents potentiels à entrer ou à prendre de l'expansion sur le marché, et encourage les consommateurs à moins gaspiller. Je ferais remarquer que pendant la pandémie de COVID‑19, il y avait encore beaucoup trop de gaspillage au Canada. Quoi qu'il en soit, c'est exactement la réaction qu'il faut avoir: augmenter l'offre et diminuer la demande. L'imposition de contrôles des prix ou l'augmentation de l'impôt sur les profits auraient probablement un effet totalement contraire et aggraveraient les problèmes au lieu de les atténuer, comme nous l'avons appris quand nous avons tenté d'appliquer de telles solutions.
Certains témoins ont suggéré que la fiscalité peut jouer un rôle important dans le contexte inflationniste actuel comme outil de régulation des grandes entreprises de certains secteurs qui, selon elles, fixent des prix de détail qui ne correspondent pas à leurs coûts de production. Ils ont invité le gouvernement à se pencher sur les profits records enregistrés par certains secteurs de l’économie qui bénéficient fortement de l’inflation en raison de leur capacité de fixation des prix notamment l’industrie de l’extraction du pétrole et du gaz, du raffinage, l’immobilier et le secteur bancaire[41]. Plusieurs témoins ont souligné l'importance de l'énergie, y compris le pétrole et le gaz, en tant qu'intrants essentiels tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et ont expliqué qu'ils ont contribué de manière significative à l'augmentation des coûts et des prix[42].
Pour M. McCain, il est également nécessaire que le gouvernement fasse des efforts pour ce qu’il a qualifié de meilleure « maîtrise des dépenses pour entraver l'inflation globale ». M. McCain a toutefois reconnu que l’inflation était un phénomène mondial et que cette discipline fiscale devrait s’appliquer à « l'échelle des économies mondiales ».
Recommandation 9
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada, si le Bureau de la Concurrence établit lors de son étude de marché à venir que les grandes chaînes d’épiceries réalisent des profits excessifs sur les produits alimentaires, devrait envisager l’instauration d’un impôt sur les bénéfices exceptionnels applicables aux grandes entreprises qui fixent les prix afin de dissuader les hausses excessives des marges bénéficiaires pour ces produits.
Relations et concurrence dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire
Relations dans la chaîne d’approvisionnement
Les témoins représentant le secteur de la production primaire ont expliqué que le coût des intrants essentiels, comme le carburant et l’engrais, atteint des sommets historiques, mais que les prix des produits de base qu’ils reçoivent à la ferme n’ont pas augmenté au même rythme[43]. Cet écart de prix force certains producteurs à absorber les récentes hausses de coûts plutôt que de les répercuter sur la chaîne d’approvisionnement. À ce sujet, Statistique Canada fait remarquer que, malgré les bons résultats enregistrés dans certains secteurs, la plupart des exploitations agricoles canadiennes devraient connaître une baisse de leur revenu net d’exploitation moyen en raison de l’accroissement des dépenses[44].
Les fabricants de produits alimentaires et de boissons, dont la plupart sont de petites et moyennes entreprises comptant moins de 100 employés[45], ont également fait état de dépenses opérationnelles plus élevées et d’une incapacité à répercuter ces coûts sur leurs clients, qui sont de plus en plus soucieux des coûts, en particulier les grands détaillants en alimentation. Bien qu’un témoin ait expliqué que certaines multinationales de la fabrication d’aliments, telles que PepsiCo et la Kraft Heinz Company, ont des marges bénéficiaires stables comprises entre 11 et 14 %[46], le Comité a appris que ces marges n’étaient pas typiques de la plupart des transformateurs, dont bon nombre ont subi une baisse marquée de la marge bénéficiaire au cours des derniers mois[47].
Négociations entre les fournisseurs et les détaillants sur les prix
Les fournisseurs, dont les agriculteurs, les grossistes et les fabricants de produits alimentaires qui vendent directement aux grandes chaînes d’épiceries, ont expliqué qu’ils sont tenus de négocier des arrangements en matière d’approvisionnement avec les détaillants bien avant la livraison, ce qui complique souvent pour eux l’obligation de s’adapter aux chocs soudains, tels que les récentes pressions inflationnistes ou les événements météorologiques extrêmes. Catherine Lefebvre, présidente de l’Association des producteurs maraîchers du Québec, a décrit le processus par lequel les détaillants attribuent des prix aux produits frais :
[L]es négociations se font longtemps à l’avance. […] La négociation se fait avec deux ou trois fournisseurs en même temps pour le même produit. Peu importe le prix qui va sortir […], c’est le moins offrant qui va obtenir la commande. Si le plus offrant veut obtenir la commande, il va devoir baisser son prix au même niveau que celui du moins offrant, sinon la totalité de la commande ira au meilleur offrant. Cependant, la production est établie en fonction d’un contrat initial qui a été approuvé par les deux parties, tant le producteur que la chaîne de supermarchés. […] Si la chaîne de supermarchés fait produire, disons, 10 000 boîtes de laitues par semaine et qu’elle n’en prend que 2 000, on ne sait pas quoi faire avec les 8 000 boîtes de laitues qui restent. On préfère alors vendre au rabais que de laisser les laitues aux champs et les jeter. Selon moi, la négociation n’est pas bilatérale. C’est toujours le plus fort ou le prix le plus bas qui l’emporte.
M. Léger Bourgoin a en outre expliqué que les producteurs maraîchers canadiens sont également en concurrence sur le plan des prix avec des producteurs internationaux, qui ne sont pas assujettis à une réglementation aussi strictes que celle du Canada :
Lorsque les asperges fraîches du Québec arrivaient en épicerie dans les années passées, on favorisait les produits du Québec. Cette année, on a mis les asperges du Québec en concurrence avec des asperges provenant de l'Amérique latine. De manière purement comptable, il est impossible, pour un producteur québécois, compte tenu de la réglementation environnementale et des lois du travail, de rivaliser avec les coûts de production des pays d'Amérique latine.
Recommandation 10
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada assure le respect de la réciprocité des normes sur les produits importés, augmente les inspections pour assurer la conformité et demander aux produits étranger la même qualité que les produits domestiques, tant niveau des normes environnementales que celles relatives au travail.
Les fournisseurs ont expliqué au Comité qu’ils avaient demandé à ces chaînes d’augmenter les prix de détail de leurs produits afin de mieux refléter les conditions du marché. Ils ont toutefois fait remarquer que le processus d’ajustement des coûts peut être long et fastidieux[48]. Certains ont indiqué qu’il leur était difficile de joindre les détaillants pour discuter de questions commerciales[49].
Les représentants des trois plus grandes sociétés d’alimentation du Canada (Loblaw inc., Empire inc., qui exploite les chaînes Sobeys et Safeway, et Metro inc.) ont dit avoir reçu, de la part des fournisseurs, un grand nombre de demandes pour ajuster les prix de vente de leurs produits. M. Hussain a expliqué par exemple que le nombre de demandes d’augmentation des prix présentées par les fournisseurs au Loblaw était « monté en flèche » depuis trois ans et qu’il avait atteint des « sommets sans précédent » en 2022. M. Hussain a ajouté que son entreprise évaluait ces demandes en fonction des conditions du marché et qu’elle les approuvait lorsqu’elle les jugeait justifiées – ce qui n’était pas toujours le cas.
Pour illustrer cette dernière approche, M. Hussain a mentionné le litige qui a opposé Loblaw au producteur de grignotines Frito‑Lay en 2022. Il a affirmé que la chaîne avait refusé d’accepter ce qu’elle considérait comme des augmentations injustifiées des prix des produits du fabricant; en conséquence, le fabricant avait refusé de lui livrer ses produits pendant plusieurs mois.
Des représentants du secteur de la fabrication de produits alimentaires ont fait remarquer que les détaillants refusaient ne serait-ce que d’envisager la modification des coûts pendant les périodes où ils imposent un gel unilatéral des prix[50]. François Thibault, vice‑président exécutif, chef de la direction financière et trésorier de Metro inc., a indiqué par exemple que Metro avisait ses fournisseurs qu’elle ne traitait pas les demandes d’augmentation de prix soumises pendant la période précédant les Fêtes.
Dans son rapport de 2021 sur les frais imposés par les détaillants, le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les frais imposés par les détaillants a reconnu l’existence de périodes de gel des prix décidées par les détaillants :
Les détaillants alimentaires imposeront unilatéralement un gel des prix (c.‑à‑d. des périodes de coupure obligatoires) pendant lesquelles il sera interdit aux fournisseurs de demander des augmentations de prix. Elles coïncident généralement avec les périodes de vacances (p. ex. de septembre à janvier). Si les fournisseurs doivent faire face à une augmentation du prix des ingrédients pendant cette période, ils doivent reporter l’augmentation de leur prix et, dans certains cas, ils doivent donner au détaillant un préavis de douze semaines. Si le détaillant accepte le nouveau prix, l’augmentation est valable à partir de la date d’acceptation et n’est pas antidatée à la date de la notification initiale.
Plusieurs témoins ont mis en lumière le déséquilibre de pouvoir entre les petits fournisseurs, qui se comptent par milliers, et les trois grandes chaînes d’épiceries, qui détiennent chacune une part de marché importante[51]. Un témoin a également souligné la difficulté, pour un grand nombre de petits producteurs et de petites entreprises, de négocier des contrats avec les grandes sociétés nationales, et ils ont demandé de pouvoir disposer d’outils et de ressources qui leur permettraient de mieux connaître leurs droits durant les négociations et la façon dont diverses modalités contractuelles risquent de se faire sentir sur leurs activités[52].
Les fournisseurs et d’autres observateurs ont également noté qu’il existait une asymétrie d’information dans la chaîne d’approvisionnement lorsqu’il fallait négocier avec les détaillants. Plusieurs groupes, notamment dans le secteur de la production primaire, ont indiqué qu’il n’y avait pas suffisamment de données publiques au Canada pour leur permettre de comprendre comment les prix sont déterminés à mesure que les ingrédients bruts passent par la chaîne d’approvisionnement. Ils ont aussi cité des exemples internationaux d’initiatives gouvernementales qui visent à rendre ce genre de données accessibles au public et plus transparentes pour les producteurs, les transformateurs et les consommateurs, comme l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires en France. Ils ont encouragé le gouvernement fédéral de recueillir et rendre public des données similaires au Canada[53].
Comme l’indique le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les frais imposés par les détaillants, certains fournisseurs perçoivent les demandes d’informations des détaillants, y compris la ventilation des coûts des intrants, comme un conflit d’intérêts, parce que ces informations donnent aux détaillants un avantage concurrentiel dans la fabrication de leurs propres produits de marque privée. Plusieurs témoins du secteur de la vente au détail ont expliqué au Comité que, dans les dernières années, ils avaient augmenté leur offre de produits alimentaires sous leur marque privée afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de rechange moins chères aux produits de marque[54]. M. Donaldson a reconnu qu’un grand nombre d’entreprises de transformation faisaient face à des « choix difficiles » concernant les produits de marque privée :
Fait intéressant, nous avons observé un véritable changement chez les détaillants. On y trouve en effet de plus en plus de produits de marque privée sur les étagères de leurs magasins, et cette approche est en voie de devenir une priorité stratégique pour ces détaillants, ce qui réduit la place qu’occupent les produits de marque que nos membres représentent. D’une part, cela leur est utile; beaucoup de nos membres sont actifs dans ce créneau. D’autre part, nous sommes préoccupés par l’incidence à long terme sur les produits de marque qui seront sur les étagères. Beaucoup d’acteurs font la fabrication de marques privées. Nous savons que les détaillants ne vendront pas les produits de marque des fabricants et privilégieront leur marque privée.
M. Donaldson a ajouté qu’il arrivait souvent que les détaillants ne respectent pas les modalités contractuelles de paiement, une pratique qui nuisait de manière disproportionnée aux petits transformateurs, qui doivent payer immédiatement leurs propres fournisseurs, mais attendent fréquemment jusque bien après la période de paiement prévue au contrat pour se faire payer par les détaillants :
Les petites entreprises qui ont une entente prévoyant un paiement dans 15 jours ne reçoivent en fait le paiement que dans 60 à 90 jours. Les grands détaillants peuvent attendre cet argent, car ils font des millions de dollars en intérêts, mais ces délais mettent à risque les petites entreprises.
Frais imposés par les détaillants
À chaque étape de leurs transactions commerciales, les détaillants en alimentation imposent une grande variété des frais aux producteurs. Les fournisseurs sont tenus de payer aux détaillants des frais pour l’espace d’étalage en magasin et des frais de marchandisage[55]. D’autres frais ont un caractère punitif et s’appliquent aux livraisons de produits en retard ou non conformes à la quantité négociée. Certaines chaînes appliquent également un système d’alignement des prix qui permettent aux consommateurs de payer le prix réduit d’un concurrent sur un produit, tout en exigeant que le fabricant paie la différence au détaillant. D’autres frais, que les chaînes appellent parfois « contributions », sont conçus pour aider les détaillants à récupérer les coûts associés aux projets d’expansion de leurs activités, comme le réaménagement de leurs magasins ou le développement de plateformes de commerce électronique[56].
Les détaillants en alimentation ont défendu ces frais, affirmant qu’ils sont transparents, négociés avec les vendeurs au cours du processus contractuel et, en ce qui concerne tout particulièrement les frais relatifs à l’alignement des prix, qu’ils aident à maintenir des prix alimentaires bas pour les consommateurs[57].
Les fournisseurs déplorent la facturation souvent peu claire de frais par les détaillants. Scott Ross, directeur exécutif de la Fédération canadienne de l’agriculture, a indiqué que certains agriculteurs membres de son organisation estiment que les détaillants imposent fréquemment des frais de façon arbitraire, sans fournir d’explication :
[L]’un des motifs d’exaspération qui reviennent sans cesse, c’est que les agriculteurs ne comprennent pas ce qui se cache derrière les calculs des frais qui sont déduits du prix versé. Il n’y a pas nécessairement de liste détaillée de ces frais. Les agriculteurs nous répètent sans cesse qu’il y a un manque fondamental de transparence.
M. Donaldson a fait remarquer que les fabricants canadiens de produits alimentaires qui font affaire aux États‑Unis ne sont pas assujettis à ces frais et contributions obligatoires; au Canada, ils se font souvent imposer des frais imprévisibles par les détaillants, parfois pour des produits livrés il y a longtemps :
Avec les détaillants américains, il n’y a pas de soucis liés aux amendes, aux aliments pour animaux et aux dépenses de programme ou encore aux ajustements de paiements rétroactifs. Ici, les transformateurs qui sont censés recevoir un chèque peuvent très bien se voir enlever une somme de 50 000 $ ou de 60 000 $ pour un ajustement rétroactif qui remonte à deux ou trois ans. Il est impossible de tenir compte de tous ces éléments et de planifier en conséquence.
Les témoins provenant des secteurs de la production et de la transformation ont été quasi unanimes à réclamer un plus grand équilibre dans la relation entre les fournisseurs et les détaillants. À cet égard, plusieurs représentants ont mis en évidence la nécessité, pour les entreprises de bénéficier d’une plus grande « certitude en matière de contrats » dans le cadre de leurs relations avec les détaillants[58]. Le Comité a également appris que certains détaillants ont adopté une approche différente de ces questions. Costco, par exemple, a expliqué qu'il avait élaboré un code de déontologie interne qui mettait l'accent sur le travail en partenariat avec les vendeurs pour résoudre les litiges plutôt que sur l'imposition unilatérale de frais[59].
Élaboration et mise en œuvre d’un code de conduite du secteur de l’épicerie
Une solution susceptible d’assurer un meilleur équilibre entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement est un code de conduite qui établit un cadre transparent et normalisé pour des questions telles que les frais imposés par les détaillants, les hausses de prix et les négociations sur les coûts. Des codes du genre sont actuellement en vigueur au Royaume‑Uni et en Australie. En avril 2021, le Comité, prenant acte des préoccupations exprimées par les producteurs et les transformateurs canadiens, a recommandé que le gouvernement du Canada « aide les provinces à mettre en œuvre un code de conduite pour les épiceries et qu’il participe à l’élaboration de ce code en collaboration avec les provinces et dans le respect de leurs compétences et des lignes directrices du bureau de la concurrence[60] ».
En novembre 2020, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture (les ministres FPT) ont annoncé la création d’un groupe de travail composé de représentants sectoriels et d’experts de l’industrie afin de se pencher sur les frais que les détaillants en alimentation facturent aux fournisseurs et de formuler des recommandations sur la façon de créer un équilibre dans la relation entre les épiciers et les fournisseurs[61]. En juillet 2021, le Groupe de travail fédéral‑provincial‑territorial sur les frais imposés par les détaillants a publié un rapport dans lequel il exposait ses conclusions et recommandait la nomination d’un comité directeur de l’industrie chargé d’élaborer un code de conduite officiel des épiceries.
Le comité directeur, composé de 10 membres représentant les détaillants et les producteurs d’aliments, tient depuis deux ans des négociations visant à établir les dispositions du code de conduite. Selon le rapport provisoire de juillet 2022 remis aux ministres FPT, le comité directeur a eu du mal à parvenir à un consensus sur plusieurs points, notamment le processus de hausse des coûts/prix, les déductions liées à l’alignement des prix, de même que les paiements, les déductions, les amendes et les frais[62].
En janvier 2023, Agriculture et Agroalimentaire Canada a publié une déclaration annonçant qu’un « progrès substantiel » avait été réalisé dans l’élaboration du code et que l’industrie et les ministres FPT se tournaient maintenant vers l’étape « de sa mise en œuvre ». La déclaration encourage les organisations du secteur agroalimentaire à participer à la consultation sur le code, de manière à en assurer « l’adoption volontaire et à grande échelle » dans l’ensemble de l’industrie. Deux témoins a fait savoir au Comité que leurs entreprises avaient reçu une version préliminaire du code de conduite et qu’ils étaient en train de l’examiner pour déterminer s’ils allaient y participer[63]. Une autre témoin a expliqué que le comité directeur a fixé la date provisoire du 20 janvier 2024 pour la mise en œuvre du code[64].
Plusieurs témoins ont souligné la nécessité de rendre le code « obligatoire et exécutoire[65] ». Selon eux, un code volontaire permettrait aux chaînes qui choisissent de ne pas y participer de compromettre son efficacité globale. De même, ils estiment qu'un code qui n'oblige pas les participants à s'y conformer, mais qui se contente de fournir des lignes directrices générales pour les transactions commerciales, ne serait pas en mesure de résoudre les problèmes que le code est censé aborder, notamment le déséquilibre de pouvoir entre les petits fournisseurs et les grandes chaînes.
Les deux codes de conduite mentionnés plus haut ont adopté des approches différentes à cet égard. L’Australie, laquelle comme le Canada est une fédération composée d’états qui sont compétents en ce qui concerne les transactions commerciales, a choisi de rendre son code volontaire. Par contre, le code de pratique au Royaume-Uni est inscrit dans la loi, obligatoire pour les détaillants en produits d'épicerie dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de livres et appliqué par le Groceries Code Adjudicator, un organisme de réglementation indépendant.
Recommandation 11
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires – en partenariat avec les parties prenantes de l'agriculture et de l'industrie alimentaire – afin de mettre en œuvre un code de conduite obligatoire et exécutoire qui couvre les aliments et autres produits essentiels vendus à l’épicerie, et qu'il incite l’industrie alimentaire à le réviser après un an d’application.
Consommateurs
Les groupes de défense des droits des consommateurs ont indiqué qu’ils s’inquiétaient de l’impact qu’un code pourrait avoir sur les consommateurs. John Lawford, directeur exécutif et avocat général, Centre pour la défense de l’intérêt public, a expliqué que le Code pourrait entrainer une hausse des frais pour les consommateurs si les grandes chaînes de supermarchés cherchent à récupérer le manque à gagner lié à la suppression des frais de fournisseur en augmentant les prix de détail. M. Lawford s’est prononcé en faveur d’un réexamen du code un an après sa mise en œuvre afin d’examiner son impact à la fois sur la relation fournisseur-détaillant et sur les consommateurs.
Ken Whitehurst, directeur général, Conseil des consommateurs du Canada a souligné l’absence de consultation des consommateurs lors de la rédaction du code et a expliqué que son organisation surveillera l’impact du code sur les consommateurs. Pour répondre à ces préoccupations, M. Whitehurst a demandé au gouvernement du Canada de créer un poste de protecteur des consommateurs pour défendre les intérêts des consommateurs au sein du gouvernement fédéral dans tous les secteurs.
M. Whitehurst a mis l'accent sur la pratique commerciale de la « réduflation », qui consiste pour les fabricants de produits alimentaires et les détaillants à réduire la taille ou la quantité d'un produit tout en maintenant ou en augmentant son prix. Il a décrit cette pratique comme mettant à mal « la confiance [des consommateurs] dans les détaillants, les producteurs et le gouvernement ». Pour y remédier, il a encouragé le gouvernement fédéral à mettre en place un système d’affichage du prix par unité de mesure obligatoire, sur le modèle des règles actuellement en vigueur au Québec, pour l’ensemble du Canada.
Recommandation 12
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, adopte une approche normalisée concernant les pratiques d'étiquetage des prix unitaires dans le secteur de l’épicerie afin d’aider les consommateurs canadiens à faire des achats éclairés.
Concurrence dans le secteur de l’épicerie
Concentration dans le secteur de l’épicerie
Certains témoins se sont inquiétés de ce qu’ils considèrent comme un manque de concurrence dans le secteur canadien de l’épicerie, problème qu’ils attribuent principalement à la position dominante des grandes chaînes de supermarchés du pays dans le marché. Selon eux, cette position dominante offre moins de débouchés aux producteurs et aux transformateurs, pour qui il est plus difficile d’accéder au marché et de négocier des conditions contractuelles favorables, sans compter qu’ils ont peu d’options si un épicier décide de « retirer » leurs produits du marché. Plusieurs témoins ont également fait remarquer que les allégations selon lesquelles de grandes chaînes d'alimentation se seraient entendues pour fixer le prix du pain et mettre fin aux primes de pandémie accordées à leurs employés ont entamé la confiance du public canadien dans ce secteur[66]. De même, de récents reportages des médias selon lesquelles les chaînes de supermarchés canadiennes réalisent des bénéfices records[67] et accordent des primes aux dirigeants[68] ont conduit certains à se demander si ce secteur fonctionne de manière concurrentielle et dans l'intérêt du public.
Les représentants des trois plus grandes chaînes d’épiceries du Canada se sont dit en désaccord avec cette analyse; à leur avis, l’alimentation de détail est un marché très concurrentiel, où les bannières se disputent férocement les consommateurs. Ces chaînes ont souligné qu’elles se font non seulement la concurrence les unes les autres dans la plupart des régions du pays, mais qu’elles affrontent aussi de grandes chaînes multinationales, comme Walmart et Costco, ainsi que des acteurs émergents du commerce électronique alimentaire, tels qu’Amazon, qui a fait l’acquisition du détaillant Whole Foods en 2017.
Les statistiques montrent que le secteur canadien de l’épicerie se concentre de plus en plus depuis une vingtaine d’années, les chaînes nationales ayant fusionné avec des chaînes régionales plus petites ou les ayant rachetées. Selon une publication d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), les cinq plus grands distributeurs alimentaires du Canada représentaient 60 % du marché de l’épicerie du pays en 2003[69]. Deux décennies plus tard, à la suite de regroupements, notamment le rachat des magasins A&P par Metro en 2005 et l’acquisition de Safeway par Sobey en 2013, cette proportion est passée à 80 %, selon une estimation citée par AAC[70].
M. Cochrane a mis en garde le comité contre le fait de « trop miser sur la concurrence » dans le secteur. Il a fait valoir que les grandes chaînes d’alimentation sont mieux placées pour s’opposer aux augmentations de coûts injustifiées des grands fournisseurs :
[L]es épiciers doivent transiger avec des fournisseurs qui sont souvent des sociétés transnationales gigantesques. Nous en avons eu un exemple retentissant avec la lutte entre Frito-Lay et Loblaws. Si Loblaws a réussi à refuser l'augmentation de prix que Frito-Lay voulait lui imposer, c'est en partie parce qu'il est une grosse pointure dans l'industrie…Je ne veux pas nécessairement dire que Loblaws était en quelque sorte du côté des Canadiens dans cette lutte. Cela montre toutefois qu'il faut parfois être gros pour résister aux autres gros acteurs.
M. Cochrane a toutefois fait remarquer que même si les grandes chaînes peuvent jouer un rôle légitime dans le secteur, elles doivent être réglementées de manière appropriée.
Les pouvoirs du Bureau de la concurrence
Plusieurs témoins ayant remarqué la concentration accrue des chaînes d’épiceries au Canada se sont demandé si le régime de concurrence du pays assurait une surveillance adéquate du secteur de l’épicerie. Au niveau fédéral, ce régime est constitué principalement de la Loi sur la concurrence (la « Loi »), qui est appliquée par le Bureau de la concurrence, un organisme indépendant d’application de la loi qui est chargé de promouvoir et assurer la concurrence dans le marché canadien. Entre autres activités, le Bureau enquête sur les infractions à la Loi et examine les fusions d’entreprises pour s’assurer qu’elles ne rendent pas les marchés moins concurrentiels pour les consommateurs[71].
Le Bureau de la concurrence a mené, dans les dernières années, plusieurs activités liées au secteur canadien de l’épicerie au cours des dernières années, dont des examens sur plusieurs fusions et acquisitions de chaînes de supermarchés[72] et des enquêtes sur des plaintes voulant que Loblaw ait manipulé des fournisseurs afin de réduire la concurrence dans le secteur[73]. Depuis 2017, le Bureau enquête sur des allégations présentées par des cadres de Loblaw, selon lesquelles la chaîne aurait conspiré avec quatre autres chaînes d’épiceries et deux producteurs de pain pour fixer les prix de gros et de détail du pain dans leurs magasins entre 2001 et 2015. Le Bureau a indiqué que son enquête sur cette affaire était en cours. Lors de leur comparution devant le Comité, les chefs de la direction d’Empire et de Metro ont tous deux nié que leurs entreprises étaient impliquées dans la fixation des prix du pain.
Comme il a été mentionné précédemment, certains témoins ont exprimé leur insatisfaction à l’égard d’activités récentes du Bureau de la concurrence dans ce secteur. Plusieurs ont affirmé que l’organisme américain correspondant, la Federal Trade Commission (FTC), faisait figure d’exemple : cet organisme de réglementation de la concurrence, selon eux, surveille le secteur de l’épicerie plus efficacement. Plusieurs témoins ont attiré l’attention sur l’examen mené par la FTC concernant le projet de fusion entre Albertsons et Kroeger, deux grandes chaînes d’épicerie américaines; selon eux, le processus a été plus rigoureux que les examens effectués par le Bureau[74]. Certains ont également soutenu que les enquêtes du Bureau – notamment celle en cours sur les prix du pain – sont trop longues et donnent l’impression que le Bureau ne dispose pas des ressources nécessaires pour surveiller efficacement la concurrence dans le secteur[75].
Lors de leur comparution devant le Comité, les représentants du Bureau ont défendu le travail de l’organisation et rappelé que celle‑ci œuvrait dans les limites du droit canadien de la concurrence. Ann Salvatore, sous‑commissaire à la Direction des cartels au Bureau de la concurrence, a fait remarquer que les affaires de complot, comme celle impliquant des chaînes d’épiceries qui se sont concertées pour fixer le prix du pain entre 2001 et 2015, étaient complexes et exigeaient d’examiner une grande quantité de preuves. Mme Salvatore a ajouté que le Bureau avait exécuté 24 mandats de perquisition différents dans le cadre de son enquête sur cette affaire.
Le Bureau a également reconnu que le cadre réglementaire canadien en matière de concurrence devait être mis à jour pour suivre l’évolution du mode de fonctionnement des entreprises. Il a indiqué que le gouvernement du Canada avait tenu des consultations – conclues en mars 2023 – sur la meilleure façon de moderniser son cadre de concurrence.
Étude de marché sur la concurrence dans le secteur canadien de l’épicerie
Le 24 octobre 2022, le Bureau a annoncé qu’il mènerait une « étude de marché » sur les pratiques concurrentielles dans le secteur de l’épicerie au Canada. Cette étude permettra de recommander des façons dont les différents ordres de gouvernement peuvent accroître la concurrence dans ce secteur au profit des consommateurs, qui subissent, de l’avis du Bureau, des hausses de prix supérieures au taux global de l’inflation dans le secteur de l’alimentation. Dans son avis d’étude, le Bureau précise qu’il n’explorera pas les pratiques commerciales entre les détaillants et les fournisseurs de produits alimentaires, car le groupe de travail de l’industrie chargé d’élaborer un code de conduite des épiceries étudie actuellement cette question.
L’avis fait aussi une distinction entre ce type d’étude et les enquêtes que le Bureau mène normalement sur les violations présumées de la Loi sur la concurrence. En entreprenant cette étude, le Bureau ne réagit pas à une infraction à la Loi ou à une plainte déposée en vertu de celle-ci, mais il souhaite plutôt mener une vaste enquête pour examiner comment les gouvernements peuvent s’attaquer au problème des prix élevés à l’épicerie en encourageant une plus grande concurrence dans le secteur. Le Bureau affirme cependant que, s’il découvre des pratiques illégales durant l’enquête, il les examinera.
Contrairement aux autorités chargées de la concurrence qui ont mené des études similaires dans d’autres pays, le Bureau de la concurrence n’a pas le pouvoir de contraindre les entreprises privées à fournir des informations sur leurs pratiques commerciales dans le cadre d’une telle étude. Par conséquence, le Bureau doit compter sur la coopération des entreprises qui font la cible de cette étude.
Dans son témoignage, Anthony Durocher, sous‑commissaire de la Direction générale de la promotion de la concurrence au Bureau de la concurrence, a dit que le Bureau n’obtenait pas « l’entière coopération que nous souhaiterions de la part de tous dans le cadre de cette étude », et que, par conséquent, il ne pourrait pas mener une étude « aussi rigoureuse et approfondie » qu’il le voulait. M. Durocher a cependant précisé que les participants à l’étude faisaient part « de leur point de vue en toute franchise ». Les représentants de Loblaw, d’Empire, de Metro, de Walmart et de Costco ont dit au Comité que leurs entreprises communiquaient des informations au Bureau de la concurrence dans le cadre de l’étude[76].
Le Comité observe que ces représentants l'ont assuré que le Bureau serait en mesure de déterminer, à partir des informations qu'ils ont fournies, dans quelle mesure les bénéfices de leurs entreprises peuvent être attribués aux marges alimentaires, par opposition à leurs divisions pharmaceutiques ou à d'autres catégories de produits. Les commentaires du Bureau sur leur coopération laissent toutefois planer un doute sur la mesure dans laquelle ce type d'analyse sera possible.
M. Durocher a souligné l’importance des pouvoirs de la collecte de renseignements à la capacité du Bureau de mener des études de marché substantielles :
Lorsque nous entreprenons une étude de marché pour tenter d'éclairer le gouvernement quant à ses politiques, nous n'avons pas la même capacité de recueillir ces données et renseignements. Nous travaillons à partir de renseignements d'ordre public ou de ceux qu'on nous fournit volontairement, ce qui limite manifestement la profondeur de nos analyses et la qualité de nos recommandations… À notre avis, en tout respect, il est très important que nous soyons capables d'ordonner la production d'information pour mener ce type d'études convenablement et informer le gouvernement de nos conclusions.
En mars 2023, dans le cadre des consultations menées par le gouvernement du Canada sur sa politique de la concurrence, le Bureau a soumis plusieurs recommandations de modifications législatives pour renforcer ses pouvoirs de la collecte de renseignements. L’une de ces recommandations est la modification de la Loi afin de formaliser son autorité indépendante de lancer une étude de marché et de lui accorder le pouvoir d’exiger des renseignements des entités privées qui en font l’objet[77].
Recommandation 13
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada renforce le mandat du Bureau de la concurrence et sa capacité d’assurer une meilleure concurrence dans le secteur de l’épicerie canadien en :
- Modifiant la Loi sur la concurrence pour donner au Bureau de la concurrence le pouvoir d’exiger la communication de renseignements pertinents par des entreprises et des particuliers dans le cadre d’une étude de marché, dont des états financiers ventilés;
- Révisant les seuils de concurrence utilisées dans l’évaluation des transactions et en examinant les régimes de fusion des entreprises pour assurer une meilleure concurrence;
- Étudiant l’opportunité de mettre en place une commission administrative permanente à l’image de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires de la France qui a pour mission d’analyser les données reliées à la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires;
- Examinant les conclusions et les recommandations que la Bureau de la concurrence adressera au gouvernement fédéral dans sa prochaine étude de marché sur le secteur canadien de l’alimentation, notamment en ce qui concerne les mécanismes de fixation des prix, les périodes de refus d’ajustement, le partage des revenus entre les différents maillons de la chaine agroalimentaire et les barrières à l’entrée auxquelles sont confrontées les nouvelles entreprises qui s’implantent dans ce secteur.
Conclusion
L’inflation du prix des aliments touche à un aspect fondamental de la vie des Canadiens : leur capacité à se nourrir convenablement. Bien qu’elle soit en partie causée par des phénomènes mondiaux, notamment la hausse du coût des intrants et des carburants, les relations dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ont une influence majeure dans la manière dont les prix se transmettent dans la chaîne d’approvisionnement et se répercute ultimement sur le consommateur. En étant la principale source d’approvisionnement pour bien des Canadiens et le principal débouché pour de nombreux producteurs et transformateurs, le secteur de l’épicerie a un rôle critique dans ces relations. Aussi, cette étude a mis en évidence la nécessité d’accroître la transparence dans le secteur de l’épicerie et de renforcer sa collaboration avec les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement afin que les relations commerciales entre chaque maillon de la chaîne soient équitables. Le gouvernement fédéral a un rôle important de coordination avec ces groupes ainsi qu’avec ses partenaires provinciaux et territoriaux dans ce contexte. Le soutien du gouvernement est également clé pour aider l’ensemble du secteur agricole et agroalimentaire à composer avec les risques que cette période inflationniste génère pour les entreprises et pour la sécurité alimentaire des Canadiens.
[1] Statistique Canada, « Indice des prix à la consommation, février 2023 », Le Quotidien, 21 mars 2023.
[2] Statistique Canada, « Revenu agricole, 2021 (données révisées) », Le Quotidien, 28 novembre 2022.
[3] Statistique Canada, Dépenses alimentaires détaillées, Canada, régions et provinces, base de données, consultée le 4 avril 2023.
[4] Statistique Canada, Éléments du bilan et de l’état des résultats financiers trimestriels ainsi que certains ratios, selon les branches d’activité non financières, données non désaisonnalisées (x 1 000 000), base de données, consultée le 4 avril 2023.
[5] Chambre des communes, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire [AGRI], Procès-verbal, 5 octobre 2022.
[6] AGRI, Témoignages, Matthew MacDonald (directeur adjoint, Division des prix à la consommation, Statistique Canada).
[7] Ibid.
[8] AGRI, Témoignages, Ian Lee (professeur agrégé, Sprott School of Business, Université Carleton, à titre personnel), James Brander (professeur, Université de la Colombie‑Britannique, à titre personnel), Matthew MacDonald (Statistique Canada), Galen G. Weston (président du conseil d’administration et président, Les Compagnies Loblaw limitée [Loblaw]), Eric La Flèche (président et chef de la direction, Metro inc. [Metro]) et Michael Medline (président et chef de la direction, Empire Company Limited [Empire]).
[9] AGRI, Témoignages, Philip Vanderpol (président du Conseil d’administration, Association des transformateurs laitiers du Canada).
[10] AGRI, Témoignages, Neil Hetherington (président-directeur général, Daily Bread Food Bank).
[11] Statistique Canada, « Enquête canadienne sur le revenu, 2021 » dans Le Quotidien, 2 mai 2023.
[12] Malek Batal et coll., « First Nations households living on-reserve experience food insecurity: prevalence and predictors among ninety-two First Nations communities across Canada » dans La revue canadienne de santé publique, 2021 [disponible en anglais seulement].
[13] Statistique Canada, « Enquête canadienne sur le revenu : estimations territoriales, 2020 », dans Le Quotidien, 3 novembre 2022.
[14] AGRI, Témoignages, Le chef Byron Louis (Okanagan Indian Band, Assemblée des Premières Nations).
[15] AGRI, Témoignages, Tyler McCann (Institut canadien des politiques agroalimentaires).
[16] AGRI, Témoignages, Michael H. McCain (president-directeur du conseil d’administration et chef de la direction, Aliments Maple Leaf inc.).
[17] AGRI, Témoignages, Neil Hetherington (Daily Bread Food Bank).
[18] National Zero Waste Council, Less Food Loss and Waste, Less Packaging Waste, 2020, p. 87 [disponible en anglais seulement].
[19] AGRI, Témoignages, Michael Graydon (chef de la direction, Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada), Karl Littler (vice-président principal, Affaires publiques, Conseil canadien du commerce de détail), Sylvie Cloutier (présidente-directrice générale, Conseil de la transformation alimentaire du Québec), Philip Vanderpol (Association des transformateurs laitiers du Canada) et Sébastien Léveillé (chef de la direction, Groupe Nutri).
[20] AGRI, Témoignages, Mary Robinson (présidente, Fédération canadienne de l'agriculture), Martin Caron (président général, Union des producteurs agricoles), James Donaldson (président-directeur général, BC Food and Beverage, Aliments et boissons Canada), Ian Boxall (président, Agricultural Producers Association of Saskatchewan) et Denise Allen (présidente et directrice générale, Fabricants de produits alimentaires du Canada).
[21] Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Marché mondial des engrais : bilan du resserrement actuel du marché, 2022.
[22] Gouvernement du Canada, « Le Canada retire la Russie et le Bélarus du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée », communiqué de presse, 3 mars 2022.
[23] Gouvernement du Canada, Budget 2023 : Un plan canadien, une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère, p. 129.
[24] Gouvernement du Canada, « Le gouvernement du Canada annonce une exemption d’intérêts pour les producteurs agricoles », communiqué de presse, 23 juin 2022.
[25] Gouvernement du Canada, Programme de paiements anticipés : Étape 1. Ce qu’offre ce programme.
[26] Ibid.
[27] AGRI, Témoignages, Scott Ross (directeur exécutif, Fédération canadienne de l’agriculture) et David Tougas (coordonnateur, Économie et commerce, Union des producteurs agricoles).
[28] AGRI, Témoignages, Pierre St-Laurent (chef de l’exploitation, Empire Company Limited), Michael Graydon (chef de la direction, Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada).
[29] AGRI, Témoignages, Karl Littler (Conseil canadien du commerce de détail).
[30] AGRI, Témoignages, Rebecca Lee (directrice générale, Producteurs de fruits et légumes du Canada).
[31] AGRI, Témoignages, Olivier Bourbeau (vice-président, Fédéral et Québec, Restaurants Canada).
[32] AGRI, Témoignages, Olivier Bourbeau (Restaurants Canada).
[33] AGRI, Témoignages, Ian Boxall (Agricultural Producers Association of Saskatchewan) et Franco Terrazzano (directeur fédéral, Fédération canadienne des contribuables).
[34] AGRI, Témoignages,Galen G. Weston (Loblaw)
[35] AGRI, Témoignages, Jodat Hussain (Loblaw).
[36] AGRI, Témoignages, François Thibault (Metro).
[37] AGRI, Témoignages, Jodat Hussain (Loblaw).
[38] Les Compagnies Loblaw limitée, Rapport du premier trimestre de 2022, p. 10.
[39] Les Compagnies Loblaw limitée, Rapport du troisième trimestre de 2021, p. 12.
[40] Samantha Taylor et Sylvain Charlebois, Les profits en distribution alimentaire : Un seuil d’acceptabilité moral?, 2022.
[41] AGRI, Témoignages, David Macdonald (économiste principal, Centre canadien de politiques alternatives) et D.T. Cochrane (Canadiens pour une fiscalité équitable).
[42] AGRI, Témoignages, Jim Stanford (économiste et directeur, Centre for Future Work), D.T. Cochrane (économiste et chercheur en matière de politiques, Canadiens pour une fiscalité équitable) et David Macdonald (Centre canadien de politiques alternatives).
[43] AGRI, Témoignages, Catherine Lefebvre (présidente, Association des producteurs maraîchers du Québec), Rebecca Lee (Producteurs de fruits et légumes du Canada), Sylvie Cloutier (Conseil de la transformation alimentaire du Québec) et Martin Caron (Union des producteurs agricoles).
[44] Statistique Canada, Résultats des prévisions du revenu agricole pour 2022 et 2023.
[45] Agriculture et Agroalimentaire Canada, Aperçu de l’industrie de la transformation des aliments et des boissons.
[46] AGRI, Témoignages, Karl Littler (Conseil canadien du commerce de détail).
[47] AGRI, Témoignages, James Donaldson (BC Food and Beverage, Aliments et boissons Canada).
[48] AGRI, Témoignages, Sylvain Charlebois (professeur et directeur du Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires, Université Dalhousie), Patrice Léger Bourgoin (directeur général, Association des producteurs maraîchers du Québec) et Denise Allen (Fabricants de produits alimentaires du Canada).
[49] AGRI, Témoignages, James Donaldson (Aliments et boissons Canada).
[50] AGRI, Témoignages, James Donaldson (Aliments et boissons Canada) et Denise Allen (Fabricants de produits alimentaires du Canada).
[51] AGRI, Témoignages, James Donaldson (Aliments et boissons Canada) et Patrice Léger Bourgoin (Association des producteurs maraîchers du Québec).
[52] AGRI, Témoignages, Scott Ross (Fédération canadienne de l’agriculture).
[53] AGRI, Témoignages, Tyler McCann (Institut canadien des politiques agroalimentaires), Martin Caron (Union des producteurs agricoles) et Mary Robinson (Fédération canadienne de l’agriculture).
[54] AGRI, Témoignages, Pierre St-Laurent (Empire), François Thibault (Metro) et Paul Cope (vice‑président principal, Opérations de vente au détail, Save-On-Foods LP).
[55] AGRI, Témoignages, Sylvain Charlebois (Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires, Université Dalhousie).
[56] Voir « Annexe A : Frais imposés par les détaillants en épicerie dans l’industrie de la transformation des aliments et des boissons », dans Gouvernement du Canada, Constats du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial (FPT) sur les frais imposés par les détaillants, juillet 2021.
[57] AGRI, Témoignages, Jodat Hussain (Loblaw), Galen G. Weston (Loblaw), Eric La Flèche (Metro) et Gonzalo Gebara (président et chef de la direction, La Compagnie Wal‑Mart du Canada [Wal‑Mart Canada]).
[58] AGRI, Témoignages, Scott Ross (Fédération canadienne de l’agriculture), Mathieu Frigon (président et chef de la direction, Association des transformateurs laitiers du Canada) et Denise Allen (Fabricants de produits alimentaires du Canada).
[59] AGRI, Témoignages, Pierre Riel (vice-président exécutif et chef des opérations, Costco Wholesale International et Canada, Costco Wholesale Canada Ltd. [Costco Canada]).
[60] AGRI, Possibilités de croissance : Renforcer la capacité de transformation alimentaire au Canada pour assurer la sécurité alimentaire et les exportations, quatrième rapport, avril 2021, p. 46.
[61] Agriculture et Agroalimentaire Canada, Les ministres de l’Agriculture du Canada se penchent sur d’importantes mesures de soutien pour les producteurs et les transformateurs à leur conférence annuelle, communiqué de presse, 27 novembre 2020.
[62] Comité directeur sur le code de conduite des épiceries, Rapport d’étape du Code de conduite de l’industrie alimentaire/Juillet 2022, p. 4.
[63] AGRI, Témoignages, Gonzalo Gebara (Wal‑Mart Canada) et Pierre Riel (Costco Canada).
[64] AGRI, Témoignages, Denise Allen (Fabricants de produits alimentaires du Canada).
[65] AGRI, Témoignages, Michael Graydon (Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada), Pierre St-Laurent (Empire), Scott Ross (Fédération canadienne de l’agriculture), Martin Caron (Union des producteurs agricoles) et Mathieu Frigon (Association des transformateurs laitiers du Canada).
[66] AGRI, Témoignages, Sylvain Charlebois (Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires, Université Dalhousie), Michael Graydon (Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada), et Ken Whitehurst (directeur général, Conseil des consommateurs du Canada).
[67] The Canadian Press, « Canada’s top grocers post above-average profits with little transparency, report says », CBC News, 3 novembre 2022 [disponible en anglais seulement].
[68] David Milstead, « Grocery execs get big bonuses after boost from pandemic sales », The Globe and Mail, 3 January 2022 [disponible en anglais seulement].
[69] Agriculture et Agroalimentaire Canada, Vue d’ensemble du système agricole et agroalimentaire Canada, 2003, p. 34.
[70] Voir la note de bas de page 7 dans Gouvernement du Canada, Constats du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial (FPT) sur les frais imposés par les détaillants, juillet 2021.
[71] Bureau de la concurrence, Notre mandat.
[72] Voir Competition Bureau Statement regarding the Proposed Acquisition by Sobeys of Substantially all of the Assets of Canada Safeway (2013) (sur le site archive.org) [disponible en anglais seulement], Tribunal de la concurrence, Loblaw Companies Limited – Consentement enregistré (traduction) (2014) et Acquisition de Groupe Jean Coutu (PJC) par METRO inc. (2018).
[73] Bureau de la concurrence, Allégations de comportement anticoncurrentiel visant Les Compagnies Loblaws Limitée, 2017.
[74] AGRI, Témoignages, Sylvain Charlebois (Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires, Université Dalhousie) et Patrice Léger Bourgoin (Association des producteurs maraîchers du Québec).
[75] AGRI, Témoignages, Sylvain Charlebois (Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires, Université Dalhousie).
[76] AGRI, Témoignages, Eric La Flèche (Metro), Michael Medline (Empire), Galen G. Weston (Loblaw), Gonzalo Gebara (Wal‑Mart Canada) et Pierre Riel (Costco Canada).
[77] Bureau de la concurrence, L’avenir de la politique de la concurrence au Canada, 2022.