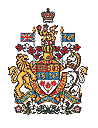:
Merci, monsieur le président.
Si ma mémoire est bonne, c'est l'ex-commissaire aux langues officielles, Mme Dyane Adam, parmi les premiers, qui a eu l'idée de...
Je vais lire un texte en langue anglaise parce que je sais que, si j'improvise, je vais dépasser les 10 minutes qui me sont allouées.
[Traduction]
Elle a eu l'idée d'attirer des immigrants francophones pour protéger les minorités francophones à l'extérieur du Québec. Si l'on examine les études sur lesquelles repose la politique de Mme Adam, on constate qu'elles soulèvent des doutes quant au bien-fondé de cette politique.
[Français]
Le texte que je suis en train de résumer pour vous est paru dans la revue INROADS en 2008. J'ai des copies si cela vous intéresse. Une version plus hâtive est parue dans la revue Francophonies d'Amérique, en 2008 également, en langue française. Je vais m'exécuter en anglais, mais, bien sûr, à la période de questions anything goes.
[Traduction]
L'une des études qui suscitent l'enthousiasme de Mme Adam a été préparée par Jack Jedwab, que nous entendrons un peu plus tard, je crois. Elle révèle que le pourcentage d'immigrants francophones qui adoptent l'anglais comme langue d'usage à la maison atteint 50 p. 100; donc, après seulement 10 ans dans une autre province que le Québec, les immigrants en provenance de l'étranger dont la langue maternelle est le français...
Jedwab a également révélé que la proportion des immigrants francophones qui résident au Québec demeure inférieure au poids des francophones québécois dans la population francophone totale du Canada. Or, si les immigrants francophones vivant à l'extérieur du Québec s'anglicisent rapidement et qu'en même temps, la population francophone du Québec ne reçoit pas sa juste part d'immigrants francophones qui s'établissent au Canada, il ne semble pas très approprié d'adopter une politique qui encourage encore plus de francophones à s'établir à l'extérieur du Québec.
Au cours de ma recherche, j'ai remarqué que Jedwab a utilisé les données du recensement de 1996. J'ai eu accès aux données de 2001 pour mon texte en français, et aux données de 2006 pour mon texte le plus récent en anglais. Tout d'abord, j'ai constaté que des 48 000 francophones qui ont immigré au Canada entre 2001 et 2006, 80 p. 100 ont été recensés au Québec en 2006, et 20 p. 100 dans le reste du Canada.
Étant donné que les francophones du Québec représentent actuellement 86 p. 100 de la population francophone totale du Canada, si l'on regarde la proportion de francophones qui ont récemment immigré au Canada et qui se sont établis au Québec, il est vrai que le Québec semble perdant. Autrement dit, le reste du Canada fait déjà mieux que le Québec sur le plan de l'immigration francophone. Cela corrobore ce que Jedwab a observé en s'appuyant sur les données de 1996.
J'ai aussi constaté que dans une province donnée à l'extérieur du Québec, le pouvoir d'assimilation de l'anglais est approximativement le même pour les francophones de l'étranger que pour ceux qui sont nés au Canada. Excepté au Nouveau-Brunswick, les taux d'anglicisation des immigrants francophones sont, en général, supérieurs à 50 p. 100. Cela signifie que dès la première génération, les francophones issus de l'immigration viennent grossir davantage les rangs de la population anglophone du reste du Canada que de la population francophone. Cela confirme l'autre conclusion de Jedwab.
J'ai examiné ce deuxième point plus en détail en me penchant sur la situation qui existe dans plusieurs grandes régions métropolitaines de recensement. J'ai découvert qu'à l'âge de 45 ans, les francophones issus de l'immigration adoptent davantage la langue anglaise que la langue française dans toutes les régions métropolitaines de recensement à l'extérieur de la « bilingual belt », c'est-à-dire la zone de bilinguisme entourant le Québec. Cette zone s'étend essentiellement de Moncton à Sault Ste. Marie et comprend la partie acadienne du Nouveau-Brunswick ainsi que l'est et le nord de l'Ontario. C'est un concept dont nous avons pris connaissance à l'époque de la commission Laurendeau-Dunton. Il s'agit des régions voisines du Québec, dans lesquelles il y a un pourcentage élevé de francophones.
Dans toutes les RMR situées à l'extérieur de la zone de bilinguisme, je le répète, à l'âge de 45 ans, plus de la moitié des francophones adoptent l'anglais. À cet égard, les trois RMR qui font exception à cette règle sont situées à l'intérieur de la zone de bilinguisme; il s'agit de Moncton, Ottawa et Sudbury, qui sont les seuls grands centres urbains à l'extérieur du Québec où les nouveaux arrivants francophones s'établissent à long terme.
Si l'apport de l'immigration aux populations francophones à l'extérieur du Québec doit être optimisé, la zone de bilinguisme constitue de toute évidence la destination à favoriser.
Comme les allophones, les francophones qui immigrent à l'extérieur de la zone sont évidemment plus enclins à améliorer leur sort en s'anglicisant qu'à consolider la situation démographique vulnérable des minorités francophones anémiques.
Peu après le recensement de 2006, Statistique Canada a effectué un sondage sur la vitalité linguistique de la communauté francophone à l'extérieur du Québec. On a constaté qu'une identité francophone distincte demeure bien ancrée uniquement dans les régions du reste du Canada qui font partie de la zone de bilinguisme. Leurs populations francophones sont les seules à offrir des ressources suffisamment solides auxquelles l'immigration francophone peut se greffer de façon durable.
En fait, la situation était claire dès le départ. À l'époque de la commission Laurendeau-Dunton, lorsque la réalité de la zone de bilinguisme a été reconnue pour la première fois, il est simplement devenu clair, avec le temps et les informations accumulées à l'extérieur du Québec, que ce n'est qu'à l'intérieur de cette zone — dans les régions du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario — que le niveau de maintien du français comme principale langue d'usage à la maison demeure raisonnablement élevé, que les francophones conservent une identité suffisamment distincte, et que parler français au travail présente encore suffisamment d'avantages.
L'impératif d'unité nationale a certainement obscurci la perception de cette réalité. Le fait de chercher à sauver la face devant l'opinion publique au Québec a mené notamment au concept étourdissant de l'assimilation durable. Il s'agit du concept élaboré à Patrimoine canadien. Il semble que même un taux d'assimilation de 90 p. 100 puisse être maintenu si un flot suffisamment important de francophones ou d'immigrants francophones alimente de façon continue le melting-pot linguistique. Ce qu'il y a de problématique dans cette situation, c'est que cela n'améliore en rien la viabilité à long terme du français dans l'ensemble du Canada. L'apport de l'immigration aux populations francophones à l'extérieur de la zone de bilinguisme est éphémère.
Les besoins du Québec ne devraient pas non plus être ignorés. Comme nous l'avons vu, le Québec ne reçoit pas sa juste part d'immigrants francophones, et les francophones du Québec viennent d'être ébranlés par une baisse marquée de leur proportion au sein de la population montréalaise et de toute la province de Québec. En fait, l'immigration anglophone au Québec a fait en sorte que la proportion d'anglophones dans la population du Québec est demeurée stable entre 2001 et 2006. Malgré les efforts constants du Québec pour attirer davantage d'immigrants francophones, l'apport récent de l'immigration internationale à la minorité anglophone de la province représentait, toutes proportions gardées, plus du double de son apport à la majorité francophone.
De plus, la francisation des immigrants anglophones au Québec est inexistante, de sorte qu'ils viennent automatiquement intégrer la population anglophone de la province. En fait, le taux de croissance de la population anglophone du Québec entre 2001 et 2006 était supérieur à Montréal et dans toute la province à celui de la population francophone. Cette nouvelle situation est une première dans l'histoire du recensement au Canada; nous n'avons jamais vu cela auparavant. Le poids relatif de la population de langue maternelle anglaise — ce sont les statistiques pour lesquelles nous avons les plus anciennes données historiques — n'a cessé de diminuer depuis la Confédération. Étant donné cette nouvelle situation, on peut penser que l'on pourrait en faire davantage afin de favoriser l'unité canadienne et de dissiper les craintes des francophones de devenir minoritaires dans la seule province où ils sont majoritaires. Davantage pourrait être fait pour favoriser l'unité canadienne en encourageant l'immigration francophone au Québec plutôt que dans les régions principalement anglophones à l'extérieur de la zone de bilinguisme.
L'objectif primordial de toute politique sur l'immigration francophone devrait être d'assurer la viabilité de la population francophone dans l'ensemble du Canada. Puisque les immigrants francophones sont assez peu nombreux, ils devraient être dirigés vers les populations francophones qui ont la plus grande vitalité linguistique, c'est-à-dire vers le Québec et les régions qui font partie de la zone de bilinguisme au Nouveau-Brunswick et en Ontario.
L'utilisation superficielle de l'immigration francophone pour maintenir l'illusion de minorités francophones viables, d'un océan à l'autre, revient à gaspiller une ressource précieuse. Il est grand temps que la politique linguistique canadienne soit confrontée à la réalité.
:
Vous m'entendez mieux, maintenant? Parfait.
J'ai eu l'occasion aussi, à l'invitation de Dyane Adam, qui était commissaire aux langues officielles à l'époque, d'écrire cette étude sur l'immigration et la vitalité des minorités linguistiques, à laquelle M. Castonguay a fait référence. J'aimerais mentionner que, dans le cadre de cette étude qu'on m'a demandé de faire, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer de nombreux leaders des communautés francophones hors Québec, ainsi que le leadership des communautés anglophones du Québec.
Il faut aussi reconnaître qu'à l'époque, il y avait une démarche asymétrique, parmi les preneurs de décisions à Citoyenneté et Immigration Canada vis-à-vis de la situation au Québec et à l'extérieur du Québec. Je vous explique ce que j'entends par « asymétrique ». Dans le cas du Québec, on m'a dit assez clairement durant les discussions qu'il y avait un accord McDougall-Gagnon-Tremblay, un accord sur les ressources pour l'intégration des immigrants, et une autre entente signée en 1978 touchant au processus de sélection de l'immigration, qui a été transféré au Québec, sauf dans le cas des immigrants humanitaires, c'est-à-dire des réfugiés.
Alors, on m'a demandé de rester fidèle et respectueux face à cet accord. C'est un conseil que j'aimerais réaffirmer aujourd'hui, qui m'a semblé très sage, de respecter la compétence du Québec en ce qui touche à l'immigration, tout en tenant compte du fait qu'à l'extérieur de Montréal, il y avait des communautés dans des situations démographiques moins intéressantes, fragiles ou vulnérables, dans certains cas. Il fallait aussi évaluer la manière de coopérer avec le gouvernement du Québec pour voir si des ressources pouvaient être accordées aux personnes de langue anglaise issues de l'immigration qui désiraient se déplacer dans les régions à l'extérieur de Montréal.
Alors, le mandat qu'on m'a proposé d'étudier la situation au Québec de cette manière était un peu limité.
[Traduction]
Je voulais simplement faire une récapitulation de l'approche du Québec à l'égard de cette question. Comme je l'ai dit auparavant, en ce qui concerne la situation des anglophones qui vivent au Québec, il est très important de respecter les deux ententes qui ont été conclues avec cette province sur le plan de la sélection des immigrants et les ressources affectées aux immigrants qui choisissent de s'établir au Québec et dont la langue maternelle est l'anglais.
Cela dit, je crois qu'il y a des possibilités ou d'autres moyens de respecter l'engagement du gouvernement fédéral quant à la vitalité des minorités linguistiques, engagement qui inclut évidemment le Québec, pour la vitalité de la communauté anglophone. Certains d'entre vous savent peut-être que la définition que donne le gouvernement fédéral d'un anglophone au Québec est fondée sur une variable du recensement dérivée, soit la première langue officielle parlée. Selon cette variable, ou cet indicateur, si vous préférez, le nombre d'anglophones au Québec se situe entre 900 000 et 1 million de personnes.
L'indicateur qu'utilise le gouvernement du Québec est la langue maternelle. En fonction de ce facteur, on parle d'une population d'environ 600 000 anglophones. Il y a donc un écart important entre la définition du gouvernement fédéral et celle du Québec; si vous faites le calcul, c'est un écart d'environ 300 000. Et parmi ces 300 000 personnes, il y en a un grand nombre qui ne sont pas nées au Canada.
Donc, en fonction de la définition du gouvernement fédéral, la communauté anglophone semble montrer beaucoup plus de signes de vitalité, si l'on se fie aux chiffres, que selon la définition du Québec, qui tiendra beaucoup moins compte des immigrants dans l'évaluation de la population anglophone.
Sachez qu'à mon avis, vu le temps limité dont je dispose et dans la mesure où je traite de cette question, il y a des zones de vulnérabilité au sein du groupe de personnes que le gouvernement fédéral désigne comme des anglophones et que le gouvernement provincial peut ne pas désigner comme des anglophones.
Il y a beaucoup de statistiques qui montrent, par exemple, que les immigrants provenant de l'Asie du Sud, qui parlent principalement anglais — même si leur langue maternelle est le punjabi ou une autre langue —, se trouvent souvent dans des situations de vulnérabilité économique. C'est beaucoup plus fréquent. Puisque c'est le Québec qui s'occupe de l'intégration — sauf pour les cas humanitaires, comme je l'ai mentionné tout à l'heure — et qu'il a conclu un accord sur la main-d'oeuvre avec le gouvernement fédéral, dans la mesure où il y a des possibilités de soutenir ces groupes qui tentent de s'ajuster à la réalité du Québec, ce serait un rôle utile à jouer pour le gouvernement fédéral. Il devrait le faire en collaboration avec le gouvernement du Québec, puisque cela relève de sa compétence.
Je crois que c'est aussi vrai dans la mesure où à l'extérieur de Montréal, là où, je le répète, la situation de l'immigration est différente, le gouvernement fédéral peut soutenir ces communautés, comme dans le passé, et se pencher sur le type de soutien qu'il fournit afin que les gens qui choisissent de se joindre à la communauté anglophone des Cantons de l'Est ou de la ville de Québec puissent avoir accès à ces ressources et que cela leur permette de vivre dans cette communauté.
Pendant ce temps, je crois qu'il revient à la communauté anglophone du Québec de reconnaître la nécessité de faire l'apprentissage du français,
[Français]
le besoin pour tous nos immigrants d'apprendre la langue française.
Il me semble important aussi, pour le gouvernement du Québec, d'associer la communauté anglophone au message, au discours, livré aux immigrants au sujet de la nécessité de faire l'apprentissage du français. Je pense que les anglophones du Québec, notamment notre jeune génération, est très intéressée par l'apprentissage du français. Je désire que mes enfants et les enfants de mes collègues apprennent le français et qu'ils le parlent mieux que moi, naturellement.
Il faut inclure les anglophones du Québec dans le processus de promotion du français au Québec et de la diversité, notamment au sein de la communauté montréalaise, et s'assurer que la contradiction entre les deux n'émerge pas. On voit trop souvent cette idée qu'il y a une contradiction entre faire partie d'une communauté quelconque d'origine ethnique et le désir d'apprendre le français ou l'anglais. On voit ce genre de débat au Québec ainsi qu'à l'extérieur du Québec. Je pense que, si on associe tous les groupes au processus et s'ils ont l'impression de faire partie du processus, cela va mieux servir les immigrants, le gouvernement du Québec et les objectifs du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la vitalité. Alors, c'est mon short speech sur le Québec.
Pour ce qui est du reste du Canada... M. Castonguay m'a cité et il est d'accord avec moi, ce qui est très rare, alors je ne sais pas quoi dire. Même s'il convient des chiffres que j'ai publiés à l'époque, les conclusions qu'on en tire sont différentes.
Je suis d'avis qu'il faut travailler plus fort pour créer les conditions nécessaires à l'extérieur du Québec pour soutenir les communautés francophones qui, à l'époque où j'ai fait l'étude, ont exprimé le désir d'accueillir des immigrants. Même s'il y a effectivement des problèmes, comme M Castonguay l'a bien constaté, sur le plan de la préservation de la langue française auprès de ces immigrants, il y a des problèmes qui, on sait, existent plus largement, au sein de ces mêmes communautés, en matière d'anglicisation. Il faut travailler plus fort pour soutenir ces communautés et leurs efforts, au lieu de les condamner à ne pas être capables de progresser ou de maintenir leur situation.
Je pense qu'on a fait une erreur historique au cours des années 1960, dans le cas de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. On s'est ouverts un peu à la diversité, au sein de la dualité, mais on n'a pas vraiment évalué quelle direction auraient pris ces immigrants qui allaient s'installer à l'extérieur du Québec sans que les ressources nécessaires pour soutenir les communautés francophones soient en place. Si on avait étudié cette question d'un peu plus près, on aurait peut-être découvert la possibilité d'attirer plus de francophones à l'extérieur du Québec et de fournir les ressources à ces communautés. On a fait des erreurs historiques.
Je ne veux pas qu'on aille dans le même sens qu'à cette époque. J'espère qu'on pourra mettre plus de ressources à la disposition de ces communautés, afin qu'elles soient capables d'accueillir, en français, les immigrants. Je sais qu'il y a des groupes communautaires au pays qui ont ce désir de le faire. Je sais, compte tenu de l'expérience de la société civile, des ONG et de l'expérience communautaire que je possède, qu'on ne peut pas mesurer, par les chiffres strictement, l'expérience de l'accueil pour la communauté d'accueil. Il faut tenir compte de cela.
Malgré les politiques adoptées pour faire la promotion d'un accroissement de l'immigration à l'extérieur du Québec... Ce matin, à bord du train, j'ai étudié les chiffres de Citoyenneté et Immigration Canada sur le nombre de francophones, défini, dans ce cas, par ceux qui parlent français à leur arrivée et ceux qui parlent anglais et français à leur arrivée. Je ne pense pas qu'on a vu des augmentations extrêmement importantes. On a vu des augmentations des chiffres réels, mais ceux-ci font partie d'une augmentation des chiffres réels globaux sur l'immigration depuis quelques années. Toutefois, en matière de pourcentage, ce n'est pas vraiment important.
Permettez-moi de terminer en vous parlant d'un autre aspect. J'ai parcouru les chiffres du recensement américain, l'« American Community Survey », hier soir. Je n'avais rien à faire. C'était durant le deuxième entracte du match de hockey. Je voulais me distraire un peu parce que j'étais un peu nerveux, comme vous l'avez constaté.
On constate que 154 000 immigrants nés en France sont aux États-Unis. Entre les années 2000 et 2008, il y a eu 42 000 immigrants de la France qui se sont installés aux États-Unis.
Comme vous le savez, aux États-Unis, il n'y a pas de programme de soutien pour les minorités linguistiques francophones. C'est sans parler des Haïtiens: 522 000 immigrants née en Haïti sont présentement aux États-Unis. Un pourcentage important d'entre eux sont arrivés aux États-Unis entre 2000 et 2008, soit avant la catastrophe regrettable qu'on a vue en Haïti, il y a moins d'un an.
Les chiffres qu'on a tirés sont vraiment infimes. Ça a quand même un bon impact sur les communautés à l'extérieur du Québec. Sur leur vision de l'avenir aussi, ça donne un peu d'espoir. Je comprends M. Castonguay de dire que ce sont de faux espoirs, mais je ne veux pas les condamner. C'est un peu ça que...
:
Tout d'abord, je vous remercie grandement de l'invitation. C'est la première fois que je me présente devant un comité. Je suis désolée, mais je ne savais pas que je devais faire une allocution. Je pensais qu'il s'agissait d'une table ronde, et qu'on y posait des questions et qu'on discutait. Je ne pense pas que cela me causera des problèmes. Je peux facilement utiliser les 10 minutes qui me sont allouées, j'ai toujours quelque chose à dire.
Je travaille au Centre d’études ethniques à l’Université de Montréal. Il s'agit d'un centre qui s'intéresse à l'immigration et à l'intégration des nouveaux arrivants à Montréal et au Québec dans plusieurs domaines, dont le milieu de travail et l'école. Je ne représente ni la francophonie ni l'« anglophonie ». Mon expérience de vie m'a amenée un peu partout au Canada. J'ai vécu dans des milieux anglophones et dans des milieux francophones. Dans quel groupe me situais-je? Ce n'était pas clair. Étais-je dans un groupe minoritaire ou majoritaire? Je suis née dans la ville de Québec, d'un père francophone et d'une mère immigrante anglophone. J'ai fréquenté l'école française, mais à la maison, on parlait anglais. Lorsque, à des fins statistiques, on me demandait ma langue maternelle, je répondais que c'était l'anglais. Si on me demande quelle est ma langue de socialisation et de scolarisation, je réponds que c'est le français. Si on me demande quelle est ma langue de travail, je réponds que ce sont l'anglais et le français. Si on me demande quelle est ma langue du coeur, je réponds les deux. Je considère que je suis une « franglophone ». Par contre, lorsque l'on traite des données statistiques, je n'existe pas. C'est au nom des gens qui sont dans la même situation que moi que j'aimerais prendre la parole aujourd'hui. Nous sommes plusieurs. Les pratiques langagières que l'on vit au quotidien ne sont pas prises en compte, peut-être parce qu'elles sont trop complexes pour des données statistiques qui ont besoin de mesurer une réalité linguistique en regroupant les individus. En regroupant les individus, que fait-on? On écrase, on perd la réalité d'un grand nombre de Canadiens, de Québécois et d'immigrants.
Aujourd'hui, j'aimerais remettre en question certaines idées. Selon moi, on est à la fin d'une période d'accommodements entre deux communautés linguistiques bien définies. Je sens cela depuis une bonne dizaine d'années, depuis que j'ai commencé un programme de recherche à l'Université de Montréal. On est à la fin d'une période au cours de laquelle on a trouvé des solutions, des accommodements politiques, les années 1960 et 1970. Cette façon de voir implique une dualité, celle de deux communautés. La diversité linguistique est à part, extérieure, ce sont les autres, les allophones. Éventuellement, ils vont s'intégrer à quelque chose qui est encore perçu de façon très fermée, la francophonie et l'« anglophonie ».
En réalité, ces communautés sont en train de se transformer de l'intérieur. Prenons l'exemple de la communauté anglophone du Québec. Elle est très multiculturelle, très multilingue, très bilingue. C'est la même chose pour les écoles situées dans le secteur anglophone du Québec. Ce sont des écoles où il y a beaucoup d'ayants droit francophones et beaucoup d'ayants droit bilingues, trilingues, ou qui sont unilingues en immersion française, afin de devenir bilingues pour pouvoir survivre, être à l'aise, mobiles et participer à la vie québécoise.
En ce qui a trait aux immigrants au Québec, on constate une montée marquée des compétences en français. Les chiffres peuvent parler. En ce qui a trait au statut de la langue française, regardons son usage quotidien en milieu de travail et les pratiques à long terme à la maison. On voit que la langue française prend sa place. Toutefois, elle prend sa place dans un contexte où il y a d'autres langues, y compris un intérêt pour l'anglais de la part des francophones et des immigrants. Il s'agit donc d'un contexte de dualité.
J'ai vécu à l'extérieur du Québec pendant 10 ans, soit en Acadie de la Nouvelle-Écosse.
J'ai vu les commissions scolaires francophones émerger en Colombie-Britannique. On ne dessert pas une francophonie hors Québec qui vit de façon unilingue; on dessert une francophonie qui veut maintenir son français, son identité francophone, tout en utilisant l'anglais et possiblement d'autres langues. On voit les petites écoles francophones en Colombie-Britannique, en Ontario, en Alberta accueillir des immigrants qui sont bienvenus, car ils aident à maintenir quelque chose. Ces petites écoles ont besoin d'une clientèle scolaire. Les communautés hors Québec sont très heureuses d'accueillir des immigrants, mais à quoi cela oblige-t-il? Cela oblige à redéfinir la francophonie canadienne, la francophonie québécoise et le fait d'être francophone.
Allons-nous dire d'un francophone que c'est quelqu'un ayant un lien identitaire très fort, ou allons-nous dire d'un francophone que c'est quelqu'un qui a des compétences en français? Pour pouvoir saisir ce type de réalité sociale qui change rapidement... On sait tous que le XXe siècle a été une période de transformation rapide; en ce XXIe siècle, c'est encore plus rapide. Le Canada a conçu les notions de dualité linguistique et de multiculturalisme dans les années 1960-1970. Il faut penser et clarifier de nouveau ce que nous sommes maintenant et où nous nous dirigeons dans l'avenir. Cela signifie qu'il faut changer nos indicateurs. Je parle évidemment aux linguistes. Ces derniers ont mesuré une réalité dans les années 1960-1970 selon un modèle d'assimilation linguistique. On a regardé la langue utilisée à la maison.
Par ailleurs, si on va un peu plus près des gens qui parlent des langues à la maison et qu'on leur demande non pas quelle est la langue dominante à la maison, mais quelles sont les langues parlées à la maison, on se rend compte qu'il y a une tout autre réalité. Il y a des gens qui parlent plusieurs langues à la maison et qui veulent les conserver parce qu'ils considèrent ces compétences linguistiques comme des ressources pour l'avenir de leurs enfants.
À nous maintenant ici, au gouvernement, de voir ces ressources, ces compétences, comme des gages d'avenir qui vont nous mener loin. Il faut arrêter de penser à une dominance linguistique dans des domaines. On a besoin d'indicateurs — des analyses de données et de recensements — plus sophistiqués et nuancés. On a aussi besoin de tenir compte de l'ethnographie. Vous avez des bons ethnographes ici, au Canada. Si vous voulez connaître les réalités scolaires des petites écoles francophones hors Québec, consultez les ethnographes. Il y en a. Ils sont ici à Ottawa, cette semaine, pour un colloque qui se tient à l'Université d'Ottawa. Vous pourrez les y entendre cet après-midi.
Vous avez besoin d'une étude qui puisse saisir la complexité des liens identitaires aux langues et des pratiques identitaires et linguistiques. Merci.
:
C'est magnifique, ce qu'on vient d'entendre! J'inclus tout le monde.
Je vais peut-être vous surprendre, monsieur Castonguay. On ne doit pas être indifférents aux cris d'alarme que vous avez lancés depuis belle lurette, à mon avis. Je vous rejoins à cet égard.
Je suis vraiment déçu d'avoir seulement cinq minutes pour mes questions, monsieur le président.
D'abord, monsieur Castonguay, je trouve que c'est une approche très mathématique. Ça va de soi, vous êtes professeur de mathématiques. C'est une approche très statistique et — permettez-moi un commentaire peut-être désobligeant — très froide.
Ces statistiques, qu'elles soient de 1996 ou de 2001, peuvent être le reflet fidèle d'une nouvelle réalité, si je peux reprendre l'expression de Mme Lamarre. Cela n'inclurait pas l'impact, si petit soit-il, du phénomène de l'avènement de conseils scolaires francophones partout, hors même de cette fameuse bilingual belt, dont vous parliez. Je fais référence aux irréductibles de Zenon Park, aux irréductibles de Saint-Boniface, aux irréductibles qui se sont greffés autour du Campus Saint-Jean à Edmonton, et à ceux qui sont en Colombie-Britannique ainsi qu'à Whitehorse, au Yukon. Ces derniers, à Whitehorse, au Yukon, ont maintenant des écoles, un service de garderie qui n'existait pas au moment où on relevait les statistiques de 1996 — ou du moins l'impact de ces écoles.
Prenez-vous cela en considération, monsieur Castonguay? C'est ma première question.
:
Oui, très certainement. Je ne suis ni un prophète de malheur ni un bonhomme sept-heures. J'ai été le premier et presque le seul analyste à souligner qu'au Nouveau-Brunswick, le fait d'avoir un régime scolaire francophone en parallèle avec la garderie, jusqu'à l'université, donnait des résultats. À l'extérieur du Québec, c'est la seule province où les francophones ont réussi à réduire le taux d'anglicisation chez les jeunes adultes. Il était de 12 p. 100 en 1971 et de 9 p. 100 en 2006. Les statistiques contiennent aussi de bonnes nouvelles, et j'essaie de les diffuser.
Vous avez parlé de la gestion des conseils scolaires autonomes en Ontario. Or celle-ci a été obtenue longtemps après les réalisations de M. Robichaud, au Nouveau-Brunswick. Il s'agit tout de même, dès 1969, d'une loi portant sur les langues officielles. Ce n'est pas mauvais. C'est un appui aux communautés; ça leur donne plus d'autonomie et ça influence certainement l'évolution de la situation.
Néanmoins, il y a une région où l'on souhaiterait voir les choses évoluer davantage, et c'est celle d'Ottawa, qui compte l'Est de l'Ontario. Je parle ici essentiellement de la région métropolitaine d'Ottawa, qui inclut plus du tiers des francophones de l'Ontario. C'est très concentré. C'est en quelque sorte une petite Acadie, quelques centaines de milliers de francophones. On peut dire, en arrondissant les chiffres, que c'est comparable à toute la population francophone du Nouveau-Brunswick. Or on ne note aucune évolution favorable, à Ottawa, qui n'est pas une ville officiellement bilingue. On n'a pas déclaré de district bilingue à l'extérieur du Québec, comme l'avait recommandé la Commission Laurendeau-Dunton.
[Traduction]
C'était la pierre angulaire de la politique qu'elle défendait dans les années 1960, et elle a été adoptée dans la première Loi sur les langues officielles, en 1969.
[Français]
Ça n'a jamais été mis en vigueur. Ça a été mis de côté vers 1977 par le gouvernement Trudeau, probablement parce que ça aurait provoqué un ressac. À Windsor, notamment, ce ressac s'est produit lorsqu'il a été question de déclarer un district bilingue. À l'époque, le taux d'anglicisation y était d'environ 65 p. 100. Il est maintenant supérieur à 70 p. 100. Depuis l'adoption de la Loi sur les langues officielles, le taux d'anglicisation des jeunes adultes à Ottawa a doublé et continue d'augmenter. Que voulez-vous? Si les nouvelles sont mauvaises, il ne faut quand même pas assassiner le messager.
:
Merci, monsieur le président.
Bonjour à vous tous.
Mon coeur bat la chamade lorsqu'on arrive à ce sujet. Je parle de la question de la réalité, du quotidien, de ce qui se passe sur le terrain, dans la vraie vie, en ce qui a trait au fait français dans l'ensemble du territoire nord-américain, et en particulier au Canada et au Québec, et ce, pour des raisons fondamentales. Comme Mauril, je viens de l'Ontario, mais de l'Ontario qui est collé sur le Québec. Je viens de Hawkesbury et je suis député de Gatineau. On est toujours dans la vallée de la rivière des Outaouais. Je remercie le ciel du fait qu'on ait été collé sur le Québec. Je parle de l'Est de l'Ontario. C'était différent ailleurs en Ontario. J'ai des cousins et des cousines qui ne s'appellent plus Lalonde, mais Lalonde, et d'autres s'appellent Nadal, et non plus Nadeau, parce qu'à une époque, leurs parents sont déménagés, et à l'époque, les francophones n'avaient pas droit à la gestion scolaire.
J'ai vécu en Saskatchewan et j'ai travaillé pour l'obtention de la gestion scolaire. Vous savez qu'en Saskatchewan, les conservateurs avaient aboli les écoles françaises en 1931. Les néo-démocrates n'ont permis qu'on les récupère qu'en 1995, 64 ans plus tard. Je suis arrivé à la fin de cette longue période, au début des années 1990. Je me souviendrai toujours quand je suis allé à Willow Bunch. Il s'agit d'un petit village fransaskois qui s'appelait jadis Hart-Rouge, pour ensuite devenir Talle-de-Saules, et avec le temps, Willow Bunch. La plupart des gens y habitant sont des Duperreault, nom qui ne se prononce plus comme ça, des Granger, nom qui ne se prononce plus comme ça, des Boisvert, nom qui ne se prononce plus comme ça. Quand nous sommes allés dans le village, il fallait 10 signatures de parents pour avoir droit à une école française là-bas. On n'a pas pu récoler ces 10 signatures même en y restant une semaine. Certains grand-parents voulaient, mais pas des parents.
On demande maintenant à des immigrants qui arrivent au Canada de faire le travail dans des communautés où il y a eu assimilation, pas parce que les francophones le voulaient, mais parce que la pression sociale de la réalité canadienne l'a voulu. Pensons-y, 64 ans sans droits pour les francophones en Saskatchewan, ça démolit des communautés qui sont déjà minoritaires. En 1931, il y avait 63 écoles francophones, mais on n'a pu qu'en réouvrir huit. Ce n'est pas parce que les gens ont disparu, mais parce que les communautés ont été assimilées. Il n'y a que 6 000 personnes ayant le français pour langue d'usage en Saskatchewan. Je parle de langue d'usage à la maison, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas anglais non plus.
Compte tenu de cette réalité, ne demande-t-on pas à l'immigration de... Le Québec ne représente que 2 p. 100 de la population de l'Amérique du Nord. Il y a une masse critique. L'assimilation est très possible, on le voit dans le Pontiac et à Montréal, où se trouve 47 p. 100 de la population du Québec. Pour parler bien franchement, quand je vais à Montréal, je ne suis pas certain d'être dans une ville francophone.
Pourquoi ne met-on pas nos énergies à la bonne place, plutôt que de demander aux immigrants francophones de maintenir le fait français là où les communautés ont toutes les misères du monde à le faire elles-mêmes? J'aimerais vous entendre sur cette question, monsieur Castonguay, madame Lamarre et monsieur Jedwab.
:
Merci beaucoup, monsieur le président. Yvon Godin, député d', est habituellement notre représentant à ce comité, mais je le remplace.
Monsieur Castonguay, je voudrais simplement dire une chose. Je ne conviens pas de la quasi-totalité de ce que vous venez de dire, sauf en ce qui a trait à ce que vous avez mentionné au sujet d'Ottawa en tant que capitale nationale. Il m'apparaît épouvantable que la Ville d'Ottawa ne respecte pas le gouvernement fédéral et ne respecte pas les contribuables francophones qui ont réussi à construire cette ville. Il n'est pas acceptable que la Ville d'Ottawa ne soit pas encore officiellement bilingue. Je suis tout à fait d'accord avec vous à ce sujet.
Toutefois, en ce qui a trait à la question de la vitalité, les propos de Mme Lamarre représentent vraiment une bouffée d'air frais. En Colombie-Britannique, je vis une réalité qui ressemble beaucoup plus à ce qu'elle a décrit. Comme vous le savez, la Colombie-Britannique est l'une des seules provinces où le nombre de francophones augmente. Il y a un réseau scolaire qui est enfin en place. Lorsqu'on visite ces écoles, il y a vraiment un arc-en-ciel francophone. Il y a des accents d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des Caraïbes. C'est remarquable. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu au Québec, lorsque j'y étais. J'ai vécu au Québec pendant 14 ans, à Chicoutimi, à Sherbrooke, à Montréal. Je n'ai jamais vu, au Québec, une diversité francophone comme celle que je vois en Colombie-Britannique. Les écoles d'immersion sont pleines à craquer. Les parents font souvent la file pendant toute une fin de semaine afin d'inscrire leurs enfants dans une école d'immersion. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous ces gens sont des consommateurs de produits francophones, des produits culturels francophones comme des films, des magazines ou des livres. C'est ce qui, d'une grande manière, contribue à la vitalité du Québec. Lorsqu'il y a un réseau à l'extérieur du Québec, cela contribue à la vitalité des produits culturels québécois et acadiens. Il me semble important d'entretenir et d'augmenter la présence francophone à l'extérieur du Québec.
Monsieur Castonguay, vous avez mentionné que là où il y a des institutions postsecondaires francophones, à Sudbury, Moncton et Ottawa, le taux d'assimilation est plus bas. C'est un fait. Ces immigrants viennent élargir la francophonie, là où les institutions existent.
J'ai trois questions à vous poser. Je vais commencer par m'adresser à Mme Lamarre. Premièrement, en ce qui concerne les programmes de français langue seconde, que peut-on faire pour améliorer la qualité et la quantité de ces programmes? Souvent, le français est la deuxième langue des immigrants francophones.
Deuxièmement, de quelle façon peut-on améliorer l'accès aux institutions postsecondaires francophones? C'est évident qu'une institution postsecondaire francophone augmente la présence francophone.
Troisièmement, quels sont les autres programmes que l'on pourrait offrir afin de continuer à élargir cette présence francophone et cette consommation des produits culturels québécois et acadiens? C'est un élément important pour notre avenir.
:
Merci à vous trois. Je pense que vous pouvez percevoir, par la longueur des questions, que ce sujet soulève les passions. Ce sont peut-être les discours les plus intéressants que j'ai entendus depuis mon arrivée récente au comité.
Madame Lamarre, vous venez de dire que les chiffres ne reflètent pas la réalité des gens. En anglais, il y une expression qui dit:
[Traduction]
« On peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres ». Je ne veux pas vous manquer de respect, mais
[Français]
j'ai peur que les chiffres que vous avez mentionnés, professeur Castonguay, puissent nous mener à une fausse conclusion.
[Traduction]
Ce qui me pose problème, c'est que votre analyse nous mène à une réalité anglophone-francophone très sombre et polarisée, ce qui laisserait entendre que le français serait plus important si nous avions seulement un Québec et un « reste du Canada ».
Ce que j'entends, ce que je pense, en tant que père de trois enfants inscrits dans une école d'immersion française en Colombie-Britannique — les listes d'attente sont longues, et c'est difficile d'obtenir une place dans ces écoles — et ce que M. Julian disait également, c'est qu'en réalité, le français est beaucoup plus fort grâce à ce grand pays qu'est le Canada, où l'on fait la promotion de cette langue à l'extérieur de la province.
J'ai deux questions à vous poser concernant votre témoignage. Premièrement, vous nous avez dit, monsieur Castonguay, que l'on gaspille une ressource rare lorsque les immigrants francophones s'installent à l'extérieur de la zone de bilinguisme ou à l'extérieur du Québec. Je dirais que cette ressource rare ne fait pas que renforcer le français, mais qu'elle sensibilise également les gens qui parlent d'autres langues à l'importance et à la valeur du français à l'extérieur de cette zone.
Deuxièmement, vous avez dit que l'immigration anglophone au Québec représentait, toutes proportions gardées, le double de l'apport à la population francophone, et je ne comprends pas pourquoi ce serait le cas, étant donné que le Québec a un contrôle sans précédent sur sa propre immigration.
Je vais demander à Mme Lamarre puis à M. Castonguay de répondre à ces deux questions. Je suis désolé que nous ne puissions pas donner la parole à tout le monde, mais notre temps est limité.
:
D'abord, il faut que je vous parle des inquiétudes en ce qui concerne le français, la vitalité du français et le fait français au Canada,
[Français]
un fait français, une société francophone au Québec.
[Traduction]
Il y a des craintes réelles, et elles reposent sur l'histoire. Je crois que nous ne pouvons pas réprimer ces peurs. Des efforts doivent être déployés à l'intérieur et à l'extérieur du Québec pour la survie du fait français. Lorsque je dis que je suis en faveur du multilinguisme et que je le considère comme un nouveau phénomène très important sur le plan du capital humain pour l'avenir, je ne veux pas que l'on pense qu'à mon avis, le français ne devrait pas être protégé.
Pour que le français survive, à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec, il faut que le système éducatif soit sain. Il faut également que les gens soient intéressés à apprendre et à utiliser le français dans leur milieu de travail. J'ai grandi dans un bastion anglais de la ville de Québec. Dans les années 1960, il était possible de vivre à Québec sans apprendre le français. Mais ce temps est révolu. Je vis maintenant dans l'ouest de l'île de Montréal, et mes enfants fréquentent une école française.
Certains enfants y ont droit. Leurs parents choisissent de les envoyer à une école française afin qu'ils puissent vivre et travailler au Québec. C'est l'intérêt pour le français qui en fera une langue vivante, saine, et qui continuera de se développer dans l'avenir. Alors lorsque M. Julian m'a demandé ce que l'on peut faire avec d'autres types de programmes, je dirais que l'école est un endroit très important.
Il y a aussi le milieu de travail. Il faut qu'il y ait des emplois qui feront en sorte d'encourager les gens à continuer d'utiliser le français à l'âge adulte. Je crois que l'on en parle dans la francophonie hors Québec — je n'aime pas ce mot — ou la francophonie canadienne, ainsi que des efforts pour que les milieux de travail et les entreprises soient propices à l'utilisation du français. Même si votre site Web est en français, en anglais et en espagnol, vous pouvez vivre et travailler en français dans votre milieu.
Je crois que ce genre de programme contribuera à la survie du fait français. Il ne faudrait pas sous-estimer le pouvoir du milieu de travail et de l'économie.
:
Merci, monsieur le président.
Je vous remercie de comparaître devant nous ce matin. Je dois vous avouer que, du seul point de vue de la statistique à propos de la langue maternelle en matière d'immigration, la seule façon possible d'augmenter les chiffres de cette section, selon moi, est de tenir compte seulement de l'immigration de couples dont la langue maternelle est le français.
Regardons la situation dans le monde. En Belgique comme dans bien d'autres pays, par exemple, les gens ne parlent pas seulement une langue. On constate que, dans bien des cas, même si la langue maternelle n'est pas le français, la famille le parle quand même 90 p. 100 du temps. Donc, si on ne veut pas faire de l'immigration de couples unilingues francophones, peut-être de France, qui arrivent au Canada pour fonder une famille, c'est certain qu'on va changer les pourcentages dans les statistiques liées à la langue maternelle.
Madame Lamarre, vous en êtes la preuve. Vous avez pu parler le français et vivre en français même si vos parents n'étaient pas nécessairement tous deux des unilingues francophones. Si on se limite à cela, c'est certain qu'on verra un déclin pour le reste de notre vie. Il faut regarder un peu plus loin. Il faut sortir du cadre traditionnel et regarder plus loin.
Je prends l'exemple de Mme Glover. J'ai trois nièces qui fréquentent l'école dans la circonscription de Mme Glover, à Saint-Boniface. Leur langue maternelle n'est peut-être pas désignée comme étant le français, parce qu'elles sont nées d'un parent anglophone et d'un parent francophone. Par contre, 75 p. 100 de leur vie se déroule en français. Je me dis que si ma soeur n'était pas déménagée à Saint-Boniface, à Winnipeg, il y aurait quatre personnes de moins pour donner une vitalité francophone à la communauté.
Si on s'arrête au cadre traditionnel et qu'on le laisse fermé sans jamais y pratiquer de petite ouverture, c'est certain qu'on continuera à voir un problème quant aux statistiques liées à la langue maternelle. Il faut élargir les horizons. Il faut se dire que les immigrants qui arrivent ici, même s'ils ont peut-être appris deux, trois, quatre ou cinq langues ailleurs avant d'arriver ici et que leur langue maternelle ne soit pas le français, ils n'en restent pas moins des francophones. C'est peut-être la procédure utilisée qui pose problème. Si on continue ainsi, on continuera de constater des problèmes et d'en conclure que le phénomène est en diminution partout au pays.
Madame Lamarre, j'aimerais juste savoir si vous avez l'impression que ce que je viens de dire pourrait correspondre un peu à la réalité ou si vous êtes complètement en désaccord avec moi.
:
Bonjour, tout le monde. C'est très intéressant. C'est surtout très volcanique quand on parle de l'immigration et de la francophonie. Je viens du Québec, je suis québécoise moi aussi, je suis francophone de souche.
Quand je suis arrivée ici, à Ottawa, je connaissais yes, no, toaster. J'ai appris à parler l'anglais, et je trouve qu'il y a une très belle complicité entre les deux langues. Je ne me suis jamais sentie assimilée.
En réalité, nos enfants sont beaucoup plus ouverts sur le monde qu'on ne l'était. Ils ont beaucoup plus d'occasions de l'être, ne serait-ce qu'en raison d'Internet et tout. J'ai des filles qui parlent le français, l'anglais, l'espagnol. L'une d'elles apprend l'italien et elle n'en est pas moins francophone.
Je trouve ce débat très intéressant. Souvent, on a se fait une certaine idée. Je m'excuse, monsieur Castonguay, mais les chiffres et les statistiques me posent quelque peu problème. Pour ma part, j'ai de la difficulté à m'y retrouver. En revanche, ce que je vis sur le terrain, c'est autre chose.
J'ai deux questions. On parle souvent de la francophonie par opposition aux anglophones. Je vais commencer par m'adresser à Mme Lamarre ou à M. Jedwab, s'il veut répondre.
Les critères de définition qu'on utilise pour déterminer ce qu'est un immigrant francophone ou anglophone varient selon les gouvernements. Tout le monde le sait.
Pouvez-vous nous donner un aperçu des différents critères de définition qui existent? Quel impact ces critères de définition peuvent-ils avoir sur les communautés immigrantes, sur vos analyses et les résultats de vos recherches? Est-ce un succès en ce qui concerne l'immigration dans les CLOSM, les communautés de langue officielle en situation minoritaire?
:
Merci, monsieur Blaney.
[Français]
On est dans une situation en Amérique du Nord où il y a un melting pot — surtout aux États-Unis, on s'entend. Au Canada, on est dans une situation où le gouvernement est bilingue, c'est-à-dire que la fonction publique est bilingue, mais pas le pays. Il y a une province qui, sur papier, est bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick. Le Québec se déclare français depuis la Loi 22 de Robert Bourassa et les autres provinces sont anglaises. C'est la réalité.
Il y a une autre réalité, en ce qui me concerne, et c'est la raison pour laquelle je suis en politique: il y a un cancer dans ça. C'est un peu comme avoir un cancer, mais sans le reconnaître. C'est l'assimilation ethnolinguistique, c'est la perte du fait français. Qu'on appelle ça des « statistiques écrasées », de la négation ou du déni, il y a des discours — je les entends. Il n'en demeure pas moins qu'au bout du compte, décennie après décennie, depuis 1951, depuis ces recensements, la perte du fait français monte à l'avantage de l'anglais. Je parle du Canada. C'est ainsi dans certaines régions du Québec, mais surtout dans le grand portrait du Canada.
Je me souviendrai toujours, quand je suis allé à Bellegarde, en Saskatchewan, d'avoir rencontré un certain M. Cormier, qui m'a dit — avec un nom comme Cormier: « I'm proud to be French Canadian, even if I don't speak the language.
Mon beau-frère est un Irlandais de Québec. Il s'appelle Terry Bowles. Je lui enverrai les « bleus ». Nous nous sommes souvent disputés. Il me demandait pourquoi j'enseignais le français en Ontario. Je lui ai demandé s'il était anglais et il m'a répondu qu'il était irlandais. Je lui ai demandé de me parler en gaélique et il ne l'a jamais fait. Il a droit à son identité et j'ai droit à la mienne. Une chose est certaine, la force de notre peuple d'expression française en Amérique du Nord nous vient du fait que l'on parle encore notre langue. C'est grâce à nous et à nos combats. Ce n'est certainement pas grâce au gouvernement fédéral, qui a permis à certaines provinces de fermer des écoles francophones, d'assimiler les gens, etc.
Louis Riel n'a pas été pendu pour rien, parlez-en à M. Goldring. Il ne faut pas mettre des lunettes roses. Il faut avoir l'heure juste et regarder la réalité en face.
J'aimerais poser une question à M. Castonguay. Qu'en est-il de la perte du fait français, dans la réalité? En Saskatchewan, j'enseignais à l'école canadienne-française. On essayait de faire du recrutement. Il y avait alors 10 000 jeunes francophones fransaskois en Saskatchewan. De ce nombre, on a pu en recruter 1 000. Les 9 000 autres jeunes fréquentaient des écoles anglaises. Bien qu'il s'agissait d'ayants droit, on n'avait pas tous les effectifs. Il fallait que les parents les inscrivent à notre école. On n'avait pas les effectifs pour faire cela. C'est une responsabilité provinciale. Ne me dites pas que le fédéral peut recruter dans les écoles françaises pour aider les écoles fransaskoises, ce n'est pas vrai.
Qu'en est-il de la situation de l'assimilation, monsieur Castonguay?
:
Merci, monsieur le président.
Bienvenue à tous les témoins.
J'avais des frissons en vous écoutant, madame Lamarre, parce que vous parliez pour moi. Je suis née anglophone, mais je suis très fière d'être en même temps francophone. Je reconnais que, si on me le demande, la langue de mon coeur, ce sont vraiment les deux. Ensuite, tout ce que vous avez dit, monsieur Castonguay, m'a brisé le coeur. Or mon coeur est très fort, et je crois qu'on a le potentiel de changer vos données.
Lorsque les représentants de Statistique Canada ont comparu en comité au cours de la précédente séance, on a parlé du fait que les questions n'étaient pas représentatives de la réalité. Vous l'avez également souligné, madame Lamarre. Au lieu de demander au répondant quelle langue il parle à la maison, on devrait lui demander quelles langues il parle — au pluriel —, afin de traduire vraiment la réalité de la situation.
Comme l'a dit M. D'Amours, on évite de regarder le portrait d'ensemble. On est tellement centré sur des questions trop détaillées que l'on passe à côté de la réalité de la situation.
Je m'excuse, monsieur Nadeau, mais je ne vois pas la situation du Canada comme un cancer. C'est un pays qui offre de belles possibilités à nos immigrants. Ceux-ci m'aident à continuer de perfectionner mon français. C'est grâce à des personnes comme la soeur de M. D'Amours, francophone venue s'installer à Saint-Boniface, que mes enfants sont bilingues. C'est donc très important.
Monsieur Jedwab, dans l'article intitulé « Where there's a will there's a way? » que vous avez produit, vous avez répondu à des questions qui ne sont pas nécessairement posées par Statistique Canada. Cela répond à une de mes questions. J'aimerais que l'on parle de vos données. M. Castonguay parle toujours de la diminution du français dans les communautés francophones, mais dans votre article vous parlez du nombre d'anglophones de naissance qui utilisent le français au travail. Statistique Canada en dénombrerait 400 000, mais M. Castonguay ignore tout cela. Il est important de remarquer que l'influence des francophones envers le reste du Canada nous aide à augmenter le niveau de français.
Pouvez-vous préciser de quelle façon les francophones du Canada influencent et augmentent le niveau de français partout dans les autres communautés en situation minoritaire?
:
Personnellement, je pense que c'est surtout au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans la région de la capitale nationale que l'on a constaté, historiquement, une augmentation du nombre des anglophones qui parlent français en milieu de travail. C'est justement à cause des pressions exercées à cet égard et grâce en grande partie au gouvernement fédéral qui a également fait pression au moyen d'exigences d'emploi, de connaissance des langues officielles, que nous avons cette augmentation.
Jamais, dans l'histoire du Québec, autant d'anglophones et de non-francophones n'ont parlé le français. C'est également vrai pour le Nouveau-Brunswick et l'Ontario en ce qui a trait aux nombres réels de non-francophones, d'anglophones qui parlent le français. Il y a une progression. Même M. Castonguay ne peut pas nier cet accroissement d'anglophones qui parlent le français au Québec. C'est à un niveau historique jamais vu.
Il y a donc également de bonnes nouvelles et il faut continuer à exercer une pression et pas seulement au moyen d'un message selon lequel on aimerait que les gens parlent français, que ce serait très bien, très gentil de leur part. Cela va prendre des pressions au palier fédéral, notamment dans les communautés où il est possible d'encourager les gens par différents moyens à parler le français. Il faut encourager les compagnies qui font affaire avec le gouvernement fédéral à offrir également des services en français. Je sais que cela peut être tough, mais cela prend des mesures tough. Pour ma part, je garde espoir, je suis optimiste face à l'avenir.
Si vous me le permettez, monsieur le président, j'aimerais soulever un argument. On s'est éloignés de notre sujet de départ qui était l'immigration francophone. M. Weston a soulevé un élément très important. Cette idée de décourager des immigrants de s'installer à l'extérieur du Québec comporte un message. Le message est peut-être plus important que les chiffres. Si on envoie le message selon lequel un immigrant francophone ne devrait pas s'installer ailleurs qu'au Québec, on peut envoyer le même message aux Québécois francophones qui désirent se déplacer ailleurs au Canada. On peut également revenir à un scénario, si on suit la logique — logique que je suis certain que ni M. Nadeau ni M. Castonguay ne partagent: on peut dire que tous les anglophones qui habitent de l'autre côté du pont...
Est-ce que je peux me permettre de continuer? Monsieur Castonguay, je sais que vous aimez... Permettez-mois de terminer, je n'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui. J'aurai fini dans quelques secondes, monsieur Blaney.
Mme Shelly Glover: Allez-y, monsieur Jedwab.
M. Jack Jedwab: Je parle de cette logique selon laquelle tous les anglophones devraient habiter d'un côté de la région de la capitale nationale et tous les francophones, de l'autre côté. Je sais, madame, que vous ne partagez pas cette vision des choses, mais le message qu'on envoie aux immigrants francophones selon lequel ils ne devraient pas se déplacer à l'extérieur du Québec contient une espèce de message un peu plus large qui dit que logiquement, idéalement, tous les francophones devraient être d'un bord et tous les anglophones, de l'autre. Je ne pourrai jamais tolérer ni accepter ce message. C'est un peu cela. Au-delà des chiffres, des bons chiffres, des mauvais chiffres, des bons et mauvais indicateurs, il y a un message qu'on envoie à notre société et à nos enfants, mes enfants, ceux de Mme Lamarre et beaucoup d'autres.
Je continue toujours selon la formule question-réponse. Selon ce que Mauril disait plus tôt et ce que M. Castonguay disait aussi,
[Traduction]
« Il faut aussi joindre l'acte à la parole. »
[Français]
Je me souviens d'un monsieur de La Broquerie, au Manitoba, que j'aime beaucoup, qui vit maintenant dans la région et qui a déjà été mon patron. Il s'agit de Ronald Bisson, le directeur général de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Il avait demandé à Roger Bernard, qui nous a malheureusement quitté — il est décédé —, de faire une étude intitulée Vision d'avenir de la francophonie. En quatre volumes, il disait que cette étude était un premier tracé à faire pour parvenir à l'assimilation zéro et à la « refrancisation » avancée. Quand j'étais à la Fédération des francophones de Saskatoon, j'avais proposé cela comme un champ de bataille pour l'Association culturelle franco-canadienne de Saskatchewan de l'époque, qui est devenue l'Association communautaire fransaskoise, et l'on avait ri de moi. Qu'on rie de moi, ça ne me pose aucun problème. N'empêche que le problème est là, car on disait là-bas qu'il n'y avait plus rien à faire. Imaginez-vous! C'étaient des gens qui étaient à Moose Jaw pour repenser l'avenir de la fransaskoisie. Cependant, j'ai quand même continué à me battre pour cela. On demandait une province bilingue et on demandait d'effacer les gestes des conservateurs de Grant Devine: ils avaient jeté des choses à la mer en ce qui a trait à la francophonie, et on considérait que c'était épouvantable. Donc, il faut savoir cela.
En effet, il y a des communautés qui sont toujours là, madame Lamarre, et je suis conscient qu'il faut les aider. Toutefois, il faut aussi être conscient de l'assimilation et du fait que la masse critique francophone en Amérique du Nord, sur un territoire, forme une nation, et c'est le Québec. Il ne faut pas oublier ce cap. Car si le Québec subit l'assimilation ou rétrécit, son rayonnement... Il ne faut pas affaiblir le côté le plus fort. Il faut aider les plus faibles dans ce combat, mais il faut voir où mettre nos énergies.
Monsieur le président, M. Castonguay peut-il déposer ses deux études aux fins de traduction? Ainsi, on pourrait les avoir en temps et lieu une fois la traduction faite.