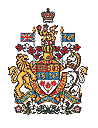:
Monsieur le président, je vous remercie de vos belles paroles. J'espère être à la hauteur de vos attentes.
[Traduction]
Mesdames et messieurs, j'ai un texte préparé et j'ai également distribué deux tableaux dont je parlerai plus tard. Ils sont destinés à être rendus publics. Il ne s'agit pas de documents scientifiques mais de la perspective d'un soldat.
Monsieur le président, mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à prendre la parole devant vous à propos d'une menace importante au bien-être à long terme des Forces canadiennes, de ses membres et des anciens combattants, ainsi qu'à l'efficacité opérationnelle des Forces canadiennes. Le fait de perdre des anciens combattants d'expérience en service nuit gravement aux capacités opérationnelles des Forces canadiennes. L'excellent sixième rapport du comité traite déjà d'une bonne partie de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et j'espère vous fournir une certaine mise à jour de la situation de même d'une certaine perspective, et formuler également quelques recommandations.
Vous avez entendu des témoins qui ont parlé des lacunes des services de santé des Forces canadiennes, et plus particulièrement des services de santé mentale, et vous avez entendu le commandant du Groupe des services de santé des Forces canadiennes, le brigadier-général Hilary Jaeger, vous parler également du travail extrêmement difficile et de l'obtention de résultats cliniques exceptionnels, particulièrement outre-mer. Comment la même organisation peut-elle réussir et échouer en même temps?
Permettez-moi de commencer en vous situant un peu le contexte en fonction des observations que j'ai eu l'occasion de faire à titre de sous-ministre adjoint du personnel militaire à la fin des années 90, à titre de soldat qui a été victime de stress opérationnel qui a fait l'objet d'un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, ce qui a donné lieu par la suite à ma libération pour des raisons de santé, à titre d'ancien combattant en convalescence qui reçoit des traitements constants et à titre de sénateur qui reçoit des courriels et des demandes d'appui de la part des membres des Forces canadiennes, des anciens combattants et des familles des deux groupes.
[Français]
À la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusque pendant la guerre de Corée, le travail du Corps de santé royal canadien et du Corps dentaire royal canadien faisaient l'envie de nos alliés. À l'époque, les facultés de médecine et d'art dentaire étaient dirigées par d'anciens officiers médecins et dentistes. Les Forces canadiennes accueillaient la crème de la crème. Au fil du temps, la perspective de s'occuper en temps de paix des Forces canadiennes, composées de jeunes gens en bonne santé dont les seuls problèmes étaient des rhumes ou des blessures de sport de temps à autre, est devenue de moins en moins attrayante pour le milieu et les meilleurs diplômés. Ils s'enrôlaient toujours, mais le recrutement devenait de plus en plus difficile.
Lorsque la guerre froide a pris fin et que l'on a réclamé les dividendes de la paix, la structure du service médical a commencé à s'écrouler à cause des compressions budgétaires massives et pas nécessairement bien ciblées. Lorsque j'étais sous-ministre adjoint au personnel, nous avons appliqué une solution superficielle qui s'appelait Opération Phoenix. Elle n'a vraiment rien donné, si ce n'est qu'elle a mis en lumière les déficiences qui existaient dans le système. Nous avons alors récidivé avec le projet Rx 2000, un titre plutôt accrocheur. Heureusement, cette initiative se poursuit et donne les résultats que nous observons particulièrement à Kandahar dans le milieu opérationnel.
[Traduction]
En 1997, lorsque je suivais un traitement médical, j'ai pris la décision délibérée mais douloureuse de rendre public mon diagnostic au sein des Forces, et par la suite, cette information à propos de mon diagnostic de trouble de stress post-traumatique s'est propagée au grand public. Certains m'ont qualifié de porte-étendard du trouble de stress post-traumatique, un qualificatif que je considère désobligeant et blessant. Cependant, les innombrables lettres et courriels que j'ai reçus de familles qui déclarent que la vie de leurs conjoints et de leur mariage a été sauvée grâce à ma franchise font plus que compenser pour l'absence de compassion dont ont fait preuve d'anciens collègues et des éditorialistes loin d'être bien disposés à mon égard.
Lorsque mon livre a été publié aux États-Unis, le texte à l'endos du livre indiquait que j'avais été libéré pour des raisons de santé suite à un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Lorsque j'ai demandé la raison pour laquelle on avait ajouté cette information sans m'avertir, on m'a dit que j'étais le seul général jusqu'à présent qui avait reconnu être atteint de trouble de stress post-traumatique.
Je porte cet aspect à votre attention parce que ce trouble se caractérise entre autres par le besoin irrépressible de se cacher, de se retirer comme si l'on avait attrapé une maladie contagieuse terriblement dévastatrice comme le VIH/sida ou la lèpre, et par la conviction que l'on a failli à la tâche et qu'on a laissé tout le monde tomber.
En tant que soldat, on fait des cauchemars qui reviennent constamment où on place ses collègues dans des situations où l'on devient en fait un fardeau pour eux, un risque pour leur sécurité. Au début, je pensais que j'étais le seul à faire ce genre de cauchemars, mais d'autres m'ont dit qu'eux aussi faisaient des cauchemars aussi terribles. Par la suite, j'ai demandé qu'on me libère de ma mission à cause des répercussions de ce trouble à l'époque.
Le Dr James Obinski, qui est à la tête de Médecins sans frontières, qui travaillait à l'hôpital King Faisal à Kigali au moment du génocide au Rwanda en 1994 décrit le trouble de stress post-traumatique dont il est atteint et ses effets même sur un excellent médecin professionnel:
Je roulais sur l'autoroute 401 à Toronto lorsque j'ai croisé une Mazda Miata bleue. Elle était de la même couleur que la bâche en plastique à laquelle j'ai rêvé pendant des mois sans savoir pourquoi. Instantanément, ma voiture s'est remplie de l'odeur douceâtre de la chair et du sang de cadavres encore tièdes. J'ai vu ce que j'ai d'abord pris pour des saucisses mais qui était en fait des doigts d'enfants dans la terre rouge qui entourait la bâche. Ma voiture a fait une embardée pendant que j'essayais d'ouvrir les fenêtres. Le pare-choc a éraflé la glissière de sécurité au moment où la voiture s'est complètement immobilisée. Je suis resté assis dans la voiture, l'odeur et l'image des saucisses ayant disparu. Dehors, la neige tombait. Les essuie-glace battaient la mesure, mais j'avais perdu la notion du temps. Ce n'est pas le monde qui avait changé, c'était moi. Je suis resté assis là, à compter les déchets et les débris qui jonchaient le bord de la route, puis j'ai simplement roulé pendant un certain temps. Je suis arrivé à la maison de mes parents trois heures plus tard.
En 1997, je voyageais avec ma famille à l'Île-du-Prince-Édouard. Nous roulions sur une route où étaient empilées, de chaque côté de la route, de grosses branches d'épinettes qui avaient été abattues. L'extrémité des branches faisaient face à la route et les aiguilles étaient devenues brunes.
J'ai eu immédiatement l'impression de me retrouver au Rwanda et de voir empilés au bord de la route les cadavres de Rwandais en décomposition. Cette impression était tellement forte que j'ai dû en fait m'arrêter et il m'a fallu beaucoup de temps pour sortir de cet état grâce à l'appui solide de ma famille.
Le trouble de stress post-traumatique est un traumatisme. C'est un trouble chronique. Même lorsque l'on prend fidèlement ses médicaments et que l'on suit fidèlement ses séances de thérapie, on est constamment vulnérable et on risque toujours de retomber dans ces états de choc, où on replonge dans l'horreur et où l'on perd complètement le sens de la réalité, ce qui au bout du compte engendre la panique. Si on est dépressif lorsqu'on vit l'un de ces épisodes, on est susceptible de se suicider.
[Français]
Lorsque les cliniques des Forces canadiennes ont été mises sur pied, deux erreurs ont été commises. On a insisté pour les appeler des cliniques de santé mentale. Elles portent maintenant le nom de Centres de soins pour trauma et stress opérationnels. Quand un soldat éprouve des problèmes psychologiques, il est de loin préférable qu'il se rende dans un service ainsi désigné, étant donné la stigmatisation des problèmes de santé mentale. Le SSPT n'est pas une maladie, c'est une blessure.
Le deuxième problème, et c'est peut-être l'obstacle le plus important, est l'endroit où se trouvent ces cliniques. Les soldats, comme tous ceux qui ont des problèmes de santé, tiennent à protéger leur anonymat. S'ils sont contraints de se présenter dans un service clairement identifié comme étant destiné au traitement des problèmes psychiatriques ou psychologiques, les soldats refusent de s'identifier comme des personnes ayant des problèmes d'ordre psychologique ou suivant des traitements pour ce genre de problèmes. Certains demandent de partir pour ne pas avoir à subir la gêne associée au fait de se présenter dans ces services et de s'exposer aux sarcasmes des autres soldats. Ils sont même prêts à quitter les Forces canadiennes.
La détection et le traitement précoces des problèmes de stress opérationnel sont absolument essentiels à toute guérison ou état de « raisonnabilité ». Les Forces canadiennes ont fort bien réagi à cette exigence et ont mis en oeuvre des procédures pour tenter de déceler ces problèmes. Néanmoins, vous avez lu ou entendu des choses au sujet de cas qui passent entre les mailles du filet. C'est un fait. Ça se produit parce que le soldat blessé veut peut-être passer entre les mailles du filet, parce qu'il veut échapper totalement à tout système de contrôle ou à tout contact avec des anciens camarades qui lui rappellent les problèmes qu'il vit. La stigmatisation de ces problèmes occupe toute la place dans son esprit. En effet, il se sent hautement stigmatisé encore aujourd'hui.
Pour ce qui est des réservistes, ils habitent, dans certains cas, loin des centres urbains ou des bases militaires. Il n'existe aucun moyen officiel de les contraindre à continuer de s'y présenter ou de leur fournir les fonds pour qu'ils le fassent, à moins qu'ils n'aient été libérés et ne soient confiés aux soins d'Anciens Combattants Canada. À l'égard des soins, ils sont dans un état de léthargie susceptible de causer de sérieux troubles de comportement et de faire en sorte qu'ils deviennent, à l'occasion, un risque pour la société.
Je crois que les Services de santé des Forces canadiennes sont conçus, en pratique et en théorie, pour remettre les soldats sur pied, assurer leur convalescence et les renvoyer rapidement à leur poste, ce qui est normal quand on veut que les services demeurent opérationnels. Mais établir cette normalité raisonnable dans le cas d'une blessure de stress opérationnel n'est pas comme se faire remplacer un genou ou suivre des traitements de physiothérapie. Cette blessure nécessite un long et essentiel processus de soutien avant que la personne atteigne un jour un état de convalescence raisonnable, mais aussi qu'elle puisse recourir à une prothèse lui permettant de survivre au quotidien sans retomber dans un état de choc et de stress.
Je ne crois donc pas que, dans ce domaine de soins médicaux, nous soyons parvenus au même degré d'excellence que celui des chirurgiens et des dentistes. Il s'agit d'une dimension entièrement nouvelle des soins de santé dispensés aux militaires. Les services ne sont pas et ne seront peut-être jamais préparés à affronter ce genre de problème, compte tenu des guerres qui continuent à évoluer de façon changeante et significative avec les années.
[Traduction]
On a dit que l'on n'arrive pas à attirer les spécialistes voulus dans les Forces canadiennes à cause de la faible rémunération comparativement à leurs homologues civils. Cela n'est pas entièrement le cas, parce que s'enrôler dans les Forces canadiennes et servir le Canada, c'est une vocation, et la rémunération a toujours été un facteur secondaire pour les spécialistes, de même que pour la population militaire en général. Cependant, il faut offrir une rémunération responsable.
Quoi qu'il en soit, le nombre important de psychiatres et de psychologues dont on a besoin pour traiter le nombre de soldats qui reviennent au pays, souffrant de stress opérationnel, exige que l'on fasse appel en grand nombre à des spécialistes du secteur civil. Il existe des spécialistes civils qui travaillent dans certaines cliniques multidisciplinaires des Forces canadiennes, mais j'ai appris que le roulement est élevé parce que les spécialistes civils n'arrivent pas tous à composer avec le milieu de travail des Forces canadiennes, ses règles et ses règlements, et une hiérarchie du commandement qui parfois rejette leur opinion d'experts.
On m'a parlé des diverses échelles salariales du secteur civil. Apparemment, un spécialiste civil qui travaille pour les Forces canadiennes gagne un salaire nettement moins élevé qu'un spécialiste qui travaille à une clinique communautaire financée par les régimes de santé provinciaux dans de nombreuses régions du pays. Parmi les chiffres intéressants qui ont été fournis, un psychiatre en Alberta peut gagner jusqu'à 195 000 $ par an, tandis que le salaire maximum annuel au Québec est de 97 000 $. La moyenne nationale est de 159 000 $, et au Conseil du Trésor le maximum est de 128 469 $. Vous pouvez constater qu'une personne qui travaille à temps plein pour les Forces canadiennes gagnera pratiquement 29 000 $ de moins que la moyenne nationale. Pourtant, les Forces canadiennes ne semblent pas connaître de problèmes au Québec.
Faire appel à des fournisseurs de soins de santé de l'extérieur n'est pas une solution idéale parce que les Forces canadiennes perdent le contrôle du service et qu'un tel programme est invariablement plus coûteux qu'un programme interne.
[Français]
J'ignore si on a expliqué aux membres du comité toute la gamme possible des blessures de stress opérationnel. Tous les malades ne sont pas atteints du syndrome de stress post-traumatique. On me dit que parmi les très nombreux cas de stress opérationnel, seulement 8 p. 100 sont considérés comme des cas de syndrome de stress post-traumatique.
Par contre, on me dit aussi que si un cas bénin de dépression mineure n'est pas décelé et traité de toute urgence, il risque de devenir grave, puis chronique, ce qui peut entraîner des problèmes comme l'alcoolisme, la toxicomanie, des comportements compulsifs inacceptables et même le syndrome de stress post-traumatique. Les traitements, qui coûtent quelques milliers de dollars au premier stade, finissent par coûter une petite fortune, et les blessés risquent fort de perdre leur famille, leur emploi, voire leur vie parce que le système n'intervient pas avec le même sentiment d'urgence que pour les blessures physiques. Hélas, il y a des délais inhérents à l'obtention de traitements, la cause étant qu'il faut pour obtenir des rendez-vous chez les spécialistes. L'approche multidisciplinaire du traitement du syndrome de stress post-traumatique semble celle qui convient le mieux, car elle est utilisée dans les cliniques qui auraient le meilleur taux de réussite.
Lorsque les Forces canadiennes ont imposé aux patients une analyse psychologique avant d'être aiguillés vers un psychiatre, certains y ont vu un moyen de vérifier si les soldats feignaient les symptômes pour obtenir des prestations pour syndrome de stress post-traumatique. Heureusement, les spécialistes sont tout à fait aptes à établir qui est vraiment malade et qui ne l'est pas. Ils ont rarement besoin d'une seconde opinion. Toutefois, l'obligation de consulter un psychologue avant de pouvoir consulter un psychiatre fait doubler et même tripler le temps d'attente avant le début du traitement, car les psychologues sont aussi rares que les psychiatres. En cherchant la solution idéale, nous avons exacerbé une situation déjà grave, en retardant davantage le traitement des malades.
[Traduction]
Avec votre permission, je voudrais rapidement faire part au comité de quelques recommandations. J'ai pris bonne note du rapport qu'a produit le comité des affaires des anciens combattants de la Chambre des communes, qui contient d'excellentes recommandations visant une collaboration plus étroite entre les services de santé des Forces canadiennes et ceux d'Anciens combattants Canada.
Je crois qu'il est absolument essentiel que les cliniques des Forces canadiennes ne se retrouvent plus dans les bases et elles pourraient même, au besoin, partager des locaux avec les cliniques d'Anciens combattants Canada ou des cliniques pour civils dans les collectivités. Il faut éliminer le goulot d'étranglement attribuable au fait que les patients ne peuvent commencer leur traitement qu'après avoir consulté un psychologue, qui doit faire une évaluation très longue avant qu'ils puissent voir un psychiatre. Il faut qu'on puisse identifier ceux qui ont besoin d'aide et leur permettre de commencer leur traitement plus vite.
Il faut également suivre l'état de santé des réservistes pendant un délai assez long, qui pourra même aller jusqu'à cinq ans après leur retour d'une zone de service spécial. Sur les 12 officiers qui étaient au Rwanda avec moi au début du génocide, neuf ont succombé à cette maladie, le dernier y ayant succombé neuf ans après coup.
Il faudrait réduire le nombre de périodes d'affectation à l'étranger ou accroître le soutien aux familles.
Je vous invite à examiner les tableaux que je vous ai remis. Ils n'ont pas de caractère scientifique, mais se fondent sur la période d'affectation que j'ai effectuée pendant que j'étais sous-ministre adjoint responsable du personnel et sur les résultats que nous avions à ce moment-là. Un des tableaux présente la courbe normale du stress, qui serait une courbe simple où les familles évolueraient au fil du temps que dure normalement la carrière. C'était certainement le cas durant la Guerre froide, et il y a un peu plus de stress quand le conjoint ou la conjointe travaille ou que les enfants sont à l'école secondaire et ne veulent pas déménager. Cependant, dans les années 1990, le scénario a changé du tout au tout et le stress est de plus en plus exacerbé de nos jours.
Nous n'amenons pas les gens à redescendre de cette courbe exponentielle de stress après ces missions très complexes et dangereuses, si nous ne leur donnons pas assez de temps ni un soutien suffisant pour qu'ils puissent évoluer vers leur prochaine mission, pour qu'ils puissent en arriver à dire: la mission était difficile, mais nous nous en sommes sortis, nous en avons tiré des leçons et nous sommes prêts pour la prochaine mission. Ce qui se passe, c'est que, parce que les rotations sont tellement rapprochées et que nos effectifs sont si peu nombreux, nos militaires passent aussitôt d'une série de facteurs de stress à une autre série, ce qui fait qu'ils s'effondrent littéralement, et les membres de leurs familles aussi. Nous avons même eu des cas de suicide.
Les Forces canadiennes ont institué un excellent programme de décompression pour les militaires qui reviennent de zones de service spécial comme l'Afghanistan, mais il n'existe pas de programme structuré pour le grand nombre de renfort individuel qui sont déployés avec ces unités et qui reviennent ensuite au pays. Mon fils est censé revenir dans deux semaines d'une période de service de six mois en Sierra Leone, en Afrique, et il n'existe pas de programme pour que nous puissions évaluer ceux qui reviendront comme lui et les amener à un certain niveau de normalité.
On recommande que les Forces canadiennes soient chargées de s'attaquer à cette question du grand nombre de ces personnes qui sont bien plus vulnérables que celles qui font partie de groupes militaires officiels, elles sont bien plus vulnérables à la contagion du trouble du stress post-traumatique. Le problème tient au fait qu'elles ne sont pas identifiées et qu'elles ne peuvent pas être traitées par la suite ou qu'elles sont traitées trop tard, sans doute après qu'elles se sont détruites elles-mêmes et qu'elles ont détruit leurs familles.
Le ministère de la Défense nationale et le ministère des Anciens combattants devraient unir leurs efforts pour construire un centre national de développement de la formation en recherche à Ste-Anne. Je recommanderais que l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Bellevue devienne un centre d'expertise et de savoir en la matière pour que nous ne nous retrouvions pas aux prises avec le même problème que la dernière fois, où il a fallu plus de 10 ans avant de pouvoir rebâtir le système afin qu'on puisse s'occuper de ceux qui souffrent de blessures psychologiques après avoir participé à des conflits. Nous devons maintenir un centre d'expertise permanente.
Enfin, il faut trouver un moyen d'incorporer les familles au processus de traitement, et ce, de façon structurée. Si nous ne traitons que les militaires, sans traiter leurs familles, nous ne pourrons pas atteindre les niveaux opérationnels que nous espérons atteindre en ramenant ceux qui ont été blessés à un niveau où ils peuvent reprendre leurs fonctions.
J'ai une observation dont j'aimerais vous faire part en guise de conclusion. Quand je suis rentré du Rwanda en 1994, ma belle-mère m'a dit qu'elle n'aurait pas survécu à la Seconde Guerre mondiale si elle avait dû vivre ce qu'avaient vécu ma femme et mes enfants.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon beau-père commandait un régiment. Il a participé à toutes les opérations sur le terrain. L'information qui était communiquée aux militaires était rare et souvent censurée.
Aujourd'hui, les familles des militaires participent aux missions en même temps qu'eux. Ils suivent continuellement ce qui se passe à la télévision, écoutent la radio et consultent l'Internet qui leur apprend quand leur fils, leur fille, leur mari ou leur conjoint a été tué, blessé ou enlevé. Lorsqu'ils reviennent de ces missions, les militaires ne sont plus les mêmes et nous non plus. Un système qui n'accepte pas ses responsabilités envers ceux qui sont envoyés en mission, qui ne s'occupent pas d'eux à leur retour est un système qui comporte de graves lacunes.
Je comprends que cela soulève la question des compétences du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux, mais cela ne devrait pas nous empêcher de maintenir l'efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en accordant un soutien non seulement à ses membres, mais aussi à leurs familles. Cela ne peut qu'accroître notre efficacité.
Je vous remercie.
:
En 1997, alors que j'étais chef d'état-major responsable du personnel et que j'ai porté à l'attention du public le fait que nous informions mal nos propres gens, et à plus forte raison les autres, je suis allé au U.S. Veterans Center for Post-traumatic Stress Clinics, située à White River Junction, au Vermont, pour leur demander si tous les cas devraient être traités de la même façon, comme les commandants avec leur stress et leur formation, en comparaison des soldats. Je leur ai également demandé de nous aider à mettre au point notre propre programme rapidement, puisqu'ils avaient l'expérience du Vietnam.
Ils m'ont répondu: « Nous ne voulons pas que vous viviez ce que nous avons vécu au Vietnam et nous allons vous aider », parce qu'en 1997, il y avait encore des suicides directement attribuables au Vietnam. Ils ont perdu 58 000 soldats au Vietnam. En 1997 ils avaient enregistré plus de 102 000 suicides directement reliés au Vietnam.
C'est un traumatisme, une blessure qui ne guérit jamais. On ne peut pas s'en sortir, comme M. Bachand me le demandait, sans thérapie professionnelle, sans médicaments et sans un ami dévoué. L'aide fournie par les pairs dans le cadre du programme de soutien social aux victimes de stress opérationnel est absolument essentielle. On a besoin de quelqu'un qui restera là pendant quatre heures sans poser une seule question, à vous écouter parler sans fin. On a besoin de cela en tout temps.
On ne peut jamais prédire ses points vulnérables. C'est comme être soudain privé d'une prothèse. Je vais vous donner un exemple, si vous me le permettez. J'étais en Sierra Leone où je participais à la démobilisation des enfants soldats — en fait, à l'époque, je travaillais pour Mme Minna — j'arrivais de la zone de rébellion et je traversais la rue à Freetown. Du coin de l'oeil, j'ai aperçu un vendeur de noix de coco qui installait son étal; il avait une machette. J'ai poursuivi mon chemin et tout à coup il a fait sauter le dessus d'une noix de coco d'un coup de machette. J'ai vu le liquide blanc, le brun, et entre le son et le tableau, j'ai complètement disjoncté.
Les trois personnes qui m'accompagnaient ont dû s'asseoir sur moi pendant au moins cinq minutes pour m'immobiliser, puis, tranquillement, j'ai pu récupérer. Environ 20 minutes plus tard, je faisais un exposé. Cela montre qu'on ne sait jamais d'avance quel bruit, quelle odeur, et quel commentaire déclenchera ces réactions.
L'an dernier, j'ai participé à une partie de golf avec des soldats de mon ancien régiment, le 5e régiment d'artillerie. Il y avait là des sergents qui étaient dans l'armée depuis 10 ans. Comme il faut au moins un an au moins d'entraînement pour qu'ils développent une force minimale et qu'ils suivent ensuite d'autre formation, ils devaient avoir neuf ans de service opérationnel. Ils avaient participé à sept missions!
Nous avons des soldats à l'heure actuelle dans les forces canadiennes qui ont passé plus de temps au combat que les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. À ce rythme, les forces vont continuer à diminuer par attrition des soldats et de leur famille, à moins qu'on rehausse le recrutement. Il ne s'agit pas de réduire le nombre de missions, car nous devrions également être présents au Darfour et à d'autres endroits; il faut augmenter le nombre de recrues.
Reconstruire une armée est un projet à long terme et je crains qu'il y aura d'autres victimes, simplement à cause de l'épuisement professionnel.
En terminant je dirais, il y aura probablement des militaires victimes de ce traumatisme, qui seront envoyés en mission. Dieu sait, un bruit ou un événement peut déclencher une crise, et nous ne savons pas quelle sera leur efficacité.
:
Je m'appelle Greg Passey. J'ai servi pendant 22 ans dans les Forces armées canadiennes, jusqu'en septembre 2000, d'abord à titre de médecin militaire généraliste, et ensuite, au cours des neuf dernières années, en psychiatrie, avec spécialisation dans le traitement du trouble de stress post-traumatique et pathologies connexes associées au stress opérationnel.
J'ai mené à bien le premier projet de recherche de grande envergure au monde sur le TSPT et les principaux troubles dépressifs associés au déploiement de maintien de la paix. Ce projet a été mené parmi les militaires canadiens déployés en 1993-1994 dans le cadre de l'Opération Harmonie et de l'Opération Cavalier dans l'ancienne Yougoslavie.
Auparavant, on savait qu'il y avait des coûts et des troubles psychologiques associés à la conduite des opérations de combat. En 1990, dans leur livre intitulé Battle Exhaustion: Soldiers and Psychiatrists in the Canadian Army, 1939-1945, Copp et McAndrew ont expliqué en détail qu'environ 25 p. 100 des pertes parmi les soldats canadiens durant la campagne d'Italie de la Deuxième Guerre mondiale étaient dues à des causes neuropsychiatriques, ce que l'on appellerait aujourd'hui des troubles de stress opérationnels.
Mes recherches effectuées en 1993-1994 pour le médecin chef et le service médical des Forces canadiennes ont révélé un taux de dépression de 12 p. 100 et un taux de TSPT de 15,5 p. 100, ce qui donne un taux global de 20 p. 100 pour l'un ou l'autre de ces troubles ou les deux, dans un régiment du génie de combat, le deuxième bataillon du Princess Patricia's Canadian Light Infantry et le deuxième bataillon du Royal Canadian Regiment, à leur retour au Canada après une affectation à des tâches de maintien de la paix. Cela a permis d'établir s'il y avait un coût allant au-delà de l'argent, du matériel et des blessures physiques, pour les opérations militaires de maintien de la paix ou d'établissement de la paix.
Ces chiffres ont créé un choc dans l'appareil militaire et les haut gradés refusaient au départ d'accepter ces constatations et d'y remédier. La réaction immédiate semblait consister à essayer de trouver des moyens de passer cela sous silence ou de mettre en doute la validité des chiffres, au lieu de prendre l'initiative et d'établir un plan pour l'acquisition et la réaffectation des ressources médicales nécessaires pour s'attaquer à un problème de santé imminent parmi les militaires.
Les recommandations faites par moi-même et d'autres spécialistes de la santé relativement à l'acquisition et au placement d'équipes médicales multidisciplinaires au sein des brigades et dans les déploiements ont été essentiellement laissées de côté, jusqu'à la publication des constatations de la commission d'enquête sur la Croatie. C'est alors que le général Dallaire, en 1997, a dévoilé publiquement son diagnostic de TSPT et est devenu un fervent défenseur de l'évaluation de la santé mentale des membres des Forces canadiennes et des traitements nécessaires. Même alors, ce n'est pas avant 1999 que l'on a finalement décidé d'ouvrir des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles de stress opérationnel, mais on n'en a pas créé à la base de Petawawa.
Les recherches récentes indiquent que le taux de TSPT parmi les militaires canadiens de retour d'Afghanistan est d'environ 5 p. 100. Cela pourrait donner 250 nouveaux cas de TSPT chaque année. Les taux applicables aux militaires américains en Irak révèlent que les forces régulières ont un taux de TSPT de 17 p. 100, tandis que le taux est de 25 p. 100 pour la garde nationale. Cela corrobore mes constatations en ce sens que les réservistes courent plus de risques de souffrir du TSPT. Au Canada, nous utilisons une proportion élevée de réservistes dans les effectifs que nous déployons, et pourtant, le système médical et le suivi pour les réservistes ne sont pas à la hauteur de ce qui est offert aux forces régulières.
Le fait de ne pas donner accès à des spécialistes militaires qui peuvent diagnostiquer et traiter le TSPT entraîne un coût important pour les unités, les soldats et leurs familles et pourrait potentiellement donner lieu à des poursuites. En 1994, on a rapporté dans The Medical Post que le ministère de la Défense de Grande-Bretagne a accepté de payer 100 000 livres au caporal Alexander Findlay pour ne pas avoir diagnostiqué et traité convenablement le TSPT.
En 2002, dans un article du National Post, on signalait que sergent Peter Duplessis avait intenté des poursuites contre le ministère canadien de la Défense nationale et en particulier contre le Dr Boddam pour n'avoir pas diagnostiqué et traité son TSPT. C'est d'une importance particulière parce que de 1995 à 2008, le colonel Boddam était le principal praticien en psychiatrie et en santé mentale dans les Forces canadiennes. À ce titre, il conseillait le service médical des Forces canadiennes sur la taille, le placement, la composition et la direction des ressources de santé mentale dans les forces armées.
Le colonel Boddam a admis durant l'interrogatoire préalable en 2003 qu'il n'avait pas posé de questions qui lui auraient permis de diagnostiquer le TSPT. Cette affaire a par la suite donné lieu à un règlement hors cour moyennant une somme considérable, mais le colonel Boddam a conservé ses postes de clinicien et de conseiller. D'autres personnes dans des situations semblables auraient également intenté des poursuites, mais ils en ont été empêchées par la loi de prescription. À l'heure actuelle, d'autres poursuites contre les Forces canadiennes sont en instance devant les tribunaux ou font l'objet de négociations en vue d'un règlement pour des questions de TSPT.
La compétence demeure problématique dans la prestation des soins de santé à nos soldats blessés. À titre d'exemple, le caporal A a récemment été évalué, il y a quatre mois, dans une clinique OSI et diagnostiqué comme souffrant du TSPT. Pendant l'examen, il a reconnu qu'il buvait beaucoup d'alcool, mais le spécialiste n'a pas précisé quelle quantité et n'a pas demandé au caporal s'il avait des idées suicidaires. C'est important, parce qu'une consommation excessive d'alcool précède souvent une tentative de suicide.
Le caporal A était tout à fait suicidaire et il est chanceux d'être encore en vie aujourd'hui, uniquement grâce à l'intervention d'un autre clinicien expérimenté. Environ 49 p. 100 des personnes souffrant de TSPT ont des idées suicidaires et environ 19 p. 100 font des tentatives de suicide.
Les FC ont fait un progrès considérable avec la création du CSTSO et l'établissement de procédures de dépistage dans le cadre du réseau OSISS, et il est certain que dans son récent message le général des Forces canadiennes, le général Hillier insiste sur l'importance de la santé mentale avant son départ.
Néanmoins, tout indique que les ressources cliniques sont surchargées de travail. J'en ai eu la confirmation il y a deux jours à l'occasion d'une conversation avec un médecin en partance pour l'Afghanistan à partir de la base de Valcartier, où il y a des listes d'attente pour le traitement. Je donne des cours à tous les médecins qui partent en mission en Afghanistan et qui se rendent au centre de traitement des traumatismes de l'Hôpital général de Vancouver.
De plus, la plupart des évaluations et des traitements des troubles de stress opérationnel sont maintenant effectués par des spécialistes civils embauchés dans le cadre de contrats avec les FC ou les Anciens Combattants. L'acquisition de ces ressources fait directement concurrence aux organisations civiles de santé, et nombre des spécialistes embauchés ne possèdent pas nécessairement l'expérience clinique ni la connaissance du milieu militaire nécessaires pour dispenser des soins optimaux.
Je voulais aborder un certain nombre de questions. La première est le stigmate associé à la santé mentale et au diagnostic de troubles de stress opérationnel. Une recommandation stipule que les Forces canadiennes adoptent une politique de tolérance zéro relativement à toute discrimination à l'égard des personnes diagnostiquées du TSI, tout comme on a établi la tolérance zéro pour toute discrimination pour des motifs de religion ou de sexe. Nous devons changer la terminologie et remplacer « santé mentale », qui stigmatise fortement la personne ainsi visée, par « santé neurologique ». Nous devons aussi élaborer un programme spécifique pour maintenir les gens au sein des FC, le cas échéant, par exemple, en les réaffectant à d'autres emplois militaires.
Au sujet des cliniciens expérimentés, je pense qu'il est important que les FC et les Anciens Combattants coparrainent une conférence nationale annuelle à laquelle assisteraient tous les cliniciens dispensant des soins de santé mentale, moyennant des crédits d'éducation continue, pour se pencher sur les questions d'évaluation et de traitement, la culture militaire, les éléments de stress en mission, la continuité des soins, et la transition à la vie civile, le tout assorti d'un forum pour la rétroaction des cliniciens. Les civils qui sont embauchés doivent recevoir une formation spéciale et il faut recruter de façon continue des cliniciens qui ont au moins deux ou trois ans d'expérience. Mais à part cela, il faut un programme de mentorat pour aider les cliniciens les moins expérimentés.
Il faut aussi établir un programme d'assurance de la qualité à la fois dans les FC et aux Anciens Combattants dans le domaine de la prestation des soins de santé, avec participation des militaires, de leurs familles et des autres cliniciens.
Pour les soins dispensés aux réservistes, je recommande qu'un spécialiste des soins de santé soit chargé expressément de superviser la prestation de soins de santé aux réservistes, et en outre, que l'on mette au point un système de suivi et une politique garantissant un suivi d'au moins deux ans, surtout pour ceux qui quittent la réserve.
Et puis il y a des problèmes qui se posent continuellement pour ce qui est de la continuité des soins pendant la transition, ce dont nous a parlé le général Dallaire. Il faut accroître les ressources consacrées aux membres de la famille.
Je vous remercie de votre temps.
:
Monsieur le président, je suis le révérend capitaine (à la retraite) Allan Studd. Je suis prêtre anglican, aumônier à la retraite des forces canadiennes et thérapeute matrimonial et familial.
Fis et petit-fils de militaires de carrière, j'ai grandi dans les bases militaires de Wainwright, de Borden et d'Oakville.
J'ai été ordonné en 1979. Bien qu'on ait tenté à quelques reprises de m'obtenir un poste dans l'aumônerie militaire, ce n'est qu'en 1994 que suis devenu aumônier à la BFC de Petawawa. Le 4 août 1995, je suis devenu officier et aumônier du premier régiment de défense antiaérienne, unité de la réserve alors étable à Pembroke, en Ontario, et composante du 2e groupe-brigade mécanisé du Canada de la BFC de Petawawa.
Dans le cadre de contrats de classe B successifs, j'ai fait fonction d'aumônier de garnison puis d'aumônier du 2e régiment du génie et du 1er régiment de défense antiaérienne. Par la suite, j'ai été affecté au poste d'aumônier de base et de coordonnateur des activités paroissiales. J'ai été libéré pour des raisons médicales le 30 octobre 2002. Je souffre du trouble de stress post-traumatique, de dépression majeure et de migraines.
Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit le général Dallaire dans son exposé. En bref, souvenons-nous qu'entre 1994 et 2000, les soldats de la BFC Petawawa revenaient de Somalie pour voir le régiment aéroporté aboli. Nos soldats revenaient tout juste des opérations de nettoiement au Rwanda. Nous avons été déployés en Croatie. Plus tard, nous avons été déployés à deux reprises en Bosnie. Nous avons également apporté notre aide aux autorités civiles, lors de l'inondation de la rivière Rouge au Manitoba et lors de la tempête de verglas dans l'est du Canada. Nous avons déployé une équipe d'intervention en cas de catastrophe en Turquie et à la suite d'un séisme, et au Honduras après l'ouragan Mitch. Enfin, nous avons été déployés au Kosovo pour nous occuper d'une autre crise de réfugiés. À un certain moment, j'ai été affecté aux forces américaines pour lesquelles j'ai occupé le poste d'aumônier à Fort Sherman, dans la zone du canal de Panama, dans le cadre d'un cours de formation sur les opérations dans la jungle.
Ce n'est là qu'une énumération de déploiements extraordinaires. Je n'ai rien dit du cycle d'instruction habituel des forces canadiennes dans le cadre duquel les soldats doivent s'éloigner de leur domicile pendant des périodes prolongées. Toutes ces activités et opérations ont affecté la famille des militaires. En tant qu'aumônier, j'offre quotidiennement mon aide, des conseils et de la thérapie aux militaires, à leurs conjoints et à leurs familles, qui éclatent sous la pression.
L'alcoolisme, le clavardage, l'infidélité, la violence conjugale, les difficultés financières, les démêlés avec la justice, les blessures résultant d'accidents de la route, la dépression, la maladie mentale, les troubles de l'alimentation, le mal du pays, la maladie de membres de la famille immédiate, la mort de membres de la famille immédiate, le syndrome de la Guerre du Golfe, le trouble de stress post-traumatique, le suicide, et la mort des membres du régiment du génie que j'ai accompagné en Bosnie sont des problèmes auxquels j'ai été confronté quotidiennement, jour et nuit.
En mars 2000, j'ai quitté la base épuisé. Huit ans plus tard, je ne suis pas entièrement rétabli. Et je suis revenu dans une famille qui ne me connaissait plus. Ayant subi le rythme frénétique des opérations, la déstructuration des activités quotidiennes de l'équipe de l'aumônerie, le stress constant d'essayer d'être un aidant, la disponibilité 24 heures par jour et 7 jours par semaine et du harcèlement qui a été démontré, je suis devenu l'ombre de l'homme que j'étais en 1994.
Je vous ai présenté un aperçu de la famille militaire, un portrait que le général Dallaire a essayé de nous montrer. Lorsque les responsables du RARM m'ont demandé dans quel programme j'aimerais me recycler, j'ai choisi un programme de formation clinique post-maîtrise en thérapie matrimoniale et familiale. J'ai alors compris qu'auparavant, je n'avais ni la formation ni les compétences nécessaires pour m'acquitter des tâches de conseiller et de thérapeute des familles militaires de la BFC de Petawawa.
Comme je connaissais les conséquences néfastes pour la famille qu'entraîne le retour d'un militaire atteint du trouble de stress post-traumatique, j'ai décidé de participer, à mes frais, à une semaine de formation clinique au Centre national du PSPT de l'Administration des anciens combattants de Palo Alto, en Californie. Ma formation militaire et civil m'a amené à m'intéresser de près à ce trouble particulier. Je n'étais toutefois pas encore prêt à admettre que j'en étais moi-même atteint. Je m'en suis rendu compte plus tard.
Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que thérapeute matrimonial et familial. Les thérapeutes familiaux sont des professionnels de la santé mentale en mesure de traiter les troubles qui frappent couramment les soldats qui rentrent au pays et les anciens combattants.
J'ai reçu une formation supervisée de 500 heures dans un établissement clinique. En fait, les membres de ma discipline bénéficient davantage de supervision dans leur travail clinique que les psychologues, psychiatres et travailleurs sociaux. Le ratio de supervision, soit une heure par tranche de cinq, est inégalé. Je possède l'équivalent d'un doctorat. Depuis mon départ, j'ai reçu une formation supervisée de près de 500 heures en thérapie.
En acquérant cette formation, j'espérais pouvoir réintégrer la famille militaire. Les Forces canadiennes considèrent toutefois les soins de santé mentale pour nos soldats dans l'optique des années 1950; autrement dit, seuls les travailleurs sociaux, les psychologues cliniciens et, bien sûr, les psychiatres, peuvent fournir des services de santé mentale. Il existe une pénurie troublante dans toutes ces spécialités.
Je tiens à ce que vous sachiez que mes collègues sont disposés à offrir des services professionnels de santé mentale aux membres des Forces canadiennes et à leurs familles. La thérapie matrimoniale et familiale est reconnue comme discipline depuis 1942. Les thérapeutes de cette discipline sont les seuls à recevoir une formation axée sur les relations, qui tient compte du principe que tous les problèmes de santé mentale s'inscrivent dans un système de relations et, partant, que tout ce qui afflige l'individu n'est pas sans affliger l'ensemble.
Les thérapeutes matrimoniaux et familiaux sont des professionnels de la santé mentale hautement qualifiés. Ils emploient des méthodes fondées sur l'expérience clinique, c'est-à-dire des méthodes qui ont été étudiées avec minutie et revues par les pairs avant d'avoir été appliquées. Nous sommes en mesure de traiter un large éventail de problèmes de santé mentale, depuis la dépression, le trouble de stress post-traumatique et les traumatismes liés au stress, jusqu'aux ruptures relationnelles et aux maladies mentales comme la schizophrénie. Nous possédons tous au moins une maîtrise et bon nombre d'entre nous avons une formation encore plus poussée. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les autres professionnels de la santé. Les thérapeutes matrimoniaux et familiaux oeuvrent dans des bureaux privés, dans des hôpitaux, au sein d'équipes de santé familiale et d'organismes communautaires. Il y en a partout. De plus, ils possèdent plusieurs cordes à leur arc. Ils peuvent tirer leur formation et leur expérience initiale de n'importe quelle profession d'aide. J'ai tiré les miennes de la prêtrise. Notre profession est étroitement réglementée par l'American Association for Marriage and Family Therapy. De plus, nous devons posséder des compétences de base très étendues.
Après cinq autres années de formation supérieure, je ne suis toujours pas reconnu comme thérapeute pleinement compétent pour accomplir tout ce qu'on attend de moi comme aumônier, et cela est frustrant au plus haut point. Je n'ai pas réussi à me faire embaucher pour aider nos soldats dans des cliniques de santé mentale.
Les thérapeutes matrimoniaux et familiaux sont légalement reconnus aux États-Unis. Nous sommes également reconnus par le Département de la Défense et la Veterans Administration des États-Unis. Le Département de la Défense vient d'ouvrir 44 postes de thérapeutes matrimoniaux et familiaux aux États-Unis au cours des derniers mois. En fait, on m'a demandé la semaine dernière de me joindre à la Mental Health Clinic à Fort Drum, situé à quelques heures seulement au sud de la ville de New York. Je peux vous dire que j'aimerais beaucoup plus faire un trajet de 45 minutes pour me rendre à la base de Petawawa que parcourir 4 heures pour me rendre à Fort Drum pour y faire le même travail.
Je suis ici aujourd'hui comme personne ayant grandi dans un logement résidentiel du MDN où j'en ai fait voir de toutes les couleurs à mes parents et comme aumônier retraité qui s'est bien torturé les méninges pour savoir ce qu'il pouvait faire pour aider les membres des forces, les anciens combattants et leurs proches. Je suis également ici à titre de personne également atteinte du syndrome de stress post-traumatique.
C'est comme thérapeute matrimonial et familial que je pourrais aider à résoudre bon nombre des problèmes dont on a discutés aujourd'hui. Les thérapeutes matrimoniaux et familiaux sont des professionnels hautement qualifiés qui représentent ce que le secteur de la santé mentale a de mieux à offrir.
Ma présence ici aujourd'hui est accréditée par le Canadian Registry of Marriage and Family Therapists. Nous comptons plus de 1 000 membres inscrits au Canada et je sais que nombre d'entre eux voudraient travailler auprès des militaires canadiens.
Je recommande que le ministère de la Défense nationale adopte une politique d'embauche de thérapeutes matrimoniaux et familiaux agréés qui travailleraient comme psychothérapeutes dans les cliniques de santé mentale, de TSPT et de traumatismes liés au stress. Je recommande que le MDN noue des liens avec le RMFT canadien et ses centres de formation afin que les prestataires des soins de santé aux militaires puissent être formés comme thérapeutes matrimoniaux et familiaux pour mieux venir en aide aux militaires et à leurs proches. De plus, les postes du secteur de santé mentale pourraient également être comblés par des diplômés de ces centres.
Tout ce que je veux, c'est que nos soldats qui souffrent du TSPT et de traumatismes liés au stress obtiennent les meilleurs traitements possibles. C'est ce qui m'a poussé à me renseigner sur la meilleure formation qu'on puisse acquérir pour venir en aide à nos soldats, nos anciens combattants et leurs proches. J'en suis tellement convaincu que je serai heureux de servir d'intermédiaire entre le personnel de la Défense et des Anciens combattants et les principaux acteurs du secteur des thérapeutes matrimoniaux et familiaux.
Enfin, je voudrais viser l'objectif qui consiste à veiller à ce qu'il y ait des thérapeutes matrimoniaux et familiaux agréés dans toutes les bases et tous les centres régionaux d'anciens combattants, car cela comblerait une lacune qui existe à peu près partout aujourd'hui.
Je vous remercie de votre attention et de m'avoir invité à prendre la parole devant vous aujourd'hui.