NDDN Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
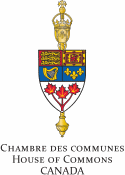
Comité permanent de la défense nationale
|
l |
|
l |
|
TÉMOIGNAGES
Le lundi 29 avril 2013
[Enregistrement électronique]
[Traduction]
Bonjour. La séance est ouverte. Bienvenue à la 77e réunion du comité. Nous poursuivons notre étude sur les soins offerts aux membres des Forces canadiennes malades ou blessés.
Pour la première heure, nous accueillons le major Ray Wiss des Services de santé des Forces canadiennes. Je crois qu'un grand nombre d'entre nous connaissent bien le major Wiss en tant qu'auteur, mais il est aussi urgentologue à Sudbury et réserviste.
En 2008, il a reçu la Médaille de la paix du YMCA et le Prix de reconnaissance pour services exceptionnels de l'Association médicale de l'Ontario. En 2010, il a reçu le Prix Paul Harris du Rotary Club. On l'a choisi comme conférencier principal à l'Emergency Medicine Update du North York General Hospital. Il est l'un de nos meilleurs urgentologues et il a participé à plusieurs conférences pour parler de ses livres, FOB DOC et A Line in the Sand, que plusieurs d'entre vous ont déjà lus.
J'aimerais vous souhaiter la bienvenue au comité, major Wiss, et vous remercier pour les services que vous rendez au Canada. Nous voulons aussi vous remercier de partager les histoires que vous avez écrites dans vos livres. Nous vous avons invité à comparaître pour que vous nous parliez, entre autres, de votre expérience en Afghanistan et, plus important encore, que vous nous expliquiez comment on gère les événements traumatisants aux premières lignes.
Cela dit, je vous invite à livrer votre exposé.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du comité, je vous remercie de m'avoir invité à comparaître. C'est vraiment un honneur d'être ici.
Je vais vous parler de mon expérience en tant que médecin sur une base d'opérations avancées. Pendant que j'étais là-bas, comme vous le savez, je pratiquais une médecine atypique. En effet, j'ai passé presque tout mon temps dans la zone de combat, un endroit où les médecins ne se rendent pratiquement jamais.
J'ai travaillé dans des bases d'opérations avancées où les conditions de vie sont plutôt spartiates et dangereuses. Nos BOA ont subi de nombreuses attaques — notamment celle-ci, la BOA la plus attaquée de l'Afghanistan. Elle a d'ailleurs battu un record en subissant 19 attaques à la roquette dans une période de 24 heures.
C'est l'équivalent militaire d'un camion de 18 roues. Cela vous donne une idée de la force de l'explosion de ces roquettes lorsqu'elles atteignent leur cible. Les éclats d'obus, les fragments métalliques qui sont projetés par l'explosion, sont mortels à une distance bien plus grande.
Dans ce coin de la photo, il y a ce qu'on appelle une douche en conserve. Il s'agit d'un conteneur maritime équipé d'un chauffe-eau et de quelques cabines de douche à l'intérieur. Lorsque la roquette l'a atteint, deux des éclats d'obus sont passés au travers des couches multiples de métal autour de cette douche et ont décapité un soldat afghan qui prenait sa douche, le tuant sur le coup.
À cause de cela, un grand nombre de soldats canadiens qui étaient en service à cette BOA refusaient de prendre leur douche dans cette cabine. Pourtant, je veillais à toujours utiliser cette douche, car je me disais que le risque qu'une autre personne soit tuée exactement au même endroit était très faible.
Voici les gens qui ont mené cette attaque. Ce sont des soldats talibans avec leurs armes préférées. Tout d'abord, voici un fusil d'assaut AK-47.
Je dois vous avertir qu'à partir de maintenant, je vous montre ce à quoi ressemble le travail d'un médecin en temps de guerre; certaines de ces photos sont donc assez explicites.
Voici une plaie d'entrée où une balle d'AK-47 est entrée dans le corps. Ces cartouches très puissantes créent des plaies de sortie qui sont beaucoup plus importantes, car la balle sort du corps en causant énormément de dommages, des dommages probablement mortels s'il s'agit de la poitrine ou de l'abdomen.
Voici une plaie de sortie dans un bras, où l'os et la chair ont explosé. Si vous regardez à l'intérieur, vous pouvez voir que les os, et probablement les nerfs et les vaisseaux sanguins, ont été détruits. Il serait très difficile de sauver ce membre.
L'autre arme préférée des talibans est la grenade propulsée par fusée. Il s'agit d'un petit missile. Elle a une portée d'environ 800 mètres, et un petit moteur-fusée juste ici. Elle provoque une explosion assez puissante, et remplit l'air de petits éclats d'obus, comme ceux qui ont touché ce soldat canadien sur cette photo. Il était en service dans cette BOA juste à la limite du désert, dans cette tour de contrôle, se tenant presque exactement où je me tiens, et s'occupait de la mitrailleuse légère, comme nous le faisions tous à notre tour pour défendre les voies d'accès à la BOA. Avant, il y avait une poutre ici. La grenade propulsée par fusée est arrivée, a explosé ici, et le soldat a reçu une pluie d'éclats d'obus.
La première chose à faire lorsqu'on soigne un patient, c'est de ne pas se blesser. Si vous regardez sa poitrine, surtout ici, dans le carré mortel — c'est-à-dire où se trouvent le coeur et les grosses artères qui peuvent vous vider de votre sang en une minute si vous êtes touché —, il n'a aucune marque, car il porte non seulement sa veste en Kevlar, mais aussi, juste ici, il y a des plaques en métal pare-balles, en avant et en arrière, qui peuvent arrêter une cartouche d'AK-47.
Vous pouvez aussi remarquer qu'il n'a aucune blessure aux yeux ou au-dessus, car il porte non seulement son casque, mais aussi ses lunettes de protection balistique. Ce sont des lunettes en plastique rigide qui empêchent les fragments d'obus d'atteindre les yeux, qui sont très vulnérables.
Vous devez comprendre qu'il s'agit d'armes à tir direct. Il faut voir la personne qu'on essaie de tuer pour les utiliser. Il s'agit donc d'un combat armé, et les Canadiens ne meurent pas dans les combats armés, car nous sommes de bien meilleurs soldats que les talibans. Si vous examinez les mois pendant lesquels les batailles ont fait rage en Afghanistan, à Kandahar, sur plus de 120 décès au combat, seulement 8 décès sont attribuables à un tir direct des talibans.
Dans ce cas, qu'est-ce qui a tué nos soldats? Eh bien, voici ce qui nous tue: c'est ce qui reste d'une motocyclette après que l'auteur d'un attentat-suicide à la bombe se soit fait exploser à côté d'un véhicule militaire afghan. Vous pouvez voir les fragments d'obus qui sont passés à travers le véhicule comme une pluie de balles mortelles.
Ce qui est encore plus redoutable, c'est l'attentat-suicide aux véhicules piégés remplis d'explosifs. Voici un site d'essai ici au Canada. Vous pouvez voir sur ce véhicule d'essai le mannequin qui représente le chef de char et celui qui représente la sentinelle. Lorsque cela se produit — cette explosion —, comme vous pouvez l'imaginer, tous ceux dont la poitrine et la tête sont à l'extérieur du véhicule ne s'en sortiront pas très bien.
C'est ce qui fait le plus peur en Afghanistan — ce n'est pas de se faire tirer dessus, mais de conduire sur les routes de la province de Kandahar. C'est ce qui nous a tués: les EEI ou les bombes en bordure de routes. C'est vraiment la guerre avec une technologie rudimentaire.
Parfois, nous avons été chanceux, mais parfois, cela n'a pas été le cas. Voici une autre photo prise sur le site d'essai au Canada. Comme vous pouvez l'imaginer, si la brèche dans le blindage est complète, comme vous pouvez le voir ici, personne ne survivra à ce type d'explosion. Toutefois, même si la brèche est seulement partielle, nos soldats auront de gros problèmes.
En effet, de façon paradoxale, le blindage qui les protégeait tellement bien une seconde auparavant se retourne maintenant contre eux, car il retient la force de l'explosion à l'intérieur du véhicule. Cela cause une surpression qui peut être mortelle. Cela peut créer des situations assez troublantes, car les soldats qui sont morts en raison d'une pression trop élevée n'ont aucune marque sur le corps.
Il peut être très difficile d'expliquer aux jeunes soldats que leur ami est réellement décédé, que malgré son expression paisible, ses organes ont été réduits en bouillie.
Les blessures peuvent être graves même si le blindage n'est pas percé et qu'il est seulement gauchi. Le plancher du véhicule blindé se soulève très rapidement dans le compartiment de l'équipage; c'est comme si le soldat avait sauté du balcon d'un troisième ou quatrième étage. Donc, même si les blessures en surface ne semblent pas très graves, les radiographies montrent que les os sont fracassés et que les nerfs et les vaisseaux sanguins sont déchirés. Le membre touché est très difficile à sauver, et l'amputation est souvent la seule option.
Il n'est pas facile de voir des blessures aux membres, mais les blessures les plus horribles sont de loin celles au visage. Même le personnel médical qualifié a beaucoup de difficulté à les regarder. En fait, elles ne sont pas toutes mortelles. Seulement 5 % des patients qui respirent encore meurent d'un traumatisme à la tête et au cou. Par contre, si la trachée est atteinte, les cas de décès sont sept fois plus importants.
Ce soldat est encore vivant grâce à une intervention qui consiste à faire une incision dans le cou pour y placer un tube qui se rend jusqu'aux poumons, lui permettant ainsi de respirer en contournant le visage abîmé.
En 20 ans de médecine d'urgence au Canada, j'ai pratiqué cette intervention trois fois, tandis qu'au cours de ma première période de service, un de mes techniciens l'a pratiquée trois fois en six mois. Il a fait un si bon travail que le colonel Tien, dont vous avez entendu parler il y a quelques semaines, a écrit un article sur lui dans le Journal of Trauma ainsi que sur la qualité de la formation que reçoivent nos techniciens médicaux.
Certaines personnes expriment leur surprise et parfois même leur désaccord quand il voit un docteur armé jusqu'aux dents, mais dans la zone de combat, je suis d'abord soldat. Notre travail, à moi et à mes techniciens, est de contribuer au succès du combat dès les premiers coups de feu. Ce n'est pas logique d'abandonner nos armes et d'ouvrir une brèche dans nos défenses.
Aussitôt que l'ennemi se replie, nous nous mettons à l'abri pour nous occuper des blessés, particulièrement à la base d'un de ces murs de briques crues, qui peuvent arrêter les balles comme du béton. C'est parfois difficile à faire quand un projectile comme celui-ci passe juste par-dessus nos têtes. Je vous invite à jeter un coup d'oeil ici au coin supérieur droit.
[Présentation audiovisuelle]
Maj Ray Wiss: Donc, oui, une grenade propulsée par fusée ressemble à cette lumière rouge vif quand elle passe par-dessus votre tête.
Il est difficile de donner des soins médicaux dans ces circonstances. C'est poussiéreux, bruyant, sale et angoissant. C'est aussi un peu déroutant, parce qu'une fois que le soldat blessé est rafistolé, un jeune technicien qui vous accompagne tente immédiatement de filmer l'échange de feu pour l'afficher sur sa page Facebook. C'est un trait caractéristique de leur génération que je ne comprendrai jamais tout à fait.
Si c'était possible, je préférerais de loin prodiguer des soins dans mon ambulance blindée, le Bison, qui a tout ce qu'on retrouve dans une ambulance au Canada. Il serait encore mieux de pouvoir m'occuper des blessés à la BOA, où j'ai tout ce qu'il me faut pour les soigner dans la demi-heure suivant un traumatisme. Mon ambulance les amène ensuite à l'hôpital de rôle 3 où ils reçoivent des soins exceptionnels.
À titre informatif, il ne s'agit pas ici d'un écrasement d'hélicoptère. C'est plutôt un hélicoptère qui se pose pour évacuer au plus vite les blessés du champ de bataille. C'est dire à quel point nous avons de bons pilotes et de bons appareils de nos jours.
Vous avez un peu entendu parler de mon travail avec les ultrasons en médecine d'urgence au Canada. J'ai apporté mon appareil avec moi lors de ma première affectation. Pendant ma deuxième période de service, j'ai convaincu une entreprise spécialisée dans le domaine de nous prêter sans frais des appareils pour chacune des BOA pour que nous puissions les utiliser pendant la durée de mon séjour.
Je dois dire que je ne suis pas tout à fait du même avis que le colonel Tien à ce sujet. J'ai enseigné la technique à mon personnel médical de première ligne, et je suis maintenant convaincu qu'avec une formation courte et ciblée, quoiqu'intensive, ils pourraient apprendre à s'en servir plutôt bien.
C'est le message clé que je vous voulais vous transmettre dans le cadre de cette présentation. Ces jeunes techniciens médicaux de combat de 28, 26, 24 et 22 ans sont extrêmement qualifiés. La formation qui leur est offerte de nos jours dans les Forces canadiennes est extraordinaire.
Je veux vous montrer quelque chose. Voici ce qui se produit lorsque trois Canadiens grièvement blessés arrivent en même temps dans une BOA. Même si vous ne connaissez pas la médecine et que vous ne parlez pas anglais, je pense que vous conviendrez que ce médecin et la demi-douzaine de techniciens accomplissent leur travail avec calme et professionnalisme.
[Présentation audiovisuelle]
Maj Ray Wiss: Pour faire face aux particularités des traumatismes subis, ces jeunes techniciens m'ont assisté aussi bien que les infirmières beaucoup plus expérimentées avec lesquelles je travaille dans un centre de traumatologie de niveau 1 au Canada.
Seul leur courage m'a plus impressionné que leurs compétences.
Il s'agit là d'un incident que j'ai décrit dans mon deuxième livre. Un technicien a couru sous les tirs ennemis pour se rendre à un blessé. Il s'est rendu compte que le soldat en question avait perdu son casque et il s'est immédiatement servi du sien pour lui protéger la tête. Ces actes de courage ont un prix. Nous avons perdu huit techniciens en Afghanistan, et nous étions déjà peu nombreux lors du déploiement des troupes. Si l'on tient compte de la taille de notre groupe, nous avons eu le plus grand nombre de pertes parmi les groupements tactiques.
Ce technicien et celui que nous venons de voir ont tous les deux travaillé dans ma BOA pendant mes périodes de service. Ce n'était pas seulement des collègues et des compagnons d'armes; c'était des amis. Il y en a deux autres qui venaient comme moi de Sudbury, dans le nord de l'Ontario, y compris ce jeune homme, qui est le dernier à avoir été tué. C'était le fils d'un très bon ami à moi. Je soupais avec son père quand il est mort.
Quand vous raconterez l'histoire des Services de santé des Forces canadiennes en Afghanistan, n'oubliez donc pas de dire que les techniciens se rendaient jusqu'à leurs patients ou qu'ils mourraient en essayant. Nous nous souviendrons d'eux pour cette raison, et j'espère que le Canada en fera autant.
Merci.
[Applaudissements]
Merci beaucoup, major. Nous avons parfois besoin d'être ainsi confrontés à la réalité pour prendre position lorsque nous abordons un sujet aussi sérieux.
Compte tenu du temps dont nous disposons, car nous n'avons qu'une heure avec le major Wiss, je propose de nous en tenir à des tours de questions de cinq minutes. Cela dit, vous avez la parole, monsieur Harris.
Merci, monsieur le président.
Merci, major, et docteur — il faut vous donner les deux titres. C'était une présentation très émouvante. Certains d'entre nous se sont rendus sur place et reconnaissent le terrain. Nous n'avons toutefois pas vécu le même genre de traumatisme que vous. Je ne savais pas qu'autant de techniciens avaient perdu la vie, et je suis surpris de l'apprendre. Je ne pense pas que beaucoup de personnes soient au courant. Nous imaginons généralement les membres du personnel médical en train de soigner les victimes de traumatisme qu'on leur amène, et nous ne pensons pas qu'ils peuvent en fait eux-mêmes être blessés ou tués. Nous vous remercions de nous en avoir informés. Il est certainement important de se rappeler que les techniciens médicaux ont eux aussi risqué leur vie ou été tués en servant leur pays. Nous vous remercions d'avoir servi le Canada.
Bien entendu, presque tout ce que nous savons sur les services de traumatologie en temps de guerre provient de la série télévisée M*A*S*H* qui date à peu près des années 1970. Il est donc bon de voir ce qu'il en est vraiment dans un contexte différent.
J'admire la présence d'esprit dont vous et votre groupe avez fait preuve pour soigner en même temps trois victimes de traumatisme. Comme vous l'avez dit, cela démontre une attitude très professionnelle. Merci encore de nous avoir montré ces images.
Je veux vous féliciter, ainsi que votre groupe, évidemment, d'avoir reçu le prix spécial de l'OTAN remis à une unité médicale multinationale de rôle 3 à Kandahar. J'ai parcouru votre livre, et je vous remercie de l'avoir écrit et d'informer les Canadiens d'une manière très spéciale de la situation telle qu'elle est vraiment.
Je pense que tous les membres du comité conviennent — nous n'avons pas de raison de croire le contraire — que les soins prodigués aux victimes de traumatisme dans la zone de combat ou ailleurs dans le cadre des opérations étaient incomparables, comme en témoignent de toute évidence les prix reçus.
Nous sommes ici pour mener une étude sur les soins offerts aux soldats malades ou blessés. Les soins primaires étaient sans nul doute excellents. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous entendons au sujet des soins post-traumatiques, qu'il soit question de stress post-traumatique ou autres. Quelqu'un nous a dit qu'il avait reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique à la base des forces aériennes de Kandahar. On lui a donné un congé de deux mois et un billet d'avion, ce qui est incompréhensible. Il est revenu chez lui dans un avion civil, sans soutien ni congé de décompression, ce qui est d'autant plus étonnant.
Comme tout le monde, nous avons entendu parler de préoccupations par rapport au stress post-traumatique et au niveau de traitement offert aux personnes qui en souffrent. Certains s'inquiètent également du montant d'aide financière qui est accordée conformément à la Nouvelle Charte des anciens combattants et d'autres questions similaires.
Ce n'est peut-être pas votre domaine, mais vous travaillez encore dans un hôpital civil et vous y voyez des anciens combattants. Avez-vous des commentaires ou des suggestions par rapport à ce qui est arrivé à nos soldats à leur retour d'Afghanistan?
Oui, bien sûr.
Comme vous l'avez dit, je travaille encore de très près avec nos blessés. J'ai d'ailleurs tendance à devenir le médecin personnel de ceux qui viennent dans ma région, dont Bill Kerr, qui est le seul triple amputé de la mission, et certains autres qui ont subi de graves blessures sur le plan émotionnel et physique.
J'ai deux messages importants à transmettre à votre comité. Le premier est que chaque nation membre de l'OTAN, et par le fait même, toutes les nations selon moi, reconnaissent que nous offrons les meilleurs traitements en santé mentale au monde. Vous devez être très prudent quand vous parlez de catastrophes au sein d'un système donné. En effet, il y a un réel danger quand on dit que des personnes atteintes de TSPT sont tombées dans l'oubli — même s'il y en a sûrement quelques-unes, ce qui est inévitable dans un système aussi vaste. Il doit y avoir un certain équilibre, car d'autres personnes ayant le même problème risquent autrement de ne pas demander de soins et de ne pas bénéficier des ressources considérables qui sont offertes ni du savoir-faire de gens très qualifiés et attentionnés qui travaillent dans le domaine. C'est un message très important qui doit être entendu. Il doit y avoir un équilibre dans ce qu'on dit sur notre façon de traiter le TSPT. Il ne faut pas toujours parler des histoires d'horreur de certaines personnes, dont il faut également s'occuper. Toutes les autres nations, y compris les États-Unis — qui disposent de ressources considérables —, essaient d'apprendre de ce que nous faisons dans le domaine de la santé mentale.
À propos de la Charte, j'ai déjà remis un mémoire sur la question, et je suppose que, avec raison, le sujet donne du fil à retordre au gouvernement. La Charte a été mise en oeuvre pour donner suite à de nombreuses préoccupations d'anciens combattants, ce qu'elle a permis de faire de manière plutôt admirable. Cela dit, ceux qui se sont penchés sur la question avaient le regard tourné vers le passé, comme leurs prédécesseurs des 50 dernières années. Ils avaient en tête le très grand nombre d'anciens combattants qui avancent en âge, et ils ont bien défendu leurs intérêts.
Comme vous le savez probablement, ma vie a été quelque peu chaotique ces derniers temps, et c'est seulement au cours des derniers jours que j'ai pu préparer ma présentation. Je me rends compte maintenant que j'ai oublié ce que je tenais le plus à dire. Comme je l'ai mentionné, l'entrée en vigueur de la Charte a permis de répondre convenablement aux besoins de la plupart des anciens combattants, mais quand elle a été rédigée, personne ne pouvait s'attendre à ce que les Services de santé des Forces canadiennes deviennent aussi efficaces. Si la guerre en Afghanistan avait eu lieu 10 ans plus tôt, il y aurait eu trois fois plus de décès et beaucoup moins de blessures graves. C'est justement à cause de la formation que nos techniciens ont reçue que de nombreux soldats qui auraient perdu la vie dans des conflits précédents ont plutôt frôlé la mort. Ils ont survécu, mais ils sont horriblement mutilés, et beaucoup plus nombreux que nous le pensions. Les restrictions de la Charte en matière de prestations peuvent nuire à la santé et au bien-être à long terme de ce petit groupe de soldats.
Dans mon mémoire, j'ai brièvement expliqué pourquoi des prestations additionnelles devraient être considérées pour ces soldats, mais j'ai oublié de mentionner qu'elles seraient très avantageuses pour le gouvernement.
En tant que médecin militaire, je suis un multiplicateur de force. Cela veut dire que nos soldats combattent plus fort quand je suis là parce qu'ils savent qu'on s'occupera bien d'eux s'ils sont touchés par l'ennemi. Tous les commandants d'équipe de combat dont j'ai suivi les ordres m'ont dit que j'avais beaucoup d'impact sur le moral. Dans les faits, vous pouvez également être des multiplicateurs de force. Comme Napoléon l'a dit, le moral des troupes est trois fois plus important que leur équipement. Vous voulez que vos forces armées fassent preuve d'efficacité opérationnelle. Soutenez les soldats blessés et votre investissement sera 10 fois plus rentable.
Merci, monsieur, pour votre exposé. J'ai lu vos deux livres. Ils expliquent admirablement bien, non seulement vos réalisations, mais aussi les raisons de notre présence et du rôle important que chacun a joué, tout comme dans d'autres guerres plus célèbres. Les Canadiens connaissent en effet beaucoup mieux la Première et la Seconde Guerre mondiale, et je vous remercie de leur avoir expliqué ce qui s'était passé en Bosnie, par exemple. Je vous remercie également de vous être porté volontaire, tout comme ceux de la grande génération qui s'étaient sentis appelés. Nous vous en remercions.
J'aimerais vous parler d'un incident abordé dans votre livre. Vous avez dit que certains techniciens payaient jusqu'à 600 $ de leur poche pour s'acheter un meilleur sac à dos afin d'aider les victimes sur le terrain. L'équipement qu'on leur fournissait gratuitement était inadéquat. Ils dépensaient donc leur propre argent pour compléter leur trousse.
Selon vous, est-ce que le problème a été réglé?
D'immenses progrès ont été faits. Après la publication du livre, la question a été portée à l'attention du général Natynczyk. Il a fait comprendre aux techniciens qu'il ne pouvait pas acheter à chacun un équipement différent, mais il a pu faire un compromis, et trouver de l'équipement plus adéquat. Les techniciens sont individualistes. Ils veulent tous un petit quelque chose bien à eux. Mais l'équipement qui est fourni aujourd'hui répond beaucoup mieux à leurs besoins.
Félicitations pour cette aide on ne peut plus concrète.
Vous avez également mis à disposition votre expertise en matière d'ultrasons. Lorsque nous sommes allés à Downsview l'année dernière, nous avons compris leur importance sur le champ de bataille.
J'ai déjà posé cette question, et vous en avez parlé brièvement. Quand pourrons-nous offrir systématiquement aux techniciens cet outil, qui n'aurait peut-être pas été utilisé de cette façon sans l'intervention d'un expert international comme vous en la matière? Pouvez-vous d'ailleurs élaborer davantage sur son utilisation sur les champs de bataille?
Oui, certainement.
J'enseigne l'utilisation des ultrasons aux débutants. C'est mon domaine d'expertise à l'échelle internationale. J'ai appris à 8 000 médecins canadiens à s'en servir; ils n'avaient jamais utilisé une sonde à ultrasons auparavant. Dans la médecine d'urgence d'aujourd'hui, si vous n'utilisez pas les ultrasons au quotidien, vous êtes comme un dinosaure en voie d'extinction.
Donc oui, c'est faisable. Parmi les 8 000 médecins que j'ai formés, certains apprenaient très lentement et étaient beaucoup moins alertes que mes techniciens. Oui, ils peuvent les utiliser.
J'ai été à Downsview et je peux vous dire que l'équipement nécessaire se trouve sur le marché. Il existe un appareil plus petit qu'un pichet d'eau, qui permet de détecter un pneumothorax, une hémorragie thoracique, dans l'abdomen ou autour du coeur, de façon très efficace, en quelques secondes. Je peux montrer à un technicien comment l'utiliser en 10 heures. La technologie est donc disponible.
Rien ne les retient vraiment. J'ai enseigné à tous les techniciens des forces spéciales comment utiliser les ultrasons, et je sais que le Commandement des Forces d'opérations spéciales du Canada a acheté 16 ou 17 appareils tout récemment. On les utilise de plus en plus. La médecine d'urgence évolue toujours dans ce domaine, et je crois que l'armée suit cette évolution de près.
Vous avez été déployé en Afghanistan à deux reprises. Pouvez-vous nous parler des leçons apprises qui ont été appliquées rapidement? A-t-on apporté des améliorations marquées aux soins de première ligne entre vos deux déploiements?
Oui, d'énormes améliorations. Lors de ma première période de service, ma base d'opérations avancée n'était pas conçue pour les médecins. Je ne pouvais donc pas faire beaucoup plus que les techniciens. J'ai fait un certain nombre de recommandations à la fin de cette période, et elles ont toutes été mises en oeuvre. Lorsque j'y suis retourné une deuxième fois, c'était comme si je travaillais dans un centre de traumatologie de niveau 1. Je pouvais tout faire, comme si j'étais chez moi.
Merci, monsieur le président.
Merci, monsieur Wiss, pour votre service.
Dans votre exposé, vous avez dit qu'il y avait peu de médecins sur la base d'opérations avancée. Pourquoi?
Les raisons de ma présence permettront de répondre à la question. C'était en fait un concours de circonstances. On m'a envoyé là lors d'une rotation francophone. Je suis Canadien français, et ancien officier d'infanterie. Au cours des cinq années précédant mon déploiement, j'étais médecin de l'équipe d'intervention spéciale, ou unité tactique, de notre service de police. J'ai retrouvé bon nombre de mes réflexes d'infanterie. Je pouvais viser juste, faire des mouvements tactiques, j'étais différent des autres médecins. Lorsqu'il manquait un technicien principal, qu'on appelle un auxiliaire médical, sur une base d'opérations avancée, on me demandait d'y aller, surtout parce que j'étais francophone. Beaucoup de techniciens principaux francophones sont appelés à faire les rotations anglophones, puisqu'ils parlent les deux langues; l'inverse n'est pas vrai. C'était plus difficile de trouver des gens pour faire les rotations francophones.
Eh bien, je pouvais tirer juste, oui, et on m'a demandé si je voulais faire le travail; j'ai accepté.
Croyez-vous que la présence d'un médecin sur une base d'opérations avancée — et je présume que la réponse est oui — permet de réduire le nombre de pertes?
Pas de façon importante, non. La formation offerte par les Forces canadiennes à tous les techniciens, dont les auxiliaires médicaux, est extraordinaire. Un spécialiste de la médecine d'urgence comme moi rehausse un peu le niveau, mais à peine. Les techniciens principaux des Forces canadiennes peuvent réaliser les mêmes tâches que moi dans ces situations. Je peux en faire un peu plus, mais pas beaucoup.
J'aimerais aborder l'ironie de la Charte des anciens combattants, fondée sur le modèle de la Seconde Guerre mondiale qui présentait beaucoup plus de soldats morts que blessés. Mais, grâce à vos efforts et à ceux de vos collègues, cette tendance a été renversée. Il y a beaucoup plus de soldats blessés, et moins de décès, mais la Charte n'a pas été modifiée en conséquence, puisque les indemnités versées aux soldats sont plutôt modestes dans les circonstances.
Comment pourrait-on régler le problème, de sorte que le système d'indemnisation soit adapté aux avancées médicales?
Je dois d'abord vous corriger, puisque toutes les guerres du XXe siècle ont entraîné beaucoup plus de blessures que de décès. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on retire certaines personnes du groupe des décès. Il y a un groupe de personnes gravement blessées — très petit —, quelques centaines de personnes déployées en Afghanistan, qui sont mal desservies par la Charte. C'est tout.
Ce qui est ironique, c'est que les personnes blessées avant l'entrée en vigueur de la Charte ont une pension tout à fait convenable. Comme je le dis dans mes observations écrites, c'était probablement la bonne façon de faire. Il faudrait revenir aux mêmes conditions qu'au début de la mission de combat.
En ce qui concerne le trouble de stress post-traumatique, nous entendrons après vous un témoin selon lequel le taux de suicide des soldats est égal à celui du reste de la population canadienne, et même inférieur. Selon son argument, les personnes qui auraient des tendances suicidaires seraient écartées d'emblée, ce qui semble paradoxal.
Que savez-vous de la situation des soldats après leur libération? Le trouble de stress post-traumatique et les idées suicidaires peuvent s'intensifier après la libération. J'aimerais entendre vos observations anecdotiques ou statistiques à ce sujet.
Eh bien, vous êtes dans une position unique pour observer les soldats après leur libération. J'aimerais donc entendre vos observations sur la façon dont les idées suicidaires et le trouble de stress post-traumatique se manifestent, disons sur cinq ans.
D'accord, je comprends.
On franchit tout juste aujourd'hui la barre des cinq ans. J'aimerais d'abord vous donner des statistiques de base sur le trouble de stress post-traumatique et cet ensemble de maladies. Nous savons que parmi toutes les personnes déployées en Afghanistan, 6 % développeront des problèmes de santé mentale. Nous savons que 2 % d'entre eux, soit le tiers, n'auront pas besoin de traitement; 2 % verront leur condition améliorée grâce au traitement et 2 % auront probablement des problèmes à long terme. Je tiens à souligner que nous avons le meilleur système de santé mentale postdéploiement au monde; il faut avoir accès à ces 2 % qui peuvent tirer profit d'un traitement. Il faut les aider rapidement. Il faut avoir accès tout aussi rapidement aux 2 % qui auront des problèmes à long terme, pour minimiser les conséquences de leur maladie.
Dans les faits, 94 % des personnes déployées s'en sortent, c'est ce que je constate, de façon anecdotique. Ici, à Sudbury, mon unité de réserve déploie chaque année des dizaines de personnes en Afghanistan. Je leur parle régulièrement, et la plupart d'entre eux s'en sortent très bien. C'est la réalité.
Merci, monsieur le président. Et merci à vous, monsieur Wiss, d'être ici aujourd'hui.
Votre expérience en tant que soldat de l'infanterie est très riche.
L'infanterie, et non le génie, est la reine des batailles.
Il fallait que je le dise. C'est une bataille de longue date.
Dans votre livre, vous parlez de la réaction de stress de combat. Cela m'intéresse. Selon vous, la meilleure façon de la traiter, c'est au front. D'autres témoins ont toutefois dit le contraire, notamment au sujet du trouble de stress post-traumatique.
Pouvez-vous élaborer et nous donner quelques éclaircissements à ce sujet?
Bien sûr.
Songez que le soldat — un jeune homme dans la fleur de l'âge — s'entraîne pendant une grande partie de sa vie professionnelle, voire toute sa vie, pour ce travail. S'il échoue sa mission, la perte d'estime de soi est dévastatrice. Plus ce sentiment demeure, plus il est difficile de retrouver cette estime, et plus on se dirige vers la dépression et les idées suicidaires.
Notre expérience des guerres le prouve. Pour qu'un soldat retrouve un équilibre émotionnel, il faut intervenir le plus tôt possible, aux premières lignes. Les Forces canadiennes sont aussi les meilleures dans ce domaine.
Nous avons envoyé des travailleurs sociaux et des psychologues sur les bases d'opérations avancées. C'était quelque chose à voir. Ces gens n'avaient aucune expérience de l'instruction au combat, et on les déposait sur la base en hélicoptère, pour qu'ils puissent aider des soldats qui venaient de voir leurs collègues mourir. On envoyait donc des professionnels de la santé mentale sur le terrain avec nous, pour parler de ce qui se passait.
C'est la bonne méthode. Si on les ramène au pays pendant deux mois, ils ne feront que penser aux collègues qu'ils ont laissés derrière. La plus importante motivation d'un soldat combattant, ce sont les collègues. Il ne veut pas les décevoir. C'est beaucoup plus important pour lui qu'un idéal abstrait comme la démocratie, que la haine de l'ennemi et que l'estime de soi. S'il est ramené au pays, il ne pensera qu'à ses amis qui sont toujours au combat alors que lui n'y est plus. C'est catastrophique pour le moral. Pour les aider, il faut intervenir rapidement.
Merci de nous donner votre point de vue. On se bat pour l'humanité, et pour les hommes qui se battent à nos côtés.
Je suis heureux de vous entendre, parce qu'on nous raconte beaucoup d'histoires négatives. Mais, comme vous l'avez dit, d'après vos statistiques, nos traitements donnent de bons résultats.
Je suis ravi de vous entendre dire que le Canada est un leader dans ce domaine.
Le leader dans l'aide aux soldats.
Vous avez traité toutes sortes de blessures lors de vos deux périodes de service en Afghanistan. Quelle est l'utilité de l’équipement de protection? L’équipement qui protège le tronc; le casque et les lunettes de protection balistique qui protègent la tête et les yeux, ce genre de choses.
Les blessures aux extrémités peuvent être terribles. Vous avez dit que les « kill boxes » étaient bien protégées par une plaque de céramique au dos de la veste tactique.
Pouvez-vous nous parler des blessures que vous avez traitées pendant ces deux périodes de service?
Hippocrate, le père de la médecine, a dit que la guerre était la seule véritable école du chirurgien. C’était il y a 2 000 ans, et c’est toujours vrai aujourd’hui. La guerre est la meilleure façon d’apprendre le métier puisque l’éventail des blessures est presque infini, particulièrement aujourd’hui, avec les armes modernes.
Pour répondre à votre question sur l’équipement de protection, il faut atteindre un équilibre entre la puissance de feu, la mobilité et la protection, puis passer à l’action. On prend la meilleure décision possible pour chaque mission, mais on peut se tromper; il est impossible de le savoir à l’avance.
Pour avoir porté l’équipement lors des rondes de surveillance, la veste pare-éclats et la veste tactique par-dessus, je dirais qu’il ne faut pas qu’il soit plus lourd. C’est la limite.
L’équipement est très efficace; le nombre de pertes a diminué.
Depuis cinq ans maintenant, je m’occupe de Bill Kerr, le seul triple amputé au Canada. N’eût été l’équipement qu’il portait, il serait mort. C’est donc une protection très efficace.
C'est très bien.
Selon vous, le système canadien offre-t-il les services dont ont besoin les troupes, pour traiter les blessures physiques, mentales et psychologiques des soldats?
Vous avez dit que nous étions un leader mondial. Croyez-vous que nous avons tous les outils nécessaires pour offrir les meilleurs traitements possibles aux soldats?
Oui, et encore une fois, ceci est un message très important que je veux transmettre au comité. Le système que nous avons est exceptionnel. Avec cette situation des dernières années, ce système a fait de l'excellent travail et, c'est vrai, lorsque des catastrophes se produisent et que les personnes se retrouvent en situation précaire, il faut faire preuve de doigté quand vient le temps de les aider.
Je présume que nous pourrions être plus efficaces dans notre façon de les épauler, mais ce qui importe encore plus, c'est de faire savoir au monde que la vaste majorité des personnes qui ont des problèmes physiques ou mentaux reçoivent de bons soins. Si vous avez des problèmes de ce type, ne vous laissez pas terrasser. Venez plutôt nous voir.
La raison principale pour laquelle nous n'arrivons pas à joindre les victimes de stress post-traumatique, c'est qu'elles ne se manifestent pas. Cela est plus nuisible que quoi que ce soit d'autre.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Prenons l'exemple de quelqu'un qui travaille comme infirmière aux urgences dans une petite communauté. Dans ce type de communauté, cette personne risque facilement de tomber sur quelqu'un qu'elle connaît bien, voire très bien, et d'être obligée de le soigner. Il faut vivre avec cette réalité. Malgré tout ce qu'on vit, les Forces canadiennes forment quand même une petite famille. Le risque de devoir traiter quelqu'un que l'on connaît est assez grand.
Un peu plus tôt, vous avez montré la photo du caporal Nicolas Beauchamp et celle de son épouse, le caporal Dolores Crampton, qui était aussi adjointe médicale et qui est allée en Afghanistan. C'est d'ailleurs une des personnes avec qui j'ai suivi mon cours médical NQ4. On a passé beaucoup de temps ensemble. C'est un exemple de quelqu'un qui a vécu le décès de son conjoint et qui fait partie du personnel soignant. Qu'avez-vous à mentionner cet égard? Comment prenez-vous en charge les membres du personnel soignant et comment les aidez-vous à faire face au fait qu'il vont probablement, un jour ou l'autre, devoir soigner quelqu'un qu'ils connaissent très bien?
On sait que dans les Forces canadiennes, il est quand même fréquent que les deux conjoints soient tous les deux militaires. Comment aidez-vous les militaires qui ont vécu le décès de leur conjoint?
J'étais à la cérémonie de rapatriement pour le caporal Beauchamp et le caporal Crampton était là également. Par la suite, on vit ce deuil comme celui que je vis maintenant. On fait cela de la même manière.
Une chose est peut-être moins connue. Comment répond-on au fait que nos camarades reviennent blessés? C'était notre pain quotidien à la FOB, la base opérationnelle avancée. En effet, on s'occupait de nos gens. Dans une équipe de combat, le personnel médical n'est pas à part. Il fait vraiment partie de l'équipe de combat. Ces personnes ne faisaient pas partie de l'équipe médicale, mais elles faisaient partie de l'infanterie, des blindés. Quand l'un d'entre nous était touché, c'était extrêmement difficile.
Je me souviens très bien, comme je le décris dans mon premier livre, du sentiment d'angoisse que j'ai ressenti quand je savais qu'une opération d'envergure allait faire en sorte que des blessures importantes seraient infligées à nos membres dans quelques minutes. De plus, c'était mon premier mass call, le premier événement avec beaucoup de blessés. Tout d'abord, cela m'a beaucoup secoué, mais je vous dirais que dans mon cas, alors que j'ai suivi un long entraînement, et dans celui de mes jeunes infirmiers qui ont suivi un entraînement plus court mais quand même superbe, la machine s'est engagée. Quand un blessé arrive, la machine s'engage et on réagit avec un certain automatisme, ce qui est absolument nécessaire dans ces cas.
Néanmoins, lorsqu'on est entraîné à donner des soins, on est souvent capable de le faire quand il y a de l'action. Quand ça ne va pas bien, quand le moniteur cardiaque crie, ça peut aller. Cependant, par la suite, quand la pression retombe, comment pouvez-vous être certains que ces gens vont être capables de prodiguer des soins pendant six mois? Ce sont des situations difficiles, mais ces personnes doivent être capables de continuer à prodiguer des soins et de faire leur travail. Ils se construisent une coquille. On manque de personnel médical. Il faut donc être en mesure de garder ceux qu'on a en santé. On n'apprend pas dans les livres comment réagir et comment faire face au fait qu'il s'agit de personnes qu'on connaît personnellement. Comment ces gens sont-ils soutenus?
Je ne peux pas vous dire comment les choses se passaient dans les autres équipes de combat, mais quand je suis allé en Afghanistan, j'en étais à ma troisième guerre. J'en ai fait deux autres avec Médecins Sans Frontières. J'avais 48 ans quand j'y suis allé la première fois. Je faisais toujours très attention.
L'avantage du système médical en temps de guerre est qu'on n'est pas toujours en opération. À certains moments, il y avait beaucoup de blessés. Par la suite, c'était assez détendu pour un bon moment. Qu'il y ait 10 blessés ou seulement un, je tenais toujours une séance de débreffage avec l'équipe médicale afin de permettre à ces personnes de ventiler et de parler de ce qu'on avait fait. Il y avait certainement un élément éducatif. J'étais très utile comme éducateur en matière de médecine d'urgence. J'avais beaucoup à leur offrir et je m'assurais que, même en faisant de l'éducation, on parle des choses qu'ils avaient trouvées difficiles.
Prenons l'exemple des blessures au visage. C'était très difficile, parce qu'il s'agit de qui nous sommes pour les autres êtres humains. Il est remarquable à quel point les blessures au visage sont difficiles émotionnellement. Quand cela se produisait, je m'assurais de leur en parler et de reconnaître que ces choses étaient difficiles. Cela leur permettait de normaliser, pour utiliser le terme médical, les émotions qu'ils ressentaient.
C'est la chose à faire dans ces situations. Je dirais même qu'on avait beaucoup plus de temps pour faire cela sur le terrain que lorsqu'on se trouve à l'urgence où, après avoir traité un cas, il faut passer à un autre.
[Traduction]
Merci beaucoup, monsieur le président.
Tout d'abord, merci beaucoup, monsieur Wiss, pour tout ce que vous avez fait en Afghanistan. Merci entre autres pour la façon dont vous avez innové et pour avoir fait venir la machine à ultrasons. À cette époque, en 2007, vous étiez en période d'apprentissage. Ils ne s'attendaient pas vraiment à ce qui s'est passé. En 2006, il y avait encore relativement peu de victimes corporelles, mais 2007 en est une que je n'oublierai jamais. Si je me souviens bien, nous avons perdu six de nos camarades durant la semaine de Pâques, puis trois autres par la suite.
Votre exposé m'a ramené des souvenirs de Sperwan Ghar et de Masum Ghar et ainsi de suite. Et le travail que vous faites maintenant pour être en mesure de ravitailler les ingénieurs... vos génératrices et toute l'infrastructure. Nous n'en avions pas de trop.
Je sais que cela a été très difficile pour nous, car nous étions si peu.
Ce que je voudrais vous demander — et nous avons eu deux diapositives prises à l'hôpital de rôle 3, le scanneur, qui était très rudimentaire...
Dites-moi, comment avez-vous fait pour travailler avec les forces de la coalition? Les Canadiens n'avaient pas d'hélicoptères. Comment faisiez-vous pour ramener tous les blessés à la BOA et les transporter jusqu'à l'hôpital, à Kandahar? Je vous pose la question dans ce contexte. Quels grands changements avez-vous vus entre 2007 et 2009?
L'interopérabilité, c'est-à-dire la façon dont nous travaillons avec nos alliés... Je ne vous dirais pas qu'il y a eu de grands changements entre 2007 et 2009, car tout s'est fait très graduellement. Durant tout mon séjour là-bas, l'hôpital de rôle 3 était commandé et dominé par les Canadiens, ce qui a probablement facilité les choses.
Pour ce qui est d'évacuer les victimes de la BOA, cela se faisait toujours, sauf pour de très rares exceptions, avec des hélicoptères de l'armée américaine, avec leur personnel médical. Sur le plan médical, nous avions déjà des liens très serrés avec ces personnes de toute façon.
J'ai passé quelques journées à Kandahar, et même là — je travaillais avec un neurologue britannique et un anesthésiste danois —, tout s'est passé assez rondement, car, je le répète, le traitement des blessés est relativement simple: il y a un trou ici, un autre là et des lésions entre les deux; vous savez assez vite ce qu'il y a à faire. Ça ne laisse pas énormément de place aux débats d'ordre intellectuel, comme ce pourrait être le cas avec le cancer ou le diabète.
Tout s'est fait en douceur, et nous n'avons pas eu de problèmes avec nos alliés.
Je pose la question parce que c'était une innovation.
Maj Ray Wiss: Oui, ce l'était.
M. Corneliu Chisu: Nous avions le tourniquet israélien. Il semble que...
Oui, ils ont beaucoup aimé notre machine. Je l'ai apportée et je m'en suis servi durant les premiers jours de mon arrivée à Kandahar, sous l'air un peu abasourdi des chirurgiens américains qui étaient là, et qui n'arrivaient pas à le croire. J'étais en train de faire cette procédure, enfoncer ce gros cathéter assez profondément dans le corps d'un blessé, et ils m'ont demandé: « Mais, que faites-vous là? » Je leur ai demandé de me faire confiance en précisant que c'était exactement l'intervention qui s'imposait. Évidemment, cela a fonctionné et ils ont été passablement impressionnés.
Mais d'autres cas sont venus plaider en faveur de ma technique, un peu plus tard durant mon séjour... je présume que ma réputation m'avait précédé. J'ai été en mesure de demander des évacuations pour des patients qui semblaient en assez bon état, mais qui saignaient à profusion intérieurement. C'est là l'énorme avantage des ultrasons. Vous avez deux patients. L'un d'eux s'est fait arracher les deux jambes, mais il a des tourniquets, et il ne saigne plus. Cela lui permettra effectivement de survivre pendant plusieurs heures. L'autre patient a l'air assez bien, mais ses entrailles sont noyées de sang. Il n'y a aucune façon d'exercer une pression là-dessus pour stopper les saignements. C'est lui qu'on mettra dans l'hélicoptère en premier; l'autre devra attendre. C'est ainsi qu'on se retrouve au final avec deux soldats vivants. C'est là l'énorme avantage.
Grâce à cette procédure, j'ai été en mesure de demander des évacuations pour des personnes que l'on n'aurait pas jugé nécessaire d'évacuer, et de les faire opérer à temps.
Merci beaucoup pour cette explication au sujet des ultrasons, une intervention que tous les intervenants du milieu ont saluée comme étant une innovation.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le sort réservé aux soldats qui rentraient au pays? Ont-ils pu continuer à recevoir les soins dont ils avaient besoin?
Je dirais que oui, monsieur. C'est vrai pour la grande majorité d'entre eux. C'est ce qu'il faut retenir, en fait. Je sais que j'ai l'air de me répéter, mais vous devez faire savoir au monde que les soins sont là pour les gars qui reviennent du front. Si vous avez des problèmes, si vous connaissez un soldat qui se dit déçu, qui a entendu des histoires d'horreur et qui a eu vent qu'un de ses camarades avait eu une mauvaise expérience avec le système, dites-lui de tenter le coup quand même, car le système fonctionne dans la vaste majorité des cas. Les soins sont là pour eux, et ils sont efficaces.
Merci, monsieur le président.
Je remercie notre invité d'être ici avec nous aujourd'hui.
J'aimerais faire un bref commentaire.
Quand j'avais 3 ans, j'ai eu le privilège d'aller en Afghanistan avant l'invasion des Russes. J'ai connu une population civile extraordinaire. Ce qu'elle vit présentement est une horreur totale.
Je veux vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Ce sont des conditions excessivement arides et très dures. Malgré cela, vous gardez un bon moral et vous avez gardé un excellent contact. On peut dire fièrement que c'est une bonne chose, parce que les civils qui sont là-bas en ont besoin.
Quand j'étais réserviste, j'ai eu la chance d'avoir des instructeurs qui étaient allés en Bosnie et qui souffraient encore du syndrome de stress post-traumatique même s'ils étaient instructeurs. Vous avez eu le privilège de vivre les opérations. Souvent, des gens ici sont cliniciens. Ils font énormément de recherche, ce qui est important. Votre contribution n'était pas seulement là-bas, mais aussi en première ligne. Vous avez vécu les combats et vous étiez avec des frères d'armes.
En me basant sur ce que vous avez dit, je crois qu'il y a une certaine culture. Vous avez dit que le problème, si je vous ai bien compris, est qu'ils ne vont pas s'avancer et dire qu'ils vivent un deuil et ont de la difficulté à le vivre.
Est-il possible qu'ils aient la crainte d'abandonner des gens avec qui ils sont tous les jours? Est-il aussi possible qu'ils craignent de perdre l'emploi pour lequel ils se sont entraînés toute leur vie? Y a-t-il des améliorations à apporter sur le terrain? Cela ne doit pas être facile quand une roquette atterrit dans le camp.
Cela ne doit pas être facile et même, cela doit être un enfer. Le moral doit descendre. Vous l'avez sûrement ressenti sur le terrain.
Vous avez posé plusieurs questions. Y a-t-il une crainte? On craint toujours de ne pas pouvoir être présents pour nos camarades. La première fois où on a tiré sur moi, étrangement, l'émotion dont je me souviens le plus était le soulagement, parce que j'étais capable de faire face au feu et que je ne me suis pas enfui dans l'autre direction. Sur le coup, j'ai trouvé cela étrange. La suite logique est d'aller dans l'autre direction, mais je me suis senti soulagé parce que je n'allais pas laisser mes camarades sur le champ de bataille. Le sentiment qu'on a pour nos camarades et nos frères d'armes est à ce point puissant.
Des gens qui sentent qu'ils perdent la carte ont-ils peur de perdre leur emploi? La réponse est non. Le jour où on abandonnera quelqu'un pour une raison comme celle-là est loin. Je dirais que c'est comme pour n'importe quelle autre blessure. Bien sûr, une blessure changera ce que vous allez faire dans votre vie. Certains de nos tireurs d'élite ont perdu une jambe. Ils ne seront plus tireurs d'élite, mais les forces armées pourront leur trouver quelque chose à faire sur le plan éducatif ou administratif. La même chose arrivera pour une blessure émotionnelle. Cela changera ce que vous allez faire. L'armée peut toujours vous trouver quelque chose à faire, que ce soit comme instructeur de cadets ou autre chose, mais on va trouver quelque chose.
À la suite de vos observations et de votre expérience sur le terrain, avez-vous fait des recommandations aux Forces canadiennes, par exemple, relativement à l'appareil dont vous avez parlé un peu plus tôt qui peut aider sur le terrain? À la suite de vos observations sur le plan psychologique et opérationnel, avez-vous fait des recommandations à faire sur des façons d'agir qui pourraient être différentes? Il pourrait s'agir de missions qui pourraient être modifiées ou de rotations plus fréquentes. Je ne sais pas quelles seraient les solutions que vous pourriez présenter au comité. En ce qui concerne les équipements, j'imagine que vous avez fait plusieurs rapports.
Oui, j'en ai fait plusieurs.
L'ultrason est mon dada. C'est ce que je connais le mieux. C'est donc sur cela que mes recommandations se sont axées.
Je tiens à souligner qu'après ma première mission sur le terrain, j'ai fait une multitude de recommandations. Elles ont toutes été mises en oeuvre avant mon deuxième voyage. Les médicaments, les appareils et les instruments qu'on avait à la FOB lors de ma deuxième mission étaient tout ce que je voulais. Je n'aurais pas pu en vouloir davantage.
En ce qui concerne le syndrome de stress post-traumatique, avez-vous fait des recommandations à partir d'observations sur les outils et la formation?
En ce qui a trait au traitement de syndrome de stress post-traumatique, nous sommes les meilleurs au monde. Amenez-nous des gens, dites leur de venir nous voir. Même si la une de The Gazette de Montréal et de celle du Journal de Québec indiquent que le sergent Tremblay a été malmené par les Forces canadiennes, dites aux gens d'y aller quand même parce que la vaste majorité des gens vont recevoir de très bons soins des Forces canadiennes.
[Traduction]
Merci beaucoup d'être là, major Wiss.
Merci de nous remettre en mémoire tout l'héroïsme dont le personnel médical des Forces canadiennes fait montre. Nous avons tous entendu parler du talent, de l'imposant savoir et de la vaste expérience médicale que vos collègues et vous avez accepté de communiquer à ce comité, mais il nous arrive d'oublier toute l'importance que cet aspect des opérations a toujours eue.
Vous nous avez montré huit visages qui expriment toute cette valeur avec force et authenticité, mieux que n'importe qui d'entre nous aurait pu le faire, mais vous nous avez aussi rappelé que cette valeur du personnel médical a de profondes racines dans les Forces canadiennes, certains membres de ce groupe — et les exemples ne manquent pas — s'étant mérité la Croix de Victoria dans différents conflits et différentes missions...
Je pense entre autres au soldat Richard Rowland Thompson, qui a reçu l'Écharpe d'honneur de la Reine, une distinction que certains disent supérieure à la Croix de Victoria, quoique...
Exactement. C'était assurément un honneur des plus rares, dans le temps de la guerre des Boers.
Je crois que c'est l'une des raisons qui expliquent l'excellence des Forces canadiennes: son personnel médical décuple les forces de l'armée et fouette le moral des troupes. C'est tout un honneur de vous avoir parmi nous.
Merci aussi pour votre contribution littéraire, merci de vous être donné la peine de coucher cette histoire par écrit, car sans vos livres, la chose n'aurait jamais capté un si vaste auditoire. Du reste, vous l'avez fait avec grand talent et un enthousiasme certain.
À cet égard, nous vous devons tous beaucoup. À vrai dire, il est arrivé plus d'une fois que nous ayons parlé ici même de certains passages de vos livres et que nous nous en soyons inspirés.
Cela dit, je voudrais vous poser des questions sur le portrait d'ensemble. Je viens de nouveau de jeter un coup d'oeil au livre. Je me souviens d'avoir lu, au début de votre premier livre, un passage sur votre engagement à l'égard de la mission en Afghanistan — un point de vue que je partage assurément —, décrivant le conflit comme étant une guerre morale, une guerre juste, une opération militaire légitime au côté de nos alliés, le type de mission pour lequel nous nous sommes toujours préparés et pour lequel nous avons été préparés. Par ailleurs, vous expliquez dans quelle mesure la nation était divisée malgré tous ces avantages, les uns affirmant que nous étions des gardiens de la paix et que nous ne devions plus jamais participer à des guerres ouvertes, et les autres, dans une description tout aussi superficielle et peu utile du conflit, arguant que nous devions tout simplement aller là-bas et frapper un grand coup.
Vous avez dit qu'en 2007, nous étions une nation divisée, et je crois que la situation est restée la même durant toutes les années subséquentes où nous avons pris part aux hostilités.
Quel impact cette division de l'opinion et de l'appui publics a-t-elle sur la capacité du pays à motiver ses soldats, et à prendre soin d'eux sur le terrain et quand ils rentrent au bercail?
Nous sommes des soldats. Nous ne pratiquons pas la démocratie, nous la défendons.
Le message primordial que j'essaie de vous transmettre est que nous n'avons absolument rien à reprocher aux personnes qui s'opposent aux missions qu'on nous confie. En fait, plusieurs de mes meilleurs amis, à ce jour, sont contre la mission. Ils ont lu mes deux livres et ils acceptent, lorsque nous débattons, que j'aie raison, mais ils sont quand même contre la mission. Je crois que ce sont des personnes formidables, et je suis allé en Afghanistan pour les défendre et pour défendre leur droit d'être en désaccord.
Ce que j'ai de la difficulté à avaler, c'est un état d'esprit comme celui de cette personne qui est venue me voir lorsque je suis rentré de ma première mission, en 2008, et qui m'a dit: « Eh, il paraît que tu es allé en Irak? » Difficile à prendre. Ou cette autre personne qui m'a dit, en 2009, au moment où je partais pour la deuxième fois — et je parle ici d'un médecin qui vit à Toronto et qui a accès à autant d'information que n'importe qui sur la planète — « Tu pars pour l'Afghanistan? Sommes-nous des gardiens de la paix, là-bas? » Difficile à prendre.
Je parle beaucoup de l'Afghanistan. Même maintenant, je reçois encore une ou deux invitations par mois pour aller parler à des gens, et je suis prêt à parler à n'importe qui. Il pourrait s'agir d'un groupe de six personnes dans une école primaire, j'irais leur parler. Ce que j'entends le plus souvent des adultes lors de mes présentations est: « Je n'avais aucune idée. » Après 158 morts et 10 années de guerre, j'ai de la difficulté à accepter cela. C'est une réalité qui blesse les anciens combattants.
Si je peux vous demander une chose, c'est de dire aux gens ce que nous avons fait. Dans cette démarche, vous n'avez pas à prendre parti ou faire valoir un argument... vous n'avez même pas besoin d'être pour la mission. Les gens qui étaient contre la mission ont quand même aimé mes livres, car je dis les choses telles qu'elles sont. Faites savoir aux gens pourquoi nous sommes allés là-bas, ce que nous y avons fait, ce que nous avons enduré et ce que nous avons perdu.
D'arriver aujourd'hui et de constater qu'un aussi grand nombre de Canadiens n'étaient tout simplement pas au courant, c'est ça qui nous blesse et qui risque de miner notre efficacité opérationnelle, s'il faut parler en ces termes. Les gens doivent savoir. Les gens doivent se souvenir d'eux.
Merci.
J'ai une question à vous poser, major.
J'allais vous donner l'occasion de transmettre un message définitif et voilà que M. Alexander l'a fait.
Une des tâches de notre comité est de tirer des leçons. Comment devenir plus efficaces? En ce qui vous concerne, comment pouvons-nous améliorer notre façon de traiter et de gérer sur le terrain les blessures traumatiques? On vous a déjà questionné sur certaines choses qui ont été réglées — les sacs à dos, les gilets pare-balles, le contenu des trousses. Nous savons que RDDC perfectionne actuellement votre équipement d'ultrasons afin que le personnel médical puisse l'utiliser pour des opérations plus poussées, directement sur le terrain.
Vous avez expliqué et montré l'impact que les engins explosifs improvisés, les EEI, ont sur nos véhicules d'assaut légers. Nous savons que nous les avons tous réduits, que nous les avons équipés de coques en V et que nous les renforçons pour qu'ils résistent mieux aux explosions, ce qui, nous l'espérons, augmentera les chances de survie des hommes et des femmes braves qui doivent circuler à leur bord, et réduira la gravité des blessures.
Selon vous, quelles autres mesures pourrions-nous prendre pour améliorer la sécurité de nos troupes sur le terrain, soit à la BOA ou même directement avec le personnel médical qui doit traiter ces blessures au moment où elles se produisent?
Ne vous sentez pas obligé de répondre à la question sur-le-champ. Vous pouvez toujours nous écrire plus tard.
Je vais sauter sur votre proposition, car je crois que j'aurais de la difficulté à formuler à l'instant une réponse succincte. Toutefois, laissez-moi vous quitter en vous exposant un concept.
À l'heure actuelle, les Services de santé des Forces canadiennes ont une organisation remarquablement efficace. Pour la guerre moderne, ils ont un taux de survie de 98 %, un rendement supérieur à celui des principaux centres de traumatologie au Canada. Ces services sont d'une efficacité phénoménale. Or, l'organisation est en fait un château de cartes. Ne pensez pas un instant que vous pourrez en changer une partie sans que cela ait d'incidence sur tout le reste de l'édifice. Vous devez préserver le fonctionnement de tous les aspects, notamment de la formation et de la recherche.
Nous savons ce que nous aurions pu améliorer l'an dernier, car nous avons travaillé là-dessus. Si vous préservez la vitesse de croisière actuelle de la formation et de la recherche, nous pourrons envisager l'an prochain ce qui pourrait être amélioré. C'est une question à laquelle on n'a pas besoin de répondre immédiatement.
Nous n'avons pas cessé d'étudier ce qui se passe. Chacun des nôtres qui ont perdu la vie a subi une autopsie. Nous avons évalué si l'équipement de protection avait bien fait son travail, composante par composante. Voilà pourquoi l'Autoroute des héros finit à Toronto. Le saviez-vous? L'autoroute finit là parce que le coroner en chef de l'Ontario examine chacun de nos morts, pratique une autopsie et envoie son rapport à l'armée. Nous avons étudié le passé.
Pour l'instant, gardez les choses comme elles sont afin que nous puissions, autant que faire se peut, nous faire une idée de ce qui nous attend.
Oui, et ne vous gênez pas. Demandez-nous des dispositifs de logistiques ou des pièces équipement, ou donnez-nous des conseils en matière de formation.
Tous ces aspects sont importants pour nos travaux.
Au nom du comité, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de comparaître et d'avoir amené votre famille avec vous. C'était très agréable de les rencontrer, eux aussi. Je salue en outre la ferveur dont vous faites montre à l'endroit de notre pays et de vos collègues soldats, et je vous remercie pour le point de vue tout à fait particulier et inédit que vous nous avez communiqué.
S'il vous était possible de rencontrer ces jeunes soldats, monsieur, vous comprendriez qu'il est relativement facile d'éprouver de la passion à leur égard.
Merci beaucoup.
Oui, je comprends.
Sur ce, nous allons suspendre nos travaux et faire place nette pour notre prochain témoin.
Reprenons. La plupart des membres ont réintégré leur place.
Avec nous, pour l'heure qui vient, le major Lisa Compton, du ministère de la Défense nationale. Madame Compton est gestionnaire du Programme de maintien de préparation clinique. Elle est accompagnée du Dr Mark Zamorski, qui est le chef de la Section de la santé des militaires.
Sur ce, major, je vous invite à procéder.
Merci, monsieur le président, membres du comité.
Mesdames et messieurs, je veux vous remercier pour l'intérêt que vous portez aux soins offerts aux membres des Forces canadiennes et pour votre soutien à cet égard. Je suis une militaire canadienne et je suis infirmière. J'ai eu le privilège de travailler au sein de l'Unité médicale multinationale (UMM) de rôle 3, une baraque faite de contreplaqué et de miracles qui tenait lieu d'hôpital; j'ai aussi été la seule Canadienne à faire partie de l'équipe du Craig Joint Theatre Hospital, à Bagram, en Afghanistan. Étant donné l'intérêt que vous portez aux soins des malades et des blessés, mon rôle et mes expériences à titre de coordonnatrice des infirmières en traumatologie de l'UMM de rôle 3, de coordonnatrice des infirmières en traumatologie à Bagram, d'officier de liaison des services infirmiers du Canada et de coordonnatrice nationale des infirmières en traumatologie des Forces canadiennes devraient également vous être utiles.
Les Forces canadiennes participent au système interarmées de trauma en théâtre (SITT) depuis 2007. C'est à ce moment que les FC ont commencé à utiliser le registre interarmées de trauma en théâtre, un registre rigoureux des traumatismes qui a permis non seulement d'effectuer des recherches salutaires, mais aussi d'améliorer le rendement en temps réel dans une zone de combat. Le registre permet en outre d'apporter sur le champ de bataille des améliorations aux processus de traumatologie, améliorations qui sont fondées sur des données et qui se traduisent par une réduction importante de la morbidité et de la mortalité.
Le guide de pratique clinique est l'une des ressources les plus utiles du SITT puisque c'est le pivot du programme d'amélioration du rendement dans le théâtre. Depuis les tout débuts du système de trauma en théâtre, le guide a été élaboré et mis en œuvre par des experts du domaine clinique pour répondre à des besoins constatés dans la zone d'opérations. Dans toute la mesure du possible, le guide de pratique clinique du SITT est fondé sur des preuves. Comme on peut l'imaginer, les soins de traumatologie nécessitent une approche très différente selon que l'on est dans une zone de combat ou dans un grand centre de traumatologie, et ce, pour de nombreuses raisons. Le guide porte sur la façon d'améliorer les soins dans les zones de combat, mais il présente aussi une orientation clinique pour traiter les blessures propres à l'environnement de combat.
Quand je travaillais à l'UMM de rôle 3, j'ai été témoin de l'incroyable courage des membres des FC et j'étais fière de faire partie de l'équipe médicale qui offrait les meilleurs soins, quel que soit l'endroit. L'an dernier, le Canada a obtenu le prix Larrey de l'OTAN pour l'excellence démontrée par l'Unité médicale multinationale de rôle 3.
Les membres des FC acceptent de prendre d'énormes risques et on leur demande de consentir les plus grands sacrifices. Que ce soit dans une baraque en contreplaqué ou dans une clinique impeccable, ils méritent les meilleurs soins qui soient, partout où ils se trouvent. Les Services de santé des FC visent l'excellence.
Je serai heureuse de répondre à vos questions de mon mieux et d'obtenir pour vous l'information que je ne serai pas en mesure de fournir sur-le-champ.
Merci.
Merci, major Compton.
Monsieur Zamorski, nous entendrons aussi votre déclaration, avant de passer aux questions.
Merci, monsieur le président et à vous, distingués membres du comité, de me donner cette occasion de témoigner aujourd'hui.
Je suis Mark Zamorski, chef de la Section de la santé des militaires déployés du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes. Le travail de ma section consiste principalement à faire de la recherche sur la santé mentale et les problèmes connexes, tels que le suicide et la violence familiale. Nous avons en outre mis au point le programme amélioré de dépistage postdéploiement des problèmes de santé mentale, programme que nous appuyons concrètement. En plus de nos travaux de recherche, nous participons à des activités scientifiques; nous avons notamment siégé récemment à trois groupes d'experts chargés d'étudier les traumatismes cérébraux, la prévention du suicide et la prévention de la violence familiale. Au cours de la dernière année seulement, trois membres de notre personnel scientifique ont signé ou cosigné 10 publications à comité de lecture et ils ont présenté 15 résumés dans le cadre de réunions scientifiques nationales et internationales.
Actuellement, nous nous concentrons sur trois principaux protocoles de recherche, dont deux portent respectivement sur la compréhension des effets des troubles mentaux et des traumatismes cérébraux sur l'aptitude physique au travail. Par ailleurs, je suis l'enquêteur principal de l'Enquête transversale sur la santé mentale dans les Forces canadiennes de 2013. Au cours de cette étude, réalisée par Statistique Canada au nom du ministère de la Défense nationale (MDN), 9 000 militaires en service seront interviewés en vue d'analyser l'incidence de la mission en Afghanistan et du renouvellement de notre système de santé mentale sur les besoins de soins de santé mentale.
Médecin de famille de formation, je me suis perfectionné dans le domaine de la santé publique. Avant de travailler au MDN, j'ai occupé un poste de professeur à l'école de médecine de l'Université du Michigan pendant neuf ans.
Je suis prêt à répondre aux questions concernant les travaux de recherche et les autres activités scientifiques de ma section. Je peux aussi formuler des commentaires généraux sur les notions scientifiques qui sous-tendent la prévention et le contrôle des problèmes de santé mentale et les phénomènes qui s'y rattachent dans les organismes militaires.
Je vous remercie encore une fois de m'avoir offert cette possibilité de comparaître devant vous.
Merci beaucoup.
Pour cette partie de l'audience, encore une fois, je pense que nous allons procéder par rondes de cinq minutes.
Monsieur Harris, vous avez la parole.
Merci, monsieur le président, et merci à vous deux pour vos présentations.
Monsieur Zamorski, je crois comprendre que vous êtes directeur de recherche. Vous avez parlé d'une enquête sur la santé mentale, ce qui, à mon sens, est une très bonne chose. J'aimerais toutefois vous lire quelque chose, et j'aimerais connaître vos vues en la matière. Nous avons entendu M. Wiss et d'autres vanter les mérites de notre système, et je sais que nous sommes bons dans ce que nous faisons. M. Wiss a parlé des services de traumatologie Trident et de la réponse directe sur le terrain au syndrome de stress post-traumatique. Ces activités sont probablement à l'avant-garde de ce qui se fait dans le monde entier. Mais je vais vous lire ce que nous a dit M. Pierre Daigle, l'ombudsman des FC, le 20 mars dernier:
Je suis préoccupé par le fait que les Forces canadiennes n’ont toujours pas de système adéquat en place pour obtenir une représentation à jour et uniforme du nombre de militaires souffrant du syndrome de stress post-traumatique et d’autres traumatismes liés au stress opérationnel.
De quelle façon l’institution peut-elle savoir si elle a en place les priorités et les niveaux de ressources les plus adéquats pour gérer l’initiative plus vaste des traumatismes liés au stress opérationnel quand ses données sont incomplètes et sa recherche ne vise pas la mesure de rendement?
J'ai parlé plus tôt du rendement. Vous avez peut-être lu ce témoignage. Aimeriez-vous formuler des commentaires à ce sujet? Est-ce que l'enquête à laquelle vous participez est la réponse à cela, ou s'il faudrait en faire davantage?
L'enquête est une partie très importante de la réponse. On peut déceler deux critiques là-dedans, et ces deux critiques sont, dans une certaine mesure, à la fois liées et séparées. L'une concerne la capacité de saisir l'ampleur des problèmes, qui en a et qui n'en a pas, et à établir si les problèmes augmentent ou diminuent. Il importe que nous ayons cette fonction de surveillance de la santé publique, et certaines parties de cette fonction sont en place. Nous devons aussi comprendre l'incidence que les opérations militaires ont sur la santé mentale de membres des FC, si nous souhaitons gérer notre programme de façon appropriée et prendre soin de nos effectifs. Nous reconnaissons cet aspect et nous sommes absolument d'accord avec la critique en la matière.
Une deuxième fonctionnalité très importante est celle qui consiste à documenter de façon détaillée le type de soins que nous offrons et à comprendre comment ces derniers se comparent avec ceux auxquels nous aspirons. Et nous sommes tout à fait d'accord avec l'ombudsman pour dire qu'il faudrait nous améliorer à ce chapitre. Nous devons aussi mieux documenter les résultats obtenus grâce à ces soins. Notre désaccord avec l'ombudsman porte sur ce qui constitue la meilleure stratégie pour y arriver. Le bureau de l'ombudsman insiste depuis assez longtemps sur l'idée de mettre au point un genre de base de données où seraient répertoriées toutes les personnes ayant subi des traumatismes liés au stress opérationnel, de manière à ce que nous puissions savoir en tout temps le nombre de cas existants, et ce, par simple pression d'un bouton.
En ma qualité de spécialiste de la santé publique et parce que je suis tenu d'être au courant de ce genre de choses, je peux vous affirmer qu'une telle orientation n'est pas très utile à mes yeux. Au lieu de cela, la voie pour laquelle nous avons opté consiste à recourir à une série de différentes façons de répondre à ces demandes de fond, soit celle de comprendre les soins que nous offrons, l'effet que ceux-ci peuvent avoir et l'effet néfaste de la mission sur la santé.
L'ombudsman nous dit qu'il réclame ce système depuis près de 10 ans. Il affirme que nous ne mesurons pas vraiment le rendement, c'est-à-dire que nous ne savons pas quels traitements fonctionnent pour les traumatismes liés au stress opérationnel. Où en sommes-nous à ce chapitre? Je pense que la base de données à laquelle travaille Statistique Canada pourra nous être utile, mais pas nécessairement pour jauger l'efficacité des différents traitements. Or, je crois que cet aspect est d'une importance cruciale pour établir si nous sommes sur la bonne voie pour aider les personnes qui en ont besoin. Il ne s'agit pas ici de critiquer l'intention des gens. Mais nous entendons encore ces histoires sur des personnes qui ne reçoivent pas de soins, et qui pensent qu'elles pourraient recevoir des soins. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. On nous dit, par exemple, que le fait de mesurer la longueur des listes d'attente est une bonne façon d'établir si nous offrons un service adéquat, mais je n'en suis pas convaincu.
Le problème est à la fois universel et canadien, c'est-à-dire que si vous allez voir les responsables de n'importe quelle clinique de santé mentale pour malades externes au Canada et que vous leur demandez de décrire les traitements qu'ils prodiguent, dans quelle mesure ils réussissent à les donner, quels en sont les résultats et comment ces résultats se comparent à ceux des autres cliniques, vous risquez de croiser bien des regards d'un vide absolu.
C'est un problème auquel nous sommes confrontés et tout le pays avec nous: comprendre les soins que nous offrons et les résultats que nous obtenons.
Nous avons les mêmes défis. Si la solution en avait été facile, le problème aurait été réglé il y a belle lurette et j'aurais la vie beaucoup plus facile. Je pourrais me consacrer tout entier à l'analyse de ces formidables données, au lieu d'essayer de bâtir le système qu'il nous faut pour répondre à ces questions. En termes précis, nous avons besoin de systèmes qui pourront saisir en détail la teneur exacte des soins et, tout particulièrement, celle des soins de psychothérapie, et les résultats qui en découlent.
Dans le domaine de la cardiopathie, vous pouvez compter le nombre de jours que les patients ont passés à l'hôpital. Vous pouvez compter ceux qui ont eu un deuxième infarctus dans l'année qui suit. Vous pouvez savoir combien sont morts et combien ont survécu et ainsi de suite. Tous ces calculs peuvent se faire assez facilement, et les résultats obtenus sont des marqueurs clairs de l'état des soins. C'est beaucoup plus difficile à faire en santé mentale.
Dans les FC, nous avons trois initiatives. D'abord, nous comptons sur l'enquête sur la santé mentale pour nous fournir d'importants renseignements au sujet de certaines de ces questions. Avec beaucoup de prudence, nous demanderons aux personnes visées si elles ont été satisfaites des soins reçus. Nous leur demanderons si elles étaient conscientes qu'elles avaient des troubles mentaux ou non. Nous saurons si elles ont tenté d'obtenir de l'aide ou non. C'est une façon de rendre compte de la qualité de nos institutions. Si ces personnes ont effectivement eu recours à des soins, nous tenterons de savoir comment elles vont maintenant et dans quelle mesure les soins les ont aidés. On leur demandera également de nous dire la valeur qu'elles accordent aux soins qu'elles ont reçus.
Cette enquête touchera à une foule d'autres choses qui nous aideront à comparer la qualité des soins que nous offrons à ceux que nous souhaitons offrir.
La deuxième initiative consiste à renforcer notre système d'information sur les soins, de manière à le rendre beaucoup plus fonctionnel pour la compréhension des traitements que nous prodiguons en santé mentale.
La troisième initiative est institutionnelle. Il s'agit d'un mécanisme de gestion des résultats en matière de santé mentale. C'est en fait un système informatique colligeant les réponses des questionnaires que les patients devront remplir à chaque visite sur leurs symptômes, leur état et leur capacité de fonctionner. La compilation des données permettra d'établir des comparaisons avec les résultats attendus dans d'autres cas semblables pour des traitements similaires, permettant dès lors aux cliniciens d'établir si les personnes traitées progressent comme prévu et, dans la négative, de voir avec elles ce qu'il y aurait lieu de changer pour améliorer leur état.
Voilà les trois grandes initiatives sur lesquelles nous travaillons.
Merci, monsieur le président.
Tout d'abord, major Compton, quelle formation avez-vous reçue pour le SITT avant de vous retrouver dans le théâtre?
C'est une question intéressante, car la réponse l'est tout autant. J'ai été déployée en 2007, dans le cadre de la Roto 4, et j'étais dans le théâtre au moment où l'on m'a dit que j'allais être intégrée au système des traumas. À ce moment-là, je ne savais pas de quoi il s'agissait.
Je suis donc sortie du théâtre et, dans les 24 heures, j'ai quitté Kandahar et me suis retrouvée à San Antonio, au Texas. Là, j'ai suivi un cours de trois semaines sur les façons d'améliorer le rendement et le registre des traumas. On m'a ensuite renvoyée dans le théâtre, et j'y suis restée neuf mois.
Je crois que nous en avons déjà parlé lors de la présentation de M. Wiss. C'était la nuit où nous avons perdu un technicien médical et que l'épouse de ce dernier était sur place. C'en est une que je ne suis pas près d'oublier.
Aussi, comme je suis une maman, c'était toujours très difficile de recevoir des bambins. L'arrivée de Canadiens était aussi difficile à supporter.
Il est difficile de mettre le doigt dessus. J'ai été déployée six fois. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans cette cabane en contreplaqué, alors j'ai vécu pas mal de situations difficiles.
Docteur, en ce qui concerne la santé mentale et notre attitude à ce sujet, nous avons fait d'énormes progrès depuis l'an 2000, époque à laquelle nous venions de quitter la Bosnie. Le général Natynczyk s'est bien assuré que l'armée change d'attitude.
Je me souviens de l'époque où les systèmes de soutien présents sur les bases étaient méprisés par le psychiatre. De nos jours à Pettawawa, par exemple, nous comptons plus de cinq psychiatres qui s'occupent de 5 000 âmes sur la base, tandis que le reste de la population civile, quelque 90 000 habitants, n'ont que deux psychiatres. Les soins offerts sont d'une qualité grandement améliorée, et nous prenons les choses beaucoup plus au sérieux.
Selon les statistiques, le nombre de suicides au sein des forces armées est sensiblement le même qu'ailleurs dans la société: toutefois, il nous semble qu'il y en a bien plus. On observe un décalage entre ce que nous lisons dans les journaux et ce que les statisticiens de la Défense nationale nous disent. Y a-t-il des tentatives de suicide que nous ignorons? Pouvez-vous nous expliquer ce décalage?
Il s'avère que le suicide constitue un grand problème de santé publique au Canada et, bien évidemment, nous sommes au Canada. Le suicide est un problème de santé publique particulièrement pertinent pour la couche démographique qui a tendance à constituer la vaste majorité des militaires, c'est-à-dire les jeunes hommes et les hommes d'âge moyen.
Ce genre d'histoires fait la une et attire l'attention du public, et il semble que chaque fois que nous ouvrons le journal, nous y lisons un autre reportage sur un suicide. Je ne souhaite pas donner l'impression de vouloir minimiser ce phénomène, car moi-même j'ai la même réaction lorsque je prends mon journal, mais malheureusement, il ne s'agit pas d'une façon fiable d'évaluer un problème de santé publique.
Nous disposons d'un système qui permet de tenir compte des décès au sein des forces armées régulières, et nous tenons un registre de tous les membres et des causes de leur décès. Une fois par an, nous faisons le total des suicides et tous les cinq ans, nous calculons le taux quinquennal et nous en faisons rapport.
Ce qui complique les choses, c'est la proximité des États-Unis, un pays qui a connu une hausse fulgurante des taux de suicide, notamment au sein de l'armée et des Marines. On pourrait donc penser que ce même phénomène se produit au Canada également, vu les défis et les exigences opérationnels. Or, on ne constate pas la même tendance, quelle qu'en soit la raison.
Pouvez-vous nous indiquer certains des facteurs courants qui pourraient contribuer au suicide, et nous décrire les initiatives de prévention du suicide déployées actuellement par les Forces armées canadiennes?
:Le suicide est un phénomène fort compliqué, comme vous le savez bien. Dans un cas donné, un ensemble de facteurs entrent en ligne de compte.
Le facteur principal, ce sont les moments difficiles de la vie. Habituellement, on constate un ou plusieurs passages difficiles dans la vie de la personne. À un moment donné, un facteur aigu provoque un déclic. Ce facteur s'ajoute à des troubles psychologiques, tels que la dépression et les troubles connexes. Les gens commencent alors à avoir des pensées suicidaires. Bon nombre de personnes ont de telles pensées, mais certains facteurs qui se présentent plus tard font que ces pensées suicidaires se réalisent ou non.
Parmi les facteurs qui pourraient ou non porter quelqu'un à se supprimer, soulignons l'impulsivité. Les gens qui ont tendance à être impulsifs et qui ont des pensées suicidaires peuvent se suicider, alors que d'autres personnes qui n'ont pas ce caractère impulsif ne le font pas. L'absence d'espoir, le pessimisme, tous ces facteurs psychologiques entrent en ligne de compte.
L'autre facteur sous-estimé est le rôle que joue la disponibilité des moyens de se donner la mort. La preuve est abondante pour montrer que la disponibilité des armes de poing en particulier constitue un grand facteur de risque de suicide.
Des études qui ont porté sur la composition du gaz des cuisinières. On entend parler de gens qui, dans le passé, se mettaient la tête dans le fourneau pour se tuer. Cette méthode ne fonctionne plus, car le gaz naturel des cuisinières ne contient plus de monoxyde de carbone. Au Royaume-Uni et ailleurs, où la teneur en monoxyde de carbone dans le gaz naturel des cuisinières a été réduit, on a observé une baisse considérable du taux de suicide global.
L'imitation des suicidés joue également un rôle. Lorsque des personnes susceptibles entendent parler d'un suicide dans les médias, elles peuvent elles aussi se supprimer, ce qui a été attesté.
Ce sont certains des facteurs qui entrent en ligne de compte.
Merci, monsieur le président.
Mes questions vont un peu dans le même sens, monsieur Zamorski.
Un journaliste a pu obtenir récemment certains renseignements grâce à la Loi sur l'accès à l'information. Il m'a montré des statistiques quinquennales sur le suicide, et il ne m'a pas semblé possible de dégager une tendance. La tendance, c'était justement qu'il n'y en avait pas, vu que les taux étaient plutôt stables dans toutes les catégories démographiques et qu'il ne semblait pas y avoir notamment de différences entre la présence ou non sur le théâtre des opérations.
À la faveur d'un examen plus approfondi, j'ai pu relever deux éléments distinctifs. D'abord, il semblait y avoir une augmentation en janvier et en septembre, et je ne sais pas s'il existe une explication pour cela.
J'ai aussi noté une anomalie quant au taux de résolution, si je puis m'exprimer ainsi. Pour les dossiers de suicide remontant jusqu'à trois ans en arrière, on ne semblait pas avoir joint de rapport. Il n'y avait pas eu de conclusion finale quant à savoir... Je ne sais pas si c'était attribuable aux causes ou à quoi que ce soit, mais il était assez particulier de constater que ces dossiers n'étaient toujours pas réglés au bout de trois ans.
Vous avez parlé des États-Unis. Il semble y avoir divergence entre les statistiques américaines et les nôtres. Je ne sais pas si c'est dû à la manière dont chaque pays comptabilise les suicides. Il est aussi possible que ce soit en raison de la qualité des soins prodigués. Avec un ratio de cinq psychiatres par 5 000 personnes, on met vraiment les chances de son côté, ce qui peut rapporter des dividendes. Mais je ne sais pas vraiment.
Il y a un autre élément qui a piqué ma curiosité. Vous indiquez dans votre document que nous avons affaire dans une certaine mesure à un groupe présélectionné du fait que l'on élimine les candidats à risque en les empêchant d'intégrer les forces militaires, ce qui permet à celles-ci de se situer presque sous la moyenne nationale. C'est une observation intéressante, mais tout cela peut dans une certaine mesure induire les gens en erreur, car on n'effectue le suivi que pour les militaires qui ne sont pas libérés.
Je viens de soulever quatre ou cinq questions différentes et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez.
Je dois vous avouer que j'en ai peut-être perdu une ou deux en cours de route, mais je vais essayer de vous répondre à rebours en vous indiquant que je ne crois pas que les différences entre nos statistiques sur le suicide et celles des militaires américains soient attribuables aux modes de comptabilisation utilisés de part et d'autre. Nous procédons un peu différemment, mais cela ne suffit pas pour expliquer des écarts semblables. C'est donc selon moi une hypothèse que l'on peut rejeter facilement.
Je suis par contre d'accord avec vous pour affirmer, comme d'autres personnes l'ont fait, que l'on peut s'attendre à un taux de suicide inférieur chez les militaires par rapport à la population civile du fait qu'il s'agit d'un groupe présélectionné qui a accès à des soins. Nous ne disposons malheureusement pas des données nécessaires pour faire la part des choses à ce sujet afin de bien comprendre ces distinctions. Nous devons donc nous fier aux travaux pouvant être accomplis dans d'autres pays, aux États-Unis notamment, où le nombre de cas est suffisant pour permettre d'entreprendre une telle analyse.
Désolé, j'ai répondu à deux de vos cinq questions, mais je ne me souviens plus des autres.
Je ne sais pas trop de quoi vous parlez exactement. Ce n'est pas moi qui suis en charge de la compilation de ces statistiques. Je peux toutefois vous dire que l'une des recommandations que nous avons formulées il y a environ deux ans et demi, à la suite du travail du groupe d'experts sur la prévention du suicide, voulait que les Forces canadiennes mettent en place ce que nous appelons un examen technique professionnel des suicides. Lorsqu'un militaire se suicide, les professionnels de la santé interviennent pour essayer de déterminer exactement ce qui s'est passé. L'exercice vise d'abord et avant tout à mieux cerner les possibilités de prévention. Ces professionnels produisent un rapport, ce qui nous permet d'en savoir beaucoup plus qu'auparavant sur les circonstances d'un suicide. C'est donc depuis environ deux ans et demi.
Pourquoi accuserait-on trois ans de retard? Tous les chiffres semblent concorder, puis voilà que le taux de résolution s'éteint pour ainsi dire à la fin de 2010.
Je sais que des chercheurs se sont intéressés aux effets de la situation temporelle sur le suicide, notamment pour ce qui est des saisons, des jours de la semaine et de la proximité des congés, et qu'il a été possible de dégager certaines tendances. Si l'on se limitait à nos propres données, avec une moyenne de peut-être 12 ou 13 réguliers qui se suicident chaque année, il serait bien difficile de dégager une tendance vraiment significative.
Oui. les membres de la force régulière.
Il serait donc vraiment difficile pour nous de tirer quoi que ce soit de données semblables et, en toute honnêteté, même si nous constations que les suicides sont 27 % plus fréquents en décembre qu'en novembre, je ne vois pas vraiment ce que nous pourrions faire de plus que toutes les mesures que nous prenons déjà pour essayer de prévenir le suicide, comme notre rapport en fait foi.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Je crois que vous étiez tous deux présents pour entendre l'exposé du major Wiss, tout au moins en partie?
M. Mark Zamorski: Seulement les cinq dernières minutes.
M. Mark Strahl: En réponse à une question de M. Optiz concernant la réaction de stress de combat, il a indiqué croire que les soldats touchés devraient demeurer, dans la mesure du possible, sur le théâtre des opérations et reprendre leur rôle, plutôt que d'être traités ou de devoir quitter les lieux, étant donné leur volonté de demeurer auprès de leurs camarades. A-t-on établi un protocole à cet effet? Si tel est le cas, a-t-il permis une amélioration de la santé mentale chez les personnes touchées? Avez-vous des données qui nous permettraient de savoir comment les choses se passent si un soldat est retiré dès qu'il présente des signes de stress de combat, ou lorsqu'on lui permet de reprendre graduellement son rôle...? Pouvez-vous nous en dire plus long à ce sujet?
C'est une pratique qui remonte au moins à la Seconde Guerre mondiale. Elle ne date pas d'hier. Nous l'avons observée et, honnêtement, la philosophie n'a pas beaucoup changé. Mais elle découlait de la Première Guerre mondiale, où l'on exigeait vraiment beaucoup plus des êtres humains qu'ils pouvaient donner, jusqu'à ce qu'ils soient à bout. On les sortait donc de cette horreur intolérable, et pour une raison ou une autre, ils ne voulaient pas y retourner. En réponse à cela, si on agissait ainsi à l'époque, ce n'est pas qu'on se préoccupait de leur santé mentale, en partie parce qu'on ne pensait vraiment pas comme cela à l'époque; c'est la nécessité opérationnelle qui motivait leur décision, pratique qui n'était pas viable. À la Seconde Guerre mondiale, ils ont d'abord commencé à faire une rotation des personnes sur le front pour ne pas attendre qu'elles aient perdu la raison avant de les dispenser, si vous voulez.
C'est ce qui s'est passé, et j'ignore si on a fait des recherches à ce sujet, mais on accepte généralement dans les organismes militaires que c'est la bonne façon de le faire lorsque l'on vise l'efficacité opérationnelle.
Peu de travaux de recherche ont été menés concernant les effets sur la santé mentale de cette pratique. Une petite étude israélienne semblait suggérer que les effets, s'il y en avait, étaient plus positifs que négatifs. Mais c'est à peu près tout. Il serait très difficile de mener ce genre d'étude.
Et c'est plutôt monnaie courante. Ce serait vraiment l'exception, et non la règle, qu'une personne quitte le théâtre des opérations pour une raison médicale, et même avec les grands groupes que nous avons formés, à l'extérieur des divers Rôles 3 dans le théâtre, il y a ce qu'on appelle un « hôtel des héros ». Au fond, vu que les gens n'ont pas vraiment besoin de suivi médical à ce moment-là, mais qu'ils ont besoin de faire une pause, de consulter, ils pourront aller dans une baraque plus douillette à l'extérieur de l'hôpital. Le personnel médical sera chargé de s'occuper d'eux, et ils pourront se reposer et reprendre le collier dès qu'ils seront médicalement aptes à le faire.
D'accord. Je comprends. Merci.
Major, je voulais vous poser une question concernant le Programme de maintien de l’état de préparation clinique. À quelle fréquence les cliniciens des Forces le suivent-ils?
C'est un programme permanent. Il a été mis à jour en septembre dernier en fait — on a publié un nouveau manuel — et il s'harmonise maintenant avec la stratégie des opérations.
Il y a trois niveaux différents d'état de préparation clinique. Il y a le standard que tout le monde doit maintenir. Par exemple, à titre d'infirmière, j'occupe un poste administratif en ce moment et, grosso modo, je passerais d'un emploi de bureau à un poste où je soigne les patients les plus malades au monde quand je serai envoyée en mission.
Je fais au minimum 40 quarts de travail par année dans un établissement de soins actifs civil. C'est ce qu'on exige dans mon métier. Pour chaque SGPM — donc les techniciens médicaux, les adjoints aux médecins, les médecins, les infirmières, les dentistes, les physiothérapeutes —, chacun d'entre nous avons un tableau que nous examinons. Si on me choisissait pour faire quelque chose sur l'EICC, par exemple, si je devais être mieux préparée, il me faudrait passer plus de jours dans un établissement de soins actifs. Et certains de mes cours changeraient aussi un peu. Nous agissons en fonction de la demande, au fond.
Qui évalue si les cliniciens des Forces sont bien au niveau? Vous faites 40 quarts de travail, et je suis certain que vous vous en tirez très bien. Y a-t-il une façon de repérer quelqu'un qui n'est pas à la hauteur? Autrement dit, quel est le pourcentage de cliniciens des Forces qui réussissent cette évaluation?
Il n'y a pas d'évaluation officielle en tant que telle, comme un test. Il y a un outil que le personnel subalterne utilise lorsqu'il sort. Par exemple, si un technicien médical devait sortir, son superviseur remplirait un rapport sur son progrès au cours de l'année. Mais en général, lorsque nous pratiquons, nous avons....
[Français]
Merci, monsieur le président.
Docteur Zamorski, avant d'être député, j'ai travaillé comme agent correctionnel. J'étais préventionniste en milieu carcéral. Au cours des dernières années, trois collègues, dont deux de mes amis, se sont suicidés, ce qui a eu un impact traumatisant sur tous les travailleurs.
Il a fallu arrêter de travailler parce que le traumatisme était trop élevé. Les gens étaient très touchés. On a réussi à obtenir que des travailleurs sociaux parlent aux gens. Or à force de leur parler, ces personnes se sont rendu compte que beaucoup de gens étaient extrêmement déprimés et que certains avaient eux aussi des tendances suicidaires. On a alors demandé qu'une étude soit réalisée, mais il y a évidemment eu de la résistance. On a présumé, parce qu'on n'a jamais obtenu de réponse, que c'était pour une question de coûts.
Je constate tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et je vois comme il est difficile d'être militaire. Les conditions peuvent être absolument aberrantes. Cela demande une force de caractère incroyable. Sur le plan spirituel et en termes de moral, ces personnes peuvent finir par être brisées.
Nous voyons toutes sortes de rapports. Certains disent que tout va bien et d'autres disent le contraire. Or vous soulevez un point important. Vous dites qu'il faut approfondir et non simplifier les choses, qu'il faut pousser l'étude plus loin. Selon vous, il faut obtenir des données plus pointues de façon à pouvoir faire une évaluation en profondeur.
Pourriez-vous me dire en quoi il serait dangereux de dire que tout va bien et qu'il faut continuer dans la direction actuelle?
[Traduction]
Dans le cadre de mes fonctions, je n'ai qu'une image superficielle de bien des gens. C'est la nature de mon travail, et c'est la nature du travail de quelqu'un qui mène des travaux de recherche sur la santé mentale de quelque 60 000 personnes. Je crois que nos cliniciens ont besoin de bien les comprendre, et je pense que c'est le cas. Ces personnes comprennent, mieux que quiconque, à quel point les choses sont compliquées et difficiles, à quel point chaque cas est particulier et complexe, et ils sont au courant de ce qui se passe dans la vie des gens.
J'accepte que ma vision des choses est toujours simplifiée à outrance, mais du point de vue scientifique, c'est ce que nous avons de mieux.
[Français]
Vous avez dit qu'il faudrait recueillir plus de données.
Avez-vous l'impression que les choses progressent et que des données sont recueillies? Nous sommes tout de même en Afghanistan depuis 2001.
[Traduction]
Il est clair que plus nous faisons de recherche, et plus cette recherche est de qualité, mieux ce sera. La prochaine enquête sur la santé mentale en est un bon exemple. C'est, au fond, la meilleure façon d'enquêter sur la santé mentale, c'est-à-dire d'obtenir le meilleur pourcentage de réponses possible.
Les employés de Statistique Canada forment un groupe compétent et exceptionnel capable d'obtenir d'excellents taux de réponse. Ils mènent des sondages extraordinaires; ils le font et procèdent à des analyses avec autant de soin qu'il est possible de le faire. Cela nous donnera une image très riche de la santé mentale. Mais l'image est toujours approximative; elle n'est jamais claire comme de l'eau de roche. Quels que soient les travaux de recherche que nous menons, ils soulèvent toujours des questions supplémentaires sur ce que nous avons besoin de faire, sur les autres choses à faire.
Comparativement à la vie civile, où il manque de recherche à ce sujet, surtout lorsqu'il est question de personnes en uniforme, voyez-vous un lien où l'un pourrait aider l'autre?
Si je puis me permettre, je pense que la population en général a beaucoup à apprendre de notre enquête sur la santé mentale. Dans les forces armées, nous avons éliminé presque tous ces obstacles structurels formidables qui font en sorte qu'il est très difficile pour les Canadiens de se faire soigner — pénurie de fournisseurs de soins de santé mentale, délais d'attente excessivement longs, impossibilité d'obtenir des services dans la langue dans laquelle ils sont le plus à l'aise, impossibilité de payer, problèmes de transport pour aller consulter. Ce sont tous des problèmes que nous avons réglés.
Voilà pourquoi, lorsque nous nous sommes penchés sur la question de l'obtention d'aide pour un trouble mental dans les FC, même en 2002, nos membres souffrant de troubles mentaux étaient plus susceptibles que leurs homologues civils de demander de l'aide pour les mêmes problèmes. Alors malgré ces obstacles spéciaux qui nous préoccupent, nos membres ont aussi un accès spécial à des soins. Je pense que les civils peuvent apprendre beaucoup de notre exemple.
De plus, si vous prenez ce que nous savons concernant la santé mentale de nos employés comparativement à l'employeur civil moyen au Canada, nous en savons tellement plus. Même si l'image que j'ai de la santé mentale dans les FC comme chercheur est loin d'être parfaite, elle est beaucoup plus claire que celle de Ford ou de BlackBerry, par exemple.
Merci, monsieur le président.
Merci à nos témoins.
Monsieur Zamorski, j'aimerais commencer avec vous. Vers la fin de votre exposé, vous avez mentionné que vous meniez des travaux de recherche supplémentaires. Dernièrement, il y a eu trois comités d'experts sur les lésions cérébrales, la prévention du suicide et la prévention de la violence en milieu familial.
J'aimerais approfondir un peu cette question: quel est le lien entre les BSO et la violence conjugale? Peut-être que vous pourriez nous donner de plus amples détails à ce sujet?
Il y a eu pas mal de recherche là-dessus. L’une des observations fréquemment formulées est qu'une victime de violence familiale risque de souffrir de troubles mentaux, dont le SSPT. C'est le principal lien entre la violence familiale et l'état de stress post-traumatique.
Cela étant dit, il existe un certain nombre d'études, dont des projets de recherche que nous avons menés nous-mêmes, qui montrent qu'il y a une corrélation entre le fait d'être en état de stress post-traumatique et dépressif et le fait, à la fois, de perpétrer des actes de violence familiale et d'en être victime. Je pense que la plupart des personnes dans le domaine qui ont étudié cette question reconnaissent l'existence d'un lien probable.
Cela dit, ce n'est qu'un facteur parmi tant d'autres qui influent sur la violence familiale. La personne moyenne qui souffre du SSPT n'a fait de mal à personne. Elle vit sa vie, du mieux qu'elle le peut. Quand nous parlons de ces sujets, je m'inquiète que les gens pensent que les membres des forces qui souffrent du SSPT sont de dangereux meurtriers suicidaires, ce qui est profondément injuste et pas du tout utile pour eux lorsqu'ils essaient de se réintégrer dans la société.
Alors, il existe un lien, mais ne le prenons pas hors contexte.
Vous présentez de bons arguments, car ce sont ces cas qui font la manchette, et tout à coup, les gens les prennent hors contexte et pensent qu'ils sont plus communs qu'ils le sont vraiment.
Si vous deviez faire une prédiction, que pensez-vous voir dans 10 ans chez nos soldats qui ont souffert du SSPT, en tenant compte de vos données américaines?
Malheureusement, je pense que les gains que nous avons réalisés au plan de la prévention des blessures physiques et du traitement des blessures au combat n'ont pas été égalés par des gains au plan de la prévention des traumatismes liés au stress opérationnel.
On peut dire que nous n'avons réalisé aucun progrès ou que, si nous en avons réalisé, nous n'avons aucun moyen de le prouver. Pour chaque conflit, nous retournons en arrière et disons: « Ah! Nous avons trouvé la solution ». Et à chaque fois, nous voyons toujours des tas et des tas de personnes souffrant du SSPT après le conflit.
Peut-être qu'un jour nous ferons des gains côté prévention. Je ne vois rien de récent qui pourrait avoir d'effet transformateur. Alors, par-dessus tout, nous continuerons de voir des BSO. De même, nos traitements s'améliorent graduellement d'année en année. Je ne vois pas de solution magique à l'horizon.
La plupart des gens souffrant d'une BSO s'en tireront bien. Certains d'entre eux se rétabliront complètement. Bon nombre d'entre eux se rétabliront en grande partie, au point de pouvoir vivre des vies riches et bien remplies et faire plein de choses, mais ils ne satisferont pas aux exigences relatives à la condition physique des militaires, qui sont extraordinaires. Et certains, malgré nos plus vaillants efforts, lutteront pour le reste de leur vie. Ce sera la minorité.
Je pense que cela est vrai aujourd'hui, et malheureusement, que ce le sera aussi dans 10 ans.
Pensez-vous que nous puissions jamais prévenir les blessures de stress opérationnel? Elles découlent de situations imprévisibles — d'EEI, d'un accident au combat dans le cadre duquel plusieurs de vos copains pourraient être tués, d'une gamme d'autres situations. Pensez-vous que nous pourrons un jour les prévenir?
Je pense qu'il y aura des mesures préventives qui seront efficaces, mais qu'elles le seront, au mieux, modérément. C'est ce que je suppose. Malheureusement, je ne crois pas que je verrai de prévention fiable du SSPT de mon vivant. La tâche est trop colossale.
Je pense que l'on s'efforcera principalement d'offrir des traitements plus tôt de façon à ce qu'ils soient meilleurs, plus fiables, plus complets et mieux tolérés. C'est faisable. Par-dessus tout, compte tenu des traitements que nous offrons qui, nous en convenons, ne sont pas parfaits, nous devons veiller à faire de notre mieux.
Merci, monsieur le président.
Au sujet des évacuations pour des raisons médicales et des cas urgents, c'est-à-dire quand la vie d'une personne est véritablement en danger, j'aimerais savoir s'il existe des procédures qui indiquent clairement comment l'évacuation doit se passer, qui accompagne la personne, ce qui doit être fait et s'il y a ou non une période de décompression.
Selon la recherche scientifique qui a été réalisée, comment peut-on faire en sorte que ces évacuations créent le moins de traumatisme possible chez les militaires évacués qui doivent être ramenés au pays?
[Traduction]
Habituellement, ces soldats partaient de l’endroit où ils étaient blessés — on passait les prendre et on les emmenait à l'installation médicale de rôle 3, lorsque nous étions à Kandahar. Nous allions ensuite de Kandahar à Bagram, qui est une autre installation de rôle 3. Elle est dirigée par des Américains. Ensuite, on les envoyait à Landstuhl, et de là, on les rapatriait. Il fallait parfois compter entre 48 et 72 heures. À partir de 2010, nous avons établi un poste de liaison à Bagram et depuis ce temps, nous avons toujours eu une équipe de soutien aux blessés à Landstuhl.
[Français]
Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir s'il y a une période de décompression entre ces deux étapes ou si, à l'intérieur d'une période de 72 heures, le militaire passe du champ de bataille à la maison.
La personne qui l'accompagne est-elle de grade équivalent ou supérieur? Ça n'a peut-être pas d'importance. Comment choisit-on la personne qui l'accompagne?
[Traduction]
Habituellement, cette personne n'était accompagnée que par l'équipe médicale. Une personne qui quittait Kandahar était prise en charge par une équipe américaine de transport aérien des patients aux soins intensifs qui passait la prendre. Jusqu'à 2010, nous avions ce premier poste de liaison à Bagram, mais le blessé n'était accompagné d'aucun Canadien avant d'arriver à Landstuhl.
Pour ce qui est de la période de décompression, il arrivait que le blessé ne se réveille même pas à Bagram. Je suis allée de l’endroit où la blessure a été infligée jusqu'à Landstuhl et au Canada. J'ai eu la chance de suivre tout ce processus. Je pense que la première fois était à Bagram. Parfois, le patient se réveillait et se pensait en Allemagne ou ne savait pas où il était. Après ma première période de service à Bagram, le plus extraordinaire, c'étaient les courriels que je recevais et dans lesquels les patients me disaient que la seule chose dont ils se souvenaient était d'avoir remarqué ma feuille d'érable et d'avoir été soulagés de voir mon uniforme. Il n'y avait pas de période de décompression en tant que telle.
Toute personne capable de répondre à des questions et d'être évaluée correctement, c'est-à-dire si elle n'est pas intubée ou sous forte médication, est soumise à un examen pour détecter une lésion cérébrale traumatique. Chaque personne qui passe par Landstuhl subit ce type d'examen avant de partir. Une fois rentrée au bercail, elle est envoyée dans l'hôpital le mieux placé pour la soigner dans la région la plus proche de celle où se trouve sa famille.
[Français]
Je ne parle pas ici de cas urgents où les gens sont inconscients. Je parle plutôt de cas de personnes souffrant de syndrome post-traumatique, par exemple, qui ne peuvent pas rester au combat et doivent être évacuées. Vous dites que seul du personnel médical est présent et qu'il n'y a pas de période de décompression, comme c'est le cas pour les autres militaires qui quittent le terrain. Ces personnes se retrouvent donc à la maison après 72 heures environ.
C'est sensiblement ce que vous dites?
[Traduction]
Si je comprends votre question, vous semblez vous souciez que les personnes évacuées pour raisons médicales reçoivent des services de décompression psychologique avant d'être rapatriées.
Est-ce bien ce qui vous préoccupe?
[Français]
J'essaie simplement de comparer la situation d'un militaire qui a vécu des événements traumatisants pendant sa mission, mais qui a terminé celle-ci, à celle d'un militaire qui a été évacué à cause d'un syndrome post-traumatique. J'aimerais savoir comment ça se passe.
Pour atténuer les symptômes, cette façon de procéder est-elle la meilleure? Ce sont les premières interventions à la suite de l'incident qui ont un impact majeur sur la façon dont la personne va composer avec le problème plus tard ou le surmonter.
Selon la recherche scientifique, est-ce que c'est la méthode d'évacuation pour des raisons médicales qui permet le plus aux militaires de composer éventuellement avec leurs symptômes? Sinon, pourrait-on procéder différemment?
[Traduction]
Je ne connais pas de recherche qui s'attache précisément à cet aspect de la procédure de rapatriement ou d'évacuation. L'on se soucie généralement de connaître les besoins médicaux des blessés. Ils reçoivent des soins médicaux, et toute l'équipe soignante, de l'infirmière au médecin, tient compte de leur état psychosocial. Ils peuvent consulter des spécialistes s'ils ont besoin de soins spécialisés. Et honnêtement, cet aspect n'est probablement pas le premier souci du personnel médical. Si les soldats ont des blessures qui mettent leur vie en danger, personne ne se soucie beaucoup du choc que pourrait leur causer la procédure de rapatriement. Le personnel soignant veille surtout à ce que les patients soient en sécurité et à ce que leurs besoins médicaux complexes soient comblés. C'est après coup, quand ils commencent à se stabiliser, que toute bonne équipe de traumatologie commence à tenir compte de leurs besoins psychologiques.
Et pour une personne qui serait rapatriée, qui n'a aucune blessure physique... Il arrive souvent que le diagnostic de SSPT ne soit pas vraiment confirmé dans le théâtre des opérations; le diagnostic est différent. Mais la personne n'est plus assez saine mentalement pour rester là-bas plus longtemps.
Nous les envoyons au Canada se faire soigner. La période de décompression que nous avons est très différente des soins que la personne reçoit. La priorité serait de faire en sorte que la personne rentre au bercail pour être soignée par des travailleurs de la santé mentale qui la prendraient immédiatement en charge.
Alors la période de décompression n'est pas ce qui compte le plus; le plus important, c'est vraiment de faire en sorte que le patient bénéficie sans tarder des soins dont il a besoin au Canada, car, pour sa sécurité, on ne peut pas le garder dans un environnement comme le théâtre des opérations.
Merci. Nous avons dépassé le temps que nous avions. Nous sommes à la demie.
Avez-vous un commentaire, monsieur Larose?
C'est un rappel au Règlement. Les témoins n'ont pas besoin de rester. Cela ne concerne que le comité.
J'ai une simple petite question. Je ne sais pas si vous en tiendrez compte, mais je suis conscient du fait que lorsque nous attendons que l'interprétation soit faite, cela peut prendre plus de temps. Disons que nous avons un témoin francophone. Si les anglophones ont du mal à comprendre, ils doivent attendre. Je me demandais si le président pourrait envisager d'allouer 30 secondes de plus pour que tout le monde puisse avoir la chance de tout entendre.
Madame Moore attendait aussi l'interprétation.
J'en tiens compte, et nous n'avons eu qu'une seule question qui a duré exactement cinq minutes; toutes les autres ont dépassé le temps alloué, et de beaucoup.
Je tiens à remercier nos témoins d'être venus. Major Compton, monsieur Zamorski, merci beaucoup de nous avoir fait part de votre expertise et de nous avoir aidés dans notre étude des soins offerts aux malades et aux blessés.
Sur ce, j'attends une motion pour lever la séance.
Une voix: Je la propose.
Le président: Alors partons.
Explorateur de la publication
Explorateur de la publication

