LANG Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
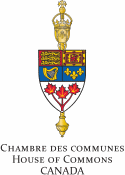
Comité permanent des langues officielles
|
l |
|
l |
|
TÉMOIGNAGES
Le lundi 6 mai 2024
[Enregistrement électronique]
[Français]
J'ouvre maintenant la séance.
Je vous souhaite la bienvenue à la 98e réunion du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes.
Conformément à l'article 108(3) du Règlement et à la motion adoptée par le Comité le mercredi 20 septembre 2023, le Comité reprend son étude sur le financement fédéral pour les institutions postsecondaires des minorités de langue officielle.
Étant donné les changements suggérés concernant la manipulation des oreillettes, entre autres, je vais prendre un peu de temps pour revoir les consignes, et ce, afin d'éviter les incidents acoustiques. Avant de commencer, j'aimerais rappeler à tous les députés et aux autres participants présents dans la salle les importantes mesures préventives indiquées dans le communiqué envoyé le lundi 29 avril par le Président de la Chambre à tous les députés.
Les mesures suivantes ont été prises pour aider à prévenir les incidents acoustiques perturbateurs et potentiellement dangereux puisque susceptibles de causer des blessures.
Les participants doivent toujours tenir leur oreillette loin de leur microphone. Toutes les oreillettes ont été remplacées par un modèle qui réduit considérablement la probabilité d'un incident acoustique. Les nouvelles oreillettes sont noires, alors que les anciennes étaient grises. Veuillez utiliser uniquement celles qui sont noires et approuvées. Par défaut, toutes les oreillettes inutilisées au début d'une réunion seront débranchées. Lorsque vous n'utilisez pas votre oreillette, veuillez la placer face vers le bas, au milieu de l'autocollant sur la table, comme l'indique l'image. Veuillez consulter les cartes sur la table pour connaître les lignes directrices sur la prévention des incidents acoustiques. La disposition de la salle a été adaptée de façon à augmenter la distance entre les microphones, ce qui permet de réduire le risque de retour de son.
Ces mesures ont été mises en place afin que nous puissions exercer nos activités sans interruption et afin de protéger la santé et la sécurité de tous les participants, y compris les interprètes. Je prends le temps de le mentionner, parce que nous avons récemment appris que les problèmes acoustiques causant des blessures aux interprètes existent depuis bien avant la pandémie, et ne sont pas nécessairement causés par les plateformes Zoom ou Teams. En fait, il s'agit plutôt de blessures qui arrivent en salle de comité, avec l'équipement qui s'y trouve.
Lorsque je vous donne la parole, et seulement à ce moment, le micro va s'allumer pour que vous puissiez parler, afin d'éviter que plusieurs personnes parlent en même temps.
On m'indique à l'instant qu'il y a un problème d'interprétation. Nous allons donc suspendre brièvement la séance.
Nous reprenons maintenant la séance, puisque le problème semble avoir été résolu.
Monsieur Carrie, je vous souhaite la bienvenue au Comité.
Conformément à notre motion de régie interne, je souhaite informer le Comité que tous les témoins qui participent à la réunion par vidéoconférence ont effectué les tests de son requis avant la réunion.
J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue aux témoins qui participent à la première heure de notre étude. Nous accueillons Mme Stéphanie Chouinard, professeure au Collège militaire royal, Université Queen's, ainsi que M. Zundel, président‑directeur général du Collège communautaire du Nouveau‑Brunswick, qui participe à la réunion par vidéoconférence. Comme ce sont des habitués du Comité, ils savent comment les choses fonctionnent.
Madame et monsieur, vous avez un maximum de cinq minutes chacun pour faire votre allocution d'ouverture. Par la suite, nous passerons aux questions des membres. Je vous rappelle que je suis très sévère pour ce qui est du temps de parole, parce que ça nous permettra de compléter deux tours de questions. Je vous demande donc de respecter le temps imparti.
Madame Chouinard, vous avez maintenant la parole pour cinq minutes.
Messieurs le président et les vice-présidents, chers membres du Comité, merci de me recevoir aujourd'hui pour discuter du financement des établissements postsecondaires de langue française en situation minoritaire.
J'aimerais attirer votre attention sur les nouvelles obligations du gouvernement fédéral en vertu de la partie VII de la Loi sur les langues officielles et, surtout, sur la façon dont celle-ci sera mise en œuvre. Mon allocution va porter sur trois éléments: le partage des compétences, la pérennisation du financement et le renforcement de nos établissements.
Premièrement, bien que le domaine de l'éducation postsecondaire soit désormais nommé explicitement dans la Loi comme étant l'un des domaines névralgiques pour la vitalité de nos communautés, il demeure en premier lieu un domaine relevant de la compétence des provinces. Il est donc primordial à mon sens que le fédéral s'entende avec les provinces pour s'assurer que le financement fédéral demeure un financement supplémentaire et qu'il ne crée pas un désinvestissement proportionnel des provinces vis-à-vis des établissements en situation minoritaire, ce qui aurait pour effet de nous ramener à la case départ. Il faudrait également s'assurer que le financement est fourni au moment promis, afin que les établissements puissent faire une gestion adéquate de leurs ressources. Enfin, il faudrait s'assurer que le financement accordé correspond aux besoins des établissements qui servent nos communautés, ce qui nécessite qu'elles participent aux négociations fédérales-provinciales.
Comme on le sait depuis longtemps, le Programme des langues officielles dans l'enseignement est un outil de distribution du financement franchement imparfait qui permet des abus de la part de certaines provinces, qui réaffectent des fonds pour du financement de base ou qui ne tiennent pas compte des priorités communautaires dans la façon dont les fonds sont dépensés. Essayons d'apprendre de nos erreurs et de nous assurer que les fonds publics qui seront consacrés au postsecondaire seront utilisés à bon escient.
Deuxièmement, pour avoir un effet concret, ce financement devra être pérennisé. Des assises solides dans le domaine postsecondaire, ça ne se bâtit pas en faisant du financement par projet. On ne peut pas mettre sur pied des laboratoires ou des programmes qui auront un effet réel si on n'a pas la certitude d'avoir le financement pour les faire vivre plus de quatre ou cinq ans.
Il serait également difficile de parler du financement sans parler de la question des étudiants étrangers. N'en déplaise au ministre Miller, les établissements de la francophonie canadienne ne sont pas responsables en grande partie des abus du système dont nous sommes témoins. Ce ne sont pas eux, les mauvais joueurs, et pourtant, ils sont punis aussi sévèrement que les autres établissements. Pire encore, la décision du ministre de ne pas créer une exception pour ces établissements à l'égard du plafonnement des permis va à l'encontre des priorités de son ministère, si l'on en croit la Politique en matière d'immigration francophone.
Admettons également que, si on donnait aux établissements francophones les moyens d'être aussi concurrentiels sur le marché des études postsecondaires que les établissements de la majorité, ils auraient besoin de moins de financement supplémentaire de la part du fédéral. Je salue les membres de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne pour la plainte qu'elle a déposée au Commissariat aux langues officielles à ce sujet. Sans vouloir me prendre pour le commissaire Théberge, j'espère vivement que cette plainte sera considérée comme étant fondée.
Enfin, dans le cas de la nouvelle mouture de la partie VII de la Loi sur les langues officielles, comme dans le Plan d'action pour les langues officielles 2023‑2028, on fait mention du besoin de protéger et de promouvoir les établissements forts de la communauté. Je vous invite à commencer à réfléchir aux indicateurs qui détermineront ce qui constitue au juste un établissement fort en milieu postsecondaire. Cette terminologie suscite des craintes pour certains de nos établissements existants, qu'on pourrait difficilement qualifier de forts puisqu'ils sont fragilisés entre autres par un manque de financement chronique. Pourtant, ces établissements sont nécessaires, car ils sont souvent les seuls au sein de leur communauté à offrir une formation en français.
Comment la nouvelle mouture de la Loi tiendra-t-elle compte de leur réalité sur le terrain, y compris leur multiplicité d'arrangements de gouvernance, entre autres, certains de nos établissements n'étant pas des établissements homogènes francophones ou entièrement autonomes? Pensons au Bureau des affaires francophones et francophiles affilié à l'Université Simon Fraser ou au Collège Glendon, affilié à l'Université York, par exemple.
En somme, je crois qu'il faut réfléchir à la façon dont on déterminera qui mérite du financement et pour quelles raisons, afin de réellement soutenir l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire.
Je vous remercie. Ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous.
Merci, madame Chouinard. Vous avez fait votre discours en quatre minutes, ce qui est parfait.
Monsieur Zundel, vous avez la parole pour cinq minutes.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Chers députés, je vous remercie de la possibilité de témoigner devant vous aujourd'hui au nom du Collège communautaire du Nouveau‑Brunswick, le CCNB, concernant le financement fédéral des institutions postsecondaires de la minorité de langue officielle.
Le CCNB compte plus de 90 programmes d'études et accueille cette année quelque 2 324 étudiants. En cultivant un environnement inclusif et diversifié, le CCNB contribue de manière considérable au développement démographique, économique, social et culturel de la province du Nouveau‑Brunswick.
Vous êtes sans doute déjà au courant que le délai de signature d'une nouvelle entente de financement fait en sorte que nous sommes en attente pour les détails des fonds nous provenant du Programme des langues officielles dans l'enseignement. Notre entente de financement de base a pris fin en mars 2023, et, depuis ce temps, on nous a informés d'une prolongation de l'entente à deux reprises. Par conséquent, nous n'avons pas d'information sur les fonds qui nous seront accordés dans le cadre de l'entente — qui devait être renouvelée en 2023 — et sur la distribution des fonds déterminés dans le plan d'action pour les langues officielles pour les institutions postsecondaires.
Ces fonds fédéraux ont une importance cruciale pour notre établissement. Ils nous permettent notamment de faire un important exercice de modernisation de nos systèmes internes, ainsi qu'un important exercice de transformation de nos programmes d'études et de l'offre de services pour appuyer le recrutement et la rétention de notre population étudiante. Grâce à ces fonds, nous avons entrepris une transformation importante de nos programmes d'études en adoptant une approche centrée sur le développement des compétences. En plus de rehausser le profil de compétences de nos diplômés, cette approche nous permet une plus grande flexibilité dans la prestation de programmes, notamment en offrant des microcertificats qui, ajoutés les uns aux autres, aboutissent à une certification complète dans une même discipline, ou encore en servant plusieurs cohortes d'un même programme simultanément.
Ultimement, ça nous permet de mieux répondre aux besoins des employeurs en permettant à nos étudiants de maintenir leur emploi en entreprise tout au long de leurs études, et de fournir un plus grand nombre de diplômés par année, prêts à intégrer rapidement le marché du travail. Les étudiants y trouvent aussi leur compte, car c'est un grand avantage pour eux de pouvoir mieux jumeler leur formation à leur capacité de travailler.
Notre collège fournit de la formation sur cinq campus, répartis dans les régions francophones du Nouveau-Brunswick. La prestation de programmes collégiaux en milieu rural présente des défis particuliers. Les économies d'échelle, plus facilement réalisables dans les zones urbaines, sont difficiles à faire dans nos milieux ruraux. Nos coûts fixes restent élevés, tandis que nos revenus sont limités par le nombre d'étudiants que nous pouvons admettre dans nos programmes.
Par conséquent, la formule de financement actuelle et la lenteur des confirmations nous empêchent d'avancer pleinement dans le virage de modernisation et freinent notre capacité de développement et de mise en œuvre de nos pratiques d'efficience. Elles mettent aussi à risque l'expérience étudiante au sein du CCNB. C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions voir le financement des projets spéciaux intégrés aux fonds de base des établissements, afin d'éviter ce genre de problème à l'avenir.
Finalement, comme votre étude porte aussi sur l'influence de l'accueil des étudiants internationaux, je tiens à vous exposer une nouvelle réalité de notre établissement. Traditionnellement, les étudiants collégiaux néo‑brunswickois ont une forte tendance à ne pas se déplacer à plus de 80 kilomètres de leur lieu de résidence pour s'inscrire à nos programmes. Ils préfèrent souvent changer de programme plutôt que changer de région, ce qui s'explique soit pour des raisons financières, soit en raison de complications dans leur vie ou de la présence d'enfants à la maison. L'un des défis importants pour nous concernant les étudiants internationaux est le fait que ces derniers ont besoin d'un logement, alors que nos étudiants canadiens n'en ont pas besoin. Cela nous demanderait donc un investissement important dans des résidences.
Sur ce, je termine ma présentation et je serai heureux de répondre à vos questions.
Merci, monsieur Zundel.
Nous allons commencer le premier tour de questions. Chacune des formations politiques disposera de six minutes.
Je cède la parole au premier vice-président de ce comité, M. Godin, du Parti conservateur du Canada.
Merci, monsieur le président.
J'aimerais que vous arrêtiez le chronomètre, parce que je vais profiter de l'occasion pour déposer une motion. Je pense que vous l'avez reçue vendredi après-midi. Nos témoins sont probablement au fait de ce genre de procédure à la Chambre des communes.
Je dépose cette motion en raison des actualités de la semaine dernière et du constat qui a été fait concernant le ministre des Langues officielles. Malheureusement, lui et sa firme reçoivent des sommes d'argent en lien avec des activités de lobbyisme. Je pense que le ministre des Langues officielles est juge et partie.
La motion se lit comme suit:
Que, étant donné les récentes allégations selon lesquelles le ministre Randy Boissonnault a tenté de cacher qu'il recevait des paiements de son cabinet de lobbying alors que celui-ci faisait du lobbying auprès de son propre gouvernement et qu’il était en poste comme ministre des Langues officielles, qui relève de ce Comité, le Comité invite le ministre à témoigner pour un minimum de deux heures.
On aurait pu inviter la ministre du Patrimoine canadien, mais elle n'accepte pas nos invitations. Ce qu'elle prétend, c'est que le ministre…
L'avis de motion a été déposé, monsieur le président, et je suis en train de défendre l'importance de la motion.
On sait que l'aéroport international d'Edmonton a reçu plus de 100 millions de dollars à la suite d'activités de lobbyisme de la firme qui est en partie la propriété du ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles. Je pense qu'il serait pertinent qu'on puisse entendre ce ministre, ici, au Comité…
… permanent des langues officielles, et qu'on puisse lui poser des questions. Je pense qu'il serait pertinent…
Un instant, s'il vous plaît, monsieur Godin.
Quelque chose sonne dans nos oreillettes. Je vais demander aux gens d'éteindre leur téléphone, parce que c'est vraiment un problème. Les difficultés relatives aux blessures auditives des interprètes viennent des salles de comité, pas d'ailleurs. Il faut faire attention.
Monsieur Serré, souhaitez-vous invoquer le Réglement?
Il faut cesser de parler tous en même temps et respecter ce qui est dit.
Monsieur Godin, quelqu'un a invoqué le Règlement: nous allons écouter ce rappel au Règlement, puis je vous redonnerai la parole.
Merci, monsieur le président.
Je voulais juste être certain que M. Godin se rend compte que nous avons des témoins…
Monsieur Serré, un instant, s'il vous plaît.
Je demande à tout le monde de ne pas prendre la parole avant que je la leur donne.
Monsieur Godin, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Ce n'est pas vous, le problème, mais faites attention: un micro allumé peut créer ce qu'on appelle l'effet Larsen.
Monsieur Serré, je suis désolé, mais ce que vous venez de dire n'est pas un rappel au Règlement.
Monsieur Godin, veuillez continuer.
Je pense que le Comité permanent des langues officielles est l'endroit pour débattre de la question que j'ai soulevée. C'est pourquoi je dépose cette motion, qui propose de convoquer le ministre afin qu'on puisse lui poser des questions.
Il est juge et partie, car il fait partie d'un gouvernement qui alloue de l'argent. C'est un peu comme le ministre Duclos, dont l'emploi à l'Université Laval est protégé alors qu'il donne de l'argent à l'Université à titre de ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. Je pense que les gens ont le droit de savoir ces choses.
J'aimerais donc proposer cette motion et savoir si mes collègues souhaitent connaître la vérité par rapport à cette situation.
Je respecte toujours les motions qui sont présentées par mes collègues.
Toutefois, je sais que le ministre des Langues officielles n'est pas à l'origine de la transaction, parce qu'il est un homme honorable. Comme toute personne loyale le sait, un député, un ministre ou un lobbyiste n'a pas le droit d'utiliser des fonds alloués. C'est complètement illégal. Je sais que mon collègue M. Boissonnault, qui est très conscient des règles, le saurait, parce que la loi a changé en 2006, alors que M. Harper était au pouvoir. Je suis certain qu'il a vérifié. Étant moi-même secrétaire parlementaire, je suis assujetti à des règles que je dois suivre chaque année, notamment quant aux personnes avec qui je fais affaire, à mes avoirs et à mes dettes. Je rapporte tout au commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.
Je ne vois pas en quoi cette question aurait un rapport avec le Comité permanent des langues officielles. S'il s'agit d'une question d'éthique, je ne pense donc pas qu'il revienne au Comité permanent des langues officielles d'en débattre, à moins que la transaction ait eu lieu dans le cadre d'un contrat dont les fonds sont administrés ou attribués par le ministère des Langues officielles. Je sais que le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique, ou ETHI, va peut-être s'en occuper.
Permettez-moi de mentionner que les communautés en situation de langue minoritaire ont de grands besoins. Je respecte M. Boissonnault, mais la situation qui le concerne en ce moment ne constitue pas un de ces besoins. Le comité ETHI devra se faire son opinion à ce sujet. S'il y a un problème, nous devrions peut-être laisser le commissaire à l'éthique se prononcer, mais ce n'est pas l'affaire du Comité permanent des langues officielles.
Je respecte mon collègue M. Godin. Nous nous entendons très bien sur la défense de la francophonie au niveau international, sujet sur lequel nous sommes toujours d'accord. Cependant, au Comité des langues officielles, nous nous obstinons parfois.
En conclusion, pourrions-nous mettre la situation de M. Boissonnault de côté et en débattre à un autre moment, quand il n'y aura pas de témoins devant nous?
Merci, monsieur Drouin.
J'ai pris connaissance de la motion quand nous l'avons reçue. J'ai fait mes devoirs, vous vous en doutez bien. Je suis prêt à trancher sur cette motion, mais je suis prêt à entendre d'autres personnes qui aimeraient se prononcer.
Monsieur Godin, souhaitez-vous réagir?
Monsieur le président, je veux souligner deux choses.
D'abord, mon collègue M. Drouin a mentionné que la situation relevait du comité ETHI. Or, l'un n'empêche pas l'autre. Il est vrai que le comité ETHI doit analyser la situation, mais je suis d'avis que le Comité permanent des langues officielles peut le faire aussi, parce que le ministre des Langues officielles est, selon Patrimoine canadien, le ministre responsable de faire appliquer la Loi sur les langues officielles.
Il peut y avoir un conflit d'intérêts, comme il a été mentionné dans l'article de Global News, parce que la firme Xennex Venture Catalysts a été dénoncée par le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Une autre compagnie de l'Alberta, Navis Group, dont je vous fais grâce du numéro de matricule, verse de l'argent au ministre. Il y a donc matière à interrogation et je crois que les Canadiens doivent savoir ce qu'on fait avec leur argent. Je pense qu'il est important que les communautés de langue officielle le sachent.
Les ministres perdent-ils de l'argent ou en gagnent-ils? Je ne peux l'affirmer puisque je n'ai pas l'information pour répondre à cette question. Par contre, je pense qu'il serait pertinent que les ministres comparaissent devant nous pour nous l'expliquer.
Merci, monsieur le président.
J'approuve tous les commentaires de mon collègue M. Drouin. Je ne vais donc pas perdre de temps à continuer le débat sur cette motion et j'aimerais que nous passions au vote.
En fait, j'aimerais d'abord trancher sur la motion, madame Koutrakis. Nous allons finir d'entendre les commentaires des personnes qui avaient levé la main. Ensuite, je vais me prononcer et nous verrons s'il doit y avoir un vote ou non.
Madame Kusie, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Je comprends les commentaires de M. Drouin, mais il reste que M. Boissonnault est encore le ministre des Langues officielles. À ce titre, il doit donc assumer ses responsabilités. Même si la situation aura des répercussions sur un autre comité, qui devra s'y pencher, le ministre doit prendre ses responsabilités et se présenter devant nous pour nous expliquer de quoi il retourne. C'est son comité autant que le nôtre.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Merci.
Toutes les interventions tournent autour d'allégations en matière d'éthique, mais ce n'est pas à nous de trancher si elles sont recevables ou non.
Je veux revenir sur le mandat de notre comité, qui est très court. Je vais le lire textuellement. Le mandat du Comité permanent des langues officielles « […] comprend notamment l'étude des politiques et des programmes de langues officielles, y compris les rapports annuels du Commissaire aux langues officielles qui sont réputés renvoyés en permanence au Comité dès qu'ils sont déposés sur le Bureau, et la présentation des rapports à ce sujet ».
Il faudrait donc beaucoup étirer l'élastique pour faire entrer dans ce mandat des comportements pouvant ou non donner lieu à des accusations en matière d'éthique, surtout qu'il y a déjà un comité parlementaire qui traite de l'éthique. J'ai bien entendu tout le monde. Je sais de quoi nous parlons, mais ça ne correspond aucunement, ni de près ni de loin, au mandat de ce comité.
J'affirme donc que cette motion est irrecevable. Si la situation doit être étudiée, ça doit se passer ailleurs. J'ai tranché.
Monsieur Godin, la parole est à vous.
Avant que vous vous prononciez, j'allais justement dire qu'une procédure existe si on veut contester la décision d'un président de comité. Comme vous le savez, si ma décision est cassée, le sujet sera renvoyé à la Chambre des communes.
Je vous redonne la parole.
J'aimerais que vous entamiez cette procédure. Je respecte la présidence, mais je suis en désaccord avec votre décision. Je fais donc appel de la décision de la présidence.
C'est parfait. Merci, monsieur Godin.
Nous allons procéder à un vote par appel nominal sur la question suivante: la décision de la présidence est-elle maintenue?
(La décision de la présidence est maintenue par 7 voix contre 4.)
Nous continuons.
Monsieur Godin, vous aviez parlé sept secondes, si ma mémoire est bonne. En fait, vous aviez parlé 8 s 38. Vous avez la parole.
Monsieur le président, je vous remercie d'avoir respecté la procédure de la Chambre des communes.
Madame Chouinard et monsieur Zundel, veuillez nous excuser d'avoir tenu cette procédure. Cependant, c'est un outil que nous avons et nous nous devons, comme parlementaires, d'utiliser tous les outils à notre disposition.
Madame Chouinard, vous avez parlé d'indicateurs dans votre présentation. Pouvez-vous les définir? Quelles en sont les répercussions sur l'évaluation, par la suite?
Je vous remercie de la question.
C'est en fait une question dont j'espère que les parlementaires vont se saisir. La partie VII de la nouvelle mouture de la Loi sur les langues officielles mentionne que le gouvernement va promouvoir et protéger les institutions fortes de la communauté. Dans le contexte du processus de réglementation qui vient de commencer, il est essentiel de déterminer les éléments permettant d'établir si une institution est forte ou non. Or, il existe une logique qui est peut-être perverse à ce vocabulaire, en ce sens que beaucoup d'institutions — dont nos communautés dépendent pour des rapports de proximité, comme l'a expliqué M. Zundel — sont les seules de leur province à offrir une éducation postsecondaire en français et ne sont pas nécessairement des institutions fortes.
Objectivement, comment allons-nous établir ce qu'est une institution forte? Subséquemment, si on suit la logique de la Loi, qui méritera le financement de la part du gouvernement fédéral? Des questions très importantes doivent être examinées.
Monsieur Godin, je vous interromps en arrêtant le chronomètre.
Je veux simplement dire aux membres du Comité qu'un vote doit se tenir dans 28 minutes à la Chambre. Y a-t-il consentement unanime pour poursuivre la séance jusqu'à une minute avant le vote, puisque nous pouvons tous voter par voie électronique?
Arrêtons-nous cinq minutes avant, monsieur le président. Les gens qui veulent voter en personne doivent avoir ce privilège.
C'est correct.
Soit, je vous préviendrai cinq minutes avant le vote et nous suspendrons la séance pendant le vote.
Monsieur Godin, nous reprenons. Vous avez écoulé 1 min 58 s 19 de votre temps de parole.
Merci, monsieur le président.
Madame Chouinard, avez-vous des définitions pour les indicateurs? Vous avez cerné le problème. Maintenant, êtes-vous capable de fournir des pistes qui nous permettraient, comme législateurs, de définir des indicateurs visant l'efficacité et le rendement?
L'une des premières choses que je vous suggérerais de faire serait de chercher à savoir ce que les communautés de proximité en pensent.
Par exemple, quels sont les besoins sur le terrain? En quoi les institutions sur place sont-elles en mesure de répondre aux besoins? De quoi auraient-elles besoin pour être capables de répondre à la demande sur le terrain? Quelles sont les institutions que ces communautés souhaiteraient voir sur place?
Il faut aussi savoir à quel point les institutions sont fortes ou non. Mentionnons, par exemple, l'Université de Sudbury, qui peine à émerger, comme vous le savez. Comment peuvent-elles devenir fortes? Pour être en mesure de le déterminer, il faut tenir compte des communautés qui sont servies par ces institutions.
Tout cela ferait certainement partie des indicateurs que je regarderais.
Vous avez également dit, lors de votre allocution d'ouverture, que nous devrions faire en sorte que les provinces et les territoires investissent dans ces institutions et que leur financement soit mieux dirigé. C'est ce que j'ai compris. Comme vous le savez, on joue sur différentes compétences provinciales, territoriales et fédérales.
Je sais que vous témoignez aujourd'hui à titre personnel. Vous avez un bagage d'expérience qui nous est précieux et c'est pourquoi je vous pose la question suivante. Êtes-vous en mesure de nous dire comment nous pouvons nous y prendre, nous, au gouvernement fédéral, pour exhorter les provinces et les territoires à être réalistes dans leurs investissements, à être sérieux et rigoureux, et à fournir leur financement de façon récurrente?
Nous sommes d'accord avec vous. Cependant, comment pouvons-nous nous y prendre, comme législateurs, pour conclure des ententes nécessaires et efficaces pour y arriver?
Je sais que je ne suis pas la première à poser cette question au sujet du financement, de toute évidence. Il est primordial de tenir des négociations qui mènent à des ententes où les priorités sont bien établies et de s'entendre, de part et d'autre, sur une reddition de comptes sur les montants et la destination des fonds investis. Il faut également que les provinces n'inventent pas des priorités pour la communauté, que les communautés elles-mêmes soient consultées, et que ces fonds soient dirigés là où c'est nécessaire.
Nous avons mené une étude sur le projet de loi C‑13, mais, à mon avis, ce dernier n'a pas assez de mordant. Jugez-vous que la nouvelle Loi sur les langues officielles contient les outils nécessaires pour améliorer l'éducation postsecondaire au Canada pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire?
Je pense qu'il s'agit d'un bon début. Cela dit, je pense aussi que la prochaine étape, la façon dont ce sera mis en œuvre et ce qui va découler de ce processus, est cruciale. Je reviens encore une fois à la réglementation en vertu de la partie VII, pour laquelle il reste à expliciter noir sur blanc un paquet d'éléments, afin que les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux sachent à quoi s'en tenir, notamment en matière de reddition de comptes.
Vous dites qu'il s'agit d'un bon début. Ça m'inquiète, parce qu'il y a urgence d'agir pour contrer le déclin du français. On va être pris avec cette loi pour les 10 prochaines années. N'êtes-vous pas inquiète?
On peut avoir la meilleure loi du monde, mais on n'avancera certainement pas si les législateurs, vous tous, ne sont pas prêts à la mettre en oeuvre de la façon qu'elle a été pensée.
Merci, monsieur Godin et madame Chouinard.
La prochaine intervenante est Mme Koutrakis, du Parti libéral du Canada, pour six minutes.
Merci, monsieur le président.
Je remercie les témoins d'être ici aujourd'hui.
Professeure Chouinard, vous avez écrit maints articles savants dans les deux langues officielles. Quand on souhaite en écrire un, il faut non seulement en choisir le thème, mais aussi trouver une revue pour le publier. Selon vous, existe-t-il plus de revues savantes anglaises que françaises? Si oui, cela vous encourage-t-il à publier plus de recherches en anglais? Vous pouvez aussi parler de ce qu'il en est pour vos pairs.
Merci de la question.
Il y a trois volets à ma tâche de professeure. Premièrement, il y a l'enseignement, ce que savent M. et Mme Tout‑le‑Monde puisque leurs enfants sont à l'université, par exemple. L'enseignement représente à peu près 40 % de la tâche d'un professeur. Le deuxième volet est celui de la recherche, qui représente un autre 40 % de la tâche. Troisièmement, il y a les tâches qu'on considère comme des services à la communauté, ce qui peut être interprété de façon large.
La partie consacrée à la recherche passe souvent sous le radar, mais cette dernière est fondamentale pour que les universités fonctionnent bien. Dans le soutien aux établissements postsecondaires francophones, il sera fondamental de considérer cet aspect du travail universitaire. Je parle ici de la recherche, mais aussi de la recherche en français, et pas seulement de la recherche en français sur les communautés francophones, mais aussi dans n'importe quel domaine, comme la biologie ou la psychologie.
Continuer à faire de la recherche en français est un choix politique. C'est vrai au Canada, et c'est aussi vrai dans n'importe quel établissement francophone du monde. En effet, depuis les 50 dernières années, la science s'anglicise. En 1973, si je ne me trompe pas, le commissaire aux langues officielles faisait déjà ce constat. Nous sommes en 2024, et ce constat tient encore la route. Il est sûr que ça continue d'être un défi.
Au Canada, il y a un écosystème de recherche en français, surtout dans le registre des sciences sociales. J'ai d'ailleurs un peu de chance à ce sujet, comparativement à mes collègues des sciences pures. Quand on travaille comme moi dans des établissements anglophones ou bilingues, il est particulièrement difficile de défendre le fait de publier en français quand on veut être promu dans le cadre de ses fonctions universitaires. En effet, l'auditoire est moins large, les revues francophones sont moins prestigieuses, et le fameux facteur d'impact est moins grand. Publier en français, c'est un choix qu'on continue à faire. On peut être stratégique et choisir de publier certains éléments en français ou en anglais, selon l'auditoire auquel on veut porter certains messages de nos travaux. Toutefois, il n'en demeure pas moins que ça a des conséquences sur notre avenir personnel et professionnel.
Merci beaucoup.
Monsieur Zundel, en matière de langues officielles, nous parlons souvent du fédéral et du rôle qu'il a à jouer dans ce domaine, comme le sujet de l'étude actuelle. Pourtant, le fédéral n'est pas le seul acteur. Les provinces ont en fait le rôle le plus important en ce qui concerne l'éducation postsecondaire.
Pouvez-vous nous parler du financement de source provinciale que reçoit votre établissement?
Certainement.
Nous recevons du financement de base de la province pour offrir nos services essentiels, ainsi que du financement par projet qui nous permet d'investir dans des innovations pédagogiques ou technologiques. Nous recevons aussi du financement d'immobilisation. En effet, le Collège communautaire du Nouveau‑Brunswick est peut-être un cas plus rare au Canada, car nous sommes une société d'État. Les infrastructures physiques n'appartiennent donc pas au Collège, mais à la province. Le Collège est aussi assujetti à un régime différent de ceux des autres provinces en ce qui a trait aux négociations syndicales et aux augmentations salariales, par exemple.
Pour avoir travaillé dans d'autres provinces auparavant, je sais que le régime du Nouveau‑Brunswick est un peu plus favorable pour le Collège que ceux qu'on retrouve dans d'autres provinces du pays, qui pourraient par exemple ne pas assurer une augmentation des allocations de base selon des conventions collectives négociées avec les employés, contrairement au Nouveau‑Brunswick.
D'après vous, ce que vous avez reçu jusqu'à présent est-il suffisant? Sinon, comment pourrait-on faire mieux, que ce soit du côté fédéral ou provincial?
Du côté provincial, si on tient compte des frais de scolarité, qui ont beaucoup augmenté avec l'arrivée d'un plus grand nombre d'étudiants internationaux, le financement de base que nous recevons est suffisant pour assurer nos services essentiels. Cependant, comme ma collègue Mme Chouinard et moi y avons fait allusion, il est primordial de sortir du modèle où le financement est épisodique pour, par exemple, passer à un financement octroyé sur une plus longue période.
Dans le contexte actuel, je ne vous cacherai pas qu'il est beaucoup plus difficile de trouver du personnel pour offrir des programmes et entreprendre des projets. C'est encore plus difficile lorsque c'est pour des projets qui ne durent qu'un an ou deux. Si on nous assurait un financement à plus long terme, d'une part, nous pourrions faire une meilleure planification et, d'autre part, il serait plus facile de recruter le personnel nécessaire pour mettre en œuvre les programmes.
Un des problèmes que nous avons eus…
Merci, monsieur Zundel. C'est tout le temps que nous avions, car je dois passer aux prochains intervenants. J'entends la cloche sonner et je veux m'assurer que tout le monde aura la chance de poser des questions au moins une fois.
Monsieur Beaulieu, du Bloc québécois et deuxième vice-président de ce comité, vous avez la parole.
Merci, monsieur le président.
Je remercie également nos invités.
Madame Chouinard, en 2021, lorsque vous avez comparu devant le Comité, vous avez affirmé que l'éducation postsecondaire dans la francophonie canadienne était en crise. Considérez-vous qu'il y a eu une amélioration ou une détérioration de la situation, depuis ce temps?
Je pense que la situation s'est détériorée.
En 2021, l'Université Laurentienne traversait une crise et le gouvernement Ford avait pris la décision de ne pas financer l'Université de l'Ontario français. Ce second dossier a finalement été réglé. Cependant, à cet effritement de l'offre qu'on observait déjà à l'époque s'est ajoutée aujourd'hui la question des étudiants étrangers, un défi dont on parle en coulisses et qu'a soulevé M. Zundel.
Quand on étudie la provenance de ces étudiants, qu'on perd de vue à la suite de leur admission, on constate que la très grande majorité d'entre eux n'étaient pas inscrits dans des établissements francophones, et encore moins dans des établissements de la francophonie en situation minoritaire. C'est un fait.
L'Université de Moncton et l'Université Sainte‑Anne, deux établissements que je connais mieux personnellement, chérissent leur relation avec les étudiants étrangers, qu'elles veulent suivre et voir réussir. Elles ne les voient pas comme des gens qu'on invite au Canada pour ensuite les perdre de vue. La décision du ministre de l'Immigration de ne pas faire d'exception pour de tels établissements, qui ont déjà beaucoup plus de difficulté à recruter des étudiants que les établissements anglophones majoritaires, nuit fondamentalement à leur réussite.
Il me semble qu'il aurait été tout à fait possible et souhaitable de mettre en place des mesures pour permettre l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers dans les universités francophones, surtout à l'extérieur du Québec.
Oui, absolument. En vertu de la partie VII de la nouvelle Loi sur les langues officielles, le ministre avait tout à fait le pouvoir de créer une telle exception, notamment pour tenir compte du fait qu'un établissement francophone en situation minoritaire, avant même la décision du ministre de plafonner le nombre de visas octroyés à des étudiants étrangers, avait besoin de deux fois plus de dossiers d'inscription qu'un établissement anglophone pour finir par avoir le même nombre de fesses sur les sièges de ses salles de classe.
Quand on examine la situation, on observe qu'il y a en même temps un déclin du français au Canada, surtout hors Québec.
Il y a un genre de laisser-aller et d'indifférence de la part du gouvernement. De temps en temps, il a de belles intentions, mais il ne prend pas assez de mesures pour contrer ce déclin. Ne devrait-il pas avoir un argumentaire qui dénonce davantage la situation?
En parallèle, le concept voulant qu'un service soit offert quand le nombre de personnes le justifie oblige un peu les communautés francophones acadiennes à gonfler leurs chiffres pour avoir plus de services. Or, si ces chiffres sont gonflés, ça envoie le message que tout va bien et que, au bout du compte, on n'a pas vraiment besoin d'inverser la tendance.
J'aimerais dire deux choses à ce sujet. La justification du nombre vient de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui porte sur l'éducation primaire et secondaire. Ça n'a aucune incidence sur l'éducation postsecondaire, de prime abord. Si on regarde…
D'accord.
Si on considère le nombre d'ayants droit dans chaque province, on se rend compte que les établissements de la minorité ont en fait accès à un bassin beaucoup plus large que celui qu'elles découvrent actuellement. Le nombre le justifie déjà et le défi n'est donc pas là.
Le défi actuel de nos établissements est de pouvoir concurrencer les établissements de la majorité, notamment dans des situations où — pour ne citer que le cas de l'Ontario — les droits de scolarité ont été réduits et gelés depuis 2019. Le résultat en est que certains établissements étouffent.
Pour rester à flot, les établissements de la majorité se sont tournés vers les étudiants étrangers. Cependant, la concurrence est déloyale, notamment parce que le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration refuse massivement les étudiants francophones en provenance de l'Afrique. Vous l'avez déjà entendu, je répète des choses que vous savez déjà. Par conséquent, les établissements francophones en situation minoritaire n'ont malheureusement pas accès actuellement à la même bouée de sauvetage que les établissements de la majorité.
Vous avez aussi parlé de la débâcle de l'Université Laurentienne, qui a révélé la faiblesse des établissements bilingues et le fait que le gouvernement n'agit pas vraiment dans l'intérêt des communautés linguistiques minoritaires.
Vous avez aussi parlé de Sudbury, mais, en ce qui concerne les universités « par et pour » les francophones hors Québec, les choses ne semblent pas aller dans la bonne direction non plus. Pour ce qui est de l'Université d'Ottawa, on a parlé d'une entente qu'elle a passée. Qu'en pensez-vous
Si on veut parler du « par et pour », l'Université Laurentienne ne répond pas à cette définition étant donné que c'était un établissement bilingue.
Lorsqu'elle a pris la décision de réduire le nombre de ses programmes en raison d'un réel problème financier, elle n'a pas tenté de faire la part des choses et de sauvegarder des programmes francophones. Ces programmes avaient de plus petits effectifs, puisqu'il s'agit d'une communauté linguistique en situation minoritaire, mais ils étaient fondamentaux à la survie de la communauté.
L'Université Laurentienne a décidé d'éliminer des programmes sans discernement, avec pour résultat le fait qu'une centaine de professeurs francophones ont été mis à la porte et que quelque trente programmes francophones ont été éliminés, les deux tiers des programmes de l'Université, si je ne me trompe pas.
Merci, Mme Chouinard.
Madame Ashton, du NPD, vous avez la parole pour six minutes, ce qui devrait nous mener à environ cinq minutes avant la tenue du vote à la Chambre des communes.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Je souhaite la bienvenue à nos témoins.
Monsieur Zundel, je commence en disant que vous êtes le seul représentant d'un collège à témoigner dans le cadre de notre étude sur le financement du postsecondaire. Votre perspective est donc très importante.
Au cours des réunions précédentes du Comité, les représentants d'établissements universitaires ont souligné le fait qu'un financement stable et suffisant était essentiel à leur travail. Quelles sont les implications pour les collèges francophones de ne pas avoir accès à un financement stable?
Il est évident qu'un financement stable est important pour n'importe quel établissement postsecondaire. Chacun de ces établissements entreprend des activités à long terme qui exigent des investissements dans du personnel hautement spécialisé et des infrastructures coûteuses et compliquées. Le fait d'avoir un financement de base assuré et suffisant est donc essentiel. C'est clair pour tout le monde.
Les universités, qui ont un plus grand nombre d'employés permanents, dépendent davantage d'un financement de base assuré, mais il n'en demeure pas moins que ce financement est important pour tout le monde.
D'accord, merci.
Je reviens à la question de l'importance de l'accueil des étudiants étrangers et du rôle du fédéral. Étant donné que 28 % des étudiants de votre collège sont des étudiants étrangers, quelles répercussions les nouvelles règles d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada concernant les étudiants étrangers auront-elles sur votre collège et les communautés de votre région?
Il est important de savoir que, pour des raisons démographiques, 40 % des postes à pourvoir au Nouveau‑Brunswick dans les 10 prochaines années devront être pourvus par des immigrants. Or, le programme des étudiants étrangers est le moyen le mieux adapté pour attirer ces immigrants. Tout changement limitant le nombre d'étudiants étrangers aura un effet direct sur nos communautés. Ce sont ces diplômés qui pourvoiront un jour les postes dans les salles d'urgence et les chantiers de construction. Ils sont vraiment essentiels, et il est difficile d'imaginer comment on va atteindre les nouvelles cibles d'immigration et répondre aux besoins du marché du travail sans pouvoir augmenter le nombre d'étudiants étrangers.
Au Comité, nous parlons beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre en éducation, y compris en éducation à la petite enfance. C'est une réalité que les communautés francophones et bilingues connaissent bien ici, dans l'Ouest canadien. Or, nous savons que votre collège offre un programme de formation en éducation à l'enfance, ce qui est très important.
Pourriez-vous nous parler un peu de l'importance de ce programme? De plus, dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, à quel point est-il important que le fédéral soutienne les programmes de formation en éducation, en particulier en éducation à la petite enfance?
Premièrement, la petite enfance est la période pendant laquelle le développement langagier se fait au maximum. Dans le cycle de l'éducation, plus on commence tôt, plus la capacité d'apprendre en français est importante.
Deuxièmement, les programmes que nous offrons ont été appuyés par des fonds fédéraux de deux façons. D'une part, nous avons reçu de l'aide directe aux programmes de formation en éducation à la petite enfance. D'autre part, nous avons reçu des investissements qui nous ont permis de passer à la formation axée sur les compétences, comme je l'ai dit tantôt. C'est ce genre de formation qui nous permet d'accélérer le perfectionnement des éducateurs et des éducatrices à la petite enfance.
Donc, sans l'appui du fédéral, nous aurions peiné à développer nos nouveaux programmes et à en offrir en aussi grand nombre.
J'imagine que l'importance de vos programmes de formation, notamment celui pour la petite enfance, accentue le besoin d'avoir un financement stable et à long terme.
Absolument, et il doit aussi être prévisible. Pour embaucher du personnel d'enseignement pour ces programmes, nous devons être capables de les convaincre de venir travailler chez nous en leur garantissant un emploi pour plusieurs années. Ce faisant, nous sommes capables d'embaucher les gens dont nous avons besoin et de les retenir.
Je pourrais finir de répondre rapidement à la question de M. Beaulieu au sujet du « par et pour ».
L'Université Laurentienne ne répond pas nécessairement à la définition d'un établissement « par et pour » les francophones, mais, dans le cadre des indicateurs qu'il va falloir établir pour déterminer si un établissement est fort ou non, c'est le genre de question qu'on devra se poser.
Merci.
Monsieur Zundel et madame Chouinard, excusez-nous, mais les aléas de la vie sur la Colline du Parlement font qu'un vote a préséance sur toute autre activité, y compris une réunion du Comité. Par ailleurs, des motions sont parfois déposées dans les règles de l'art, ce qui est arrivé aujourd'hui.
Si je ne m'abuse, mis à part les représentants gouvernementaux, vous êtes les derniers témoins invités dans le cadre de cette étude. Puisque nous n'avons pas eu le temps de faire un deuxième tour de questions, je vous invite à écrire à la greffière du Comité si vous tenez à nous communiquer de l'information supplémentaire. Vos témoignages feront partie intégrante de ce dont nous avons besoin pour rédiger notre rapport.
Merci beaucoup et, encore une fois, je suis désolé de ce contretemps.
Nous suspendons la séance le temps d'aller voter. Ensuite, nous reviendrons nous entretenir avec les témoins invités pour la deuxième heure de la réunion.
La séance est suspendue.
Nous reprenons la séance.
Cette partie de la réunion a été écourtée en raison des votes tenus à la Chambre. Je souhaite la bienvenue à nos invités et je suis désolé du retard. Ce sont les aléas de la vie sur la Colline du Parlement. Nous accueillons M. Frédéric Lacroix, chercheur indépendant, et M. Nicolas Bourdon, représentant du Regroupement pour le cégep français.
Voici quelques petites consignes. Je demande à chaque personne, qu'elle soit dans la salle ou qu'elle participe à la réunion par vidéoconférence, de ne pas allumer son microphone tant que je ne l'aurai pas nommée. Sinon, ça provoque un retour de son qui risque de causer des blessures à nos interprètes. Je demande donc à chacun et à chacune d'entre vous d'attendre que je les nomme avant de prendre la parole.
Messieurs Lacroix et Bourdon, vous aurez chacun un maximum de cinq minutes pour faire votre allocution d'ouverture. Par la suite, toutes les formations politiques vont avoir l'occasion de vous poser des questions. Je précise que je suis très sévère pour ce qui est du temps de parole, pas pour être méchant, mais pour que tout le monde puisse profiter de son temps de parole pour poser des questions.
Monsieur Lacroix, la parole est à vous pour cinq minutes maximum.
Je vous ai envoyé ma présentation PowerPoint, mais on m'a dit que je ne pouvais pas vous la communiquer, malheureusement. J'espère quand même que vous pourrez me suivre.
Mon nom est Frédéric Lacroix, et je suis l'auteur du livre Pourquoi la loi 101 est un échec. Dans ce livre, j'ai étudié, entre autres, la question du surfinancement fédéral des universités de langue anglaise au Québec, qui est selon moi une cause directe du recul du français au Québec.
Le recul du français au Québec est selon moi un fait qu'il est maintenant impossible de nier. Les données de Statistique Canada indiquent que, depuis 1991, il y a eu au Québec un recul de 3,9 % de la population dont la langue le plus souvent parlée à la maison est le français, tandis que la situation s'est inversée pour l'anglais. Après avoir reculé pendant plusieurs décennies, l'anglais est en croissance au Québec. Depuis 2001, il a gagné 0,5 %. Cette statistique est en lien avec la langue parlée à la maison, mais c'est vrai aussi pour la langue de travail. L'anglais est en croissance et le français est en décroissance au Québec; c'est vrai pour tous les indicateurs linguistiques.
Pour ce qui est du recul du français, plusieurs mécanismes sont en œuvre. Selon moi, un de ces mécanismes est le surfinancement du réseau universitaire de langue anglaise au Québec, ce qui pousse des francophones et des allophones à étudier en anglais. Ces études postsecondaires en anglais provoquent une anglicisation et influencent profondément la langue de travail et l'univers culturel de ces personnes, ce qui cause le recul du français. Ce n'est pas la seule cause du recul du français, mais c'est l'une d'entre elles.
Dans mon livre, j'ai étudié la notion de complétude institutionnelle, un concept théorisé par le sociologue Raymond Breton en 1964. Il postule que le fait de détenir des établissements, par exemple des universités, est une condition qui contribue à l'épanouissement des minorités. Les francophones sont une minorité au Canada, incluant au Québec. La complétude institutionnelle est une notion qui a réussi avec succès le test des tribunaux canadiens, et Mme Chouinard en a probablement parlé.
Statistique Canada a prouvé que, si la langue d'enseignement à l'université au Québec est l'anglais, cela avait un effet très prononcé sur le fait de travailler en anglais et multipliait par 6,6 la probabilité qu'un allophone travaille en anglais. En 2023, l'Office québécois de la langue française a fait des études qui prouvent que le fait d'étudier en anglais à l'université augmente de façon très importante l'utilisation de l'anglais comme langue de travail.
J'ai étudié le financement des universités du Québec en me servant de données colligées par Statistique Canada. Cet organisme compile les revenus et les dépenses de toutes les universités du Canada, par province et par source. Grâce à ses fichiers, on peut donc calculer la proportion du financement fédéral octroyé à chaque université. J'ai fait cette étude pour les années 2000, 2010, 2014 et 2017, et je suis arrivé à la conclusion que, pour ces années-là, la part du financement fédéral pour les universités anglaises, c'est-à-dire McGill, Concordia et Bishop's, oscillait entre 34,6 et 38,4 %, sur 17 ans.
Pour ce qui est des universités de langue française, la proportion du financement fédéral était environ de 65 %, mais a diminué jusqu'à 61,6 % en 2017. Je rappelle qu'au Québec, les francophones constituent à peu près 80 % de la population, et reçoivent donc nettement moins que leur poids démographique en financement fédéral, tandis que les anglophones reçoivent à peu près quatre fois leur poids démographique.
Si on revient à la notion de complétude institutionnelle, on se rend compte que les anglophones ont une « surcomplétude » institutionnelle, c'est-à-dire que leurs institutions sont dimensionnées de façon beaucoup plus importante que la taille de leur communauté. Cette situation crée des places pour les étudiants et un prestige supérieur du côté anglophone, ce qui pousse les gens à s'inscrire à ses universités. Ainsi, en 2019, les universités anglaises du Québec accueillaient 25,9 % des effectifs universitaires, soit trois fois le poids démographique de la communauté anglophone. Plus d'un étudiant universitaire sur quatre au Québec est inscrit à des études en anglais, malgré le fait que la communauté anglophone correspond à peu près à seulement 10 % de la population. Ce surfinancement fédéral est un facteur direct d'anglicisation et du recul du français au Québec.
Merci, monsieur Lacroix. Votre temps de parole a été de quatre minutes et quarante secondes. Vous avez donc respecté le temps alloué.
Monsieur Bourdon, je vous cède la parole pour cinq minutes.
Je m'appelle Nicolas Bourdon et je suis professeur au cégep, au Collège de Bois‑de‑Boulogne. J'espère arriver aussi bien que M. Lacroix à respecter le temps qui m'est imparti.
Comme vous l'avez entendu, notamment de la part de M. Lacroix, le français est fragile, non seulement dans le reste du Canada, mais aussi au Québec. Le phénomène s'observe aussi dans les cégeps. Trouvant la situation très inquiétante, des professeurs de cégep se sont regroupés et ont dressé cinq constats, qu'ils considèrent comme accablants et qui les ont amenés à militer pour faire appliquer la loi 101 au cégep. Ces cinq constats se retrouvent dans ma présentation PowerPoint, que devrait vous avoir transmise la greffière.
Le premier constat est que le financement du réseau des cégeps anglais n'est pas proportionnel au poids démographique de la communauté anglophone. Alors que la population anglophone représente environ 8 % au Québec, les cégeps anglais accueillent 17,5 % des effectifs étudiants, soit un peu plus du double. On parle ici encore une fois de « surcomplétude » institutionnelle, mais au niveau collégial.
Le deuxième constat est que les cégeps anglais, qui ont été conçus principalement pour la communauté anglophone — ce qui est très correct et ne me pose aucun problème — sont maintenant principalement fréquentés par des étudiants non anglophones, c'est-à-dire des francophones et des allophones. En effet, les deux tiers des effectifs étudiants des cégeps anglais sont maintenant des francophones et des allophones.
Le troisième constat est qu'il existe une concurrence malsaine entre les cégeps français et anglais. Cette concurrence avantage les cégeps anglais et entraîne, selon les observations des professeurs, une anglicisation des cégeps francophones. En effet, pour contrer cette concurrence des cégeps anglais, les cégeps français ont dû élaborer des programmes en anglais et des diplômes d'études collégiales bilingues. Notre regroupement a voulu envoyer le signal qu'il est temps de mettre un frein à ça, parce que les cégeps français étaient eux-mêmes en train de s'angliciser.
Le quatrième constat est que les cégeps anglais sont devenus des cégeps d'élite, choisis par les étudiants qui ont la cote R la plus forte. Cette cote permet de situer le niveau de l'étudiant par rapport à sa moyenne générale. Les cégeps anglais attirent les étudiants les plus forts. Pour vous donner un exemple frappant, le Collège Dawson, à Montréal, accepte seulement 30 % des demandes d'admission qu'il reçoit pour le programme de sciences de la nature. Il peut ainsi se permettre d'aller chercher les étudiants les plus forts.
Le cinquième constat, qui n'est pas le moindre, est que le réseau des cégeps anglais contribue de façon notable à l'anglicisation de la population du Québec en général, et en particulier sur l'île de Montréal. Comme vous l'a dit M. Lacroix, le fait de fréquenter une université anglaise mène à une carrière en anglais, mais c'est aussi vrai pour le cégep. En lisant des études sur ce sujet, on s'aperçoit que, lorsqu'on fréquente un cégep anglais, on poursuit ses études universitaires et sa carrière en anglais. Il existe donc une forte corrélation entre le cégep anglais et le fait de mener sa vie en anglais. A contrario, le fait de fréquenter un cégep français mène vers un cheminement beaucoup plus francophone. En effet, les étudiants fréquentant un cégep français choisissent généralement une université française et s'orientent vers le marché du travail en français.
J'espère que je n'ai pas pris trop de temps.
Non, votre allocution a été plus courte que celle de M. Lacroix: elle a duré quatre minutes et douze secondes. C'est de bon augure. Nous pourrons mener un tour de questions complet.
Je sais que M. Lacroix a déjà comparu devant notre comité, mais je crois que c'est la première fois pour vous, monsieur Bourdon. Je vais donc vous donner de courtes explications. Les premiers tours de questions et réponses durent six minutes pour chacune des quatre formations politiques. Aujourd'hui, nous commencerons par les conservateurs.
Monsieur Généreux, vous avez la parole pour six minutes.
Merci, monsieur le président.
Messieurs Lacroix et Bourdon, je vous remercie de votre présence aujourd'hui.
C'est presque une question existentielle que vous soulevez aujourd'hui. Je suis marié depuis 35 ans à une anglophone originaire de Montréal. Je l'ai exportée de Montréal pour l'importer dans le Bas‑Saint‑Laurent, ce qui fait que mes enfants sont bilingues, tout comme mes petits-enfants, qui ont moins de 10 ans. J'en suis extrêmement fier. Mes parents et mes sept frères et sœurs sont tous bilingues. Nous voyageons partout dans le monde, et jamais nos racines francophones n'ont été compromises par le fait que nous parlons anglais. Je veux m'assurer de mettre ça au clair.
Mon adjoint, qui est ici derrière moi, parle quatre langues: le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. La jeunesse d'aujourd'hui a une grande ouverture d'esprit et une propension à aller vers d'autres langues. Même si le français est une langue très importante dans le monde, particulièrement en Afrique et en Europe, les technologies d'aujourd'hui incitent les jeunes à avoir un certain niveau de connaissances générales. Ils sont beaucoup influencés par les réseaux sociaux, qui vont au-delà des frontières québécoises et canadiennes.
Si je dis tout ça, c'est parce que M. Lacroix a dit que les francophones étaient une minorité au Québec.
Vous ai-je bien compris, monsieur Lacroix?
Les francophones sont une minorité au Canada. Moi, je réfute le cadre de la Loi sur les langues officielles, qui postule que les anglophones sont une minorité. Selon moi, les anglophones ne sont une minorité nulle part au Canada. Voilà ce que j'ai dit. Les francophones sont une minorité partout au Canada.
D'après les chiffres assez importants que vous nous avez donnés, le français recule au Québec. Peut-on dire que ce recul est aussi attribuable à l'arrivée massive d'immigrants dans les dernières années, particulièrement dans la région de Montréal?
Je viens de La Pocatière, dans le Bas‑Saint‑Laurent, où nous aimerions bien voir notre population augmenter et non baisser comme c'est le cas actuellement. D'ailleurs, nous perdons des circonscriptions, ce dont mon collègue M. Beaulieu se réjouit. On va ajouter une nouvelle circonscription au nord de Montréal et en enlever une dans le Bas‑Saint‑Laurent, pour corriger les inégalités de représentation.
Inévitablement, le fait que les immigrants ne viennent pas dans nos régions a des conséquences. On aurait probablement plus de facilité à les franciser dans nos cégeps régionaux, que je connais bien, car ils ne sont pas très anglicisés, contrairement aux cégeps de Montréal, dont a beaucoup parlé M. Bourdon. Celui de Sherbrooke l'est peut-être un peu, mais pas ceux dans le Bas‑Saint‑Laurent et dans le Nord du Québec.
J'ai soulevé plusieurs éléments, alors je vais vous laisser répondre.
Je n'ai pas entendu de question précise, mais ce que je dis, c'est que le dispositif institutionnel de langue anglaise au Québec mène à un recul du français. Pour les partisans du bilinguisme, je souligne que ça mène à une diminution du bilinguisme, parce que les gens finissent par ne plus parler français et par transmettre l'anglais comme langue maternelle à leurs enfants.
Ce n'est pas une dynamique d'ouverture sur le monde où on veut parler toutes sortes de langues et les collectionner. C'est plutôt une dynamique de bilinguisme soustractif. La langue qui est en train d'être soustraite à Montréal, c'est le français. Le nombre d'indicateurs qui pointent dans cette direction est très grand. Cela n'a pas seulement lieu sur l'île de Montréal, mais dans toute la région de Montréal.
Je crois que le surfinancement accordé par le gouvernement fédéral aux universités McGill, Concordia et Bishop's contribue au recul du français au Québec et à l'avancée de l'anglais. Voilà mon argument.
Je dirais un peu la même chose que M. Lacroix, mais j'aimerais apporter une clarification sur les cégeps, puisque vous avez fait un commentaire sur la situation.
Il y a un danger pour une langue comme le français lorsqu'une autre langue, en l'occurrence l'anglais, est jugée comme étant supérieure et plus attractive. Ce phénomène se reflète dans le comportement de nos cégépiens, qui voient l'anglais comme étant la langue qu'il faut maîtriser, ce qui pose problème. Notre regroupement est allé dans plusieurs cégeps et nous avons réussi, en assemblée syndicale, à faire voter 41 cégeps en faveur de l'application de la loi 101 au collégial, pour renverser ce phénomène problématique où l'anglais devient la langue la plus attractive.
D'accord.
Québec a récemment apporté des changements en ce qui concerne l'enseignement supérieur, qui équivalent à un « définancement », pour ainsi dire, de certaines universités anglophones. Ces changements vous ont-ils rassuré, d'une certaine manière?
C'est une excellente question, monsieur Généreux, mais votre temps de parole est écoulé. Vous aurez l'occasion d'y revenir.
Monsieur Drouin, du Parti libéral du Canada, vous avez la parole pour six minutes.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Messieurs Lacroix et Bourdon, vous avez fait des études sur les effets de l'anglais ou d'autres langues sur les communautés internationales, par exemple en France et en Belgique, plus précisément dans la Fédération Wallonie‑Bruxelles. Vous tenez des propos pas mal extrémistes, si je puis dire.
Pour ma part, je viens d'une communauté francophone de l'Ontario. Avez-vous fait des études sur les phénomènes observés dans d'autres communautés francophones en Afrique ou en Europe pour appuyer ce que vous dites? Vous n'avez qu'à répondre par oui ou non, tout simplement.
Monsieur Lacroix, si vous voulez me niaiser, je n'ai pas de patience pour ça.
Avez-vous fait des études sur l'influence de la francophonie à l'échelle internationale, oui ou non?
Oui, monsieur le président. Monter le ton et crier après un témoin, c'est inacceptable. Il l'a traité d'extrémiste.
Monsieur Drouin, on pourrait vous traiter d'extrémiste. Ce n'est pas un langage qui contribue à une discussion logique et rationnelle.
Monsieur Beaulieu, je vous remercie de votre intervention.
Monsieur Drouin, calmons le jeu un peu. Quand vous avez dit « extrémiste », j'ai compris que vous parliez de la position et non de la personne, mais vous pourriez reformuler ces propos. J'ai arrêté le chronomètre à une minute treize secondes, parce qu'il y avait un rappel au Règlement. Je vous laisse continuer.
Merci, monsieur le président.
Je n'accuse personne d'avoir une telle position, j'essaie tout simplement de comprendre la réalité. Je suis président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie et j'ai des discussions avec mes collègues d'Afrique et de France. Le problème de l'anglicisation est réel en France, même si c'est un pays libre et indépendant. La France est confrontée aux mêmes problèmes que nous. J'essaie simplement d'avoir une conversation intelligente sur la protection de la langue française.
Mes collègues pensent-ils vraiment que le problème de l'anglicisation au Québec est principalement attribuable à l'Université McGill et au Collège Dawson? C'est à cette idée que j'essaie de m'attaquer. Va-t-on s'en tenir à cette notion ou s'attaquer au vrai problème?
Permettez-moi de revenir dans le domaine de la rationalité pour répondre à cette question.
Je me suis intéressé à la situation du Québec. Statistique Canada, un organisme probablement extrémiste à vos yeux, a prouvé que les établissements bilingues avaient une très forte incidence sur l'anglicisation des francophones et des allophones au Québec. L'Office québécois de la langue française a également fait des études qui ont corroboré ce fait. Alors, toutes les données convergent vers cette conclusion.
Je ne suis au courant d'aucun État ou province dans le monde qui se trouve dans la situation du Québec. Il faut savoir qu'en Flandre, par exemple, les universités de langue française ont été fermées dans les années 1960, et les universités flamandes en Wallonie. En Suisse, on voit la même situation: c'est le bilinguisme territorial qui est appliqué.
Je pense donc que le Québec est dans une situation anormale comparativement aux autres États sur la planète. Si vous qualifiez cette position d'extrémiste, en fait, vous êtes en train de qualifier la Belgique et la Flandre d'États extrémistes.
Non. En principe, monsieur Lacroix, je suis en train de vous dire que, si vous pensez que l'Université McGill ou le Collège Dawson, à Montréal, anglicisent le Québec au complet parce qu'on y enseigne en anglais, vous êtes dans les patates, et pas à peu près.
Je suis Franco‑Ontarien même s'il y a plein d'universités anglophones en Ontario. Je trouve que ce discours est insultant et qu'il démontre un manque de respect intellectuel à l'égard de ce qui se passe réellement à l'échelle internationale. Nous sommes 321 millions de locuteurs francophones.
Quand vous dites que les universités anglophones sont en train d'angliciser Montréal, un discours que j'entends depuis 40 ans, excusez-moi, mais je trouve que vous êtes plein de marde. Je retire mes propos, mais vous êtes dans le champ. Il faut avoir un discours respectueux des faits.
Monsieur le président, voulez-vous me couper la parole?
Je ne vous coupe pas la parole. J'allais vous dire que ce n'était pas du langage parlementaire, mais vous vous êtes repris avant que je le dise.
Vous pouvez poursuivre. Il vous reste 20…
J'arrête le chronomètre. Pour donner suite aux dernières consignes que nous avons reçues, je rappelle aussi à tout le monde qu'il ne faut allumer qu'un seul microphone à la fois. Il n'arrive pas souvent que ça chauffe comme ça au Comité permanent des langues officielles.
Vous avez la parole, monsieur Beaulieu.
C'est de l'intimidation à l'égard des témoins et je trouve que c'est totalement inacceptable.
C'est comme si, selon M. Drouin, il est correct que les universités francophones hors Québec soient sous-financées et que les universités anglophones au Québec soient surfinancées. Or, M. Lacroix a dû nuancer plus tôt en disant que ce n'était qu'un des facteurs…
J'ai invoqué le Règlement, parce que je trouve qu'en montant le ton et en traitant les invités de « plein de marde », M. Drouin est vraiment en train de faire du Quebec bashing. C'est exactement ce qu'on voit souvent chez les libéraux, qui disent qu'on agresse ou qu'on est extrémiste dès qu'on veut un financement équitable.
Nous ne demandons pas d'enlever le financement des universités anglophones, mais d'être équitable dans le financement des universités anglophones et francophones.
Monsieur Beaulieu, je retiens votre recours au Règlement.
Juste avant que je me prononce, monsieur Godin, vouliez-vous intervenir sur ce point, précisément?
Absolument, monsieur le président.
Je pense que le Comité permanent des langues officielles ne peut pas accepter ce genre de discours envers les témoins. Il faut respecter les témoins. Si nous ne partageons pas leur opinion, nous en avons le droit, puisque nous ne sommes pas à la pensée unique ici.
Nous siégeons au Comité permanent des langues officielles et deux témoins sont venus ici pour comparaître devant nous. Je pense que M. Drouin doit retirer ses paroles et s'excuser.
C'est déjà fait, mais je retiens absolument ces deux interventions.
Monsieur Beaulieu, vous avez tout à fait raison d'avoir soulevé ce recours au Règlement.
Monsieur Drouin, vous avez retiré vos paroles. Je ne suis pas habitué à vous entendre parler sur ce ton, mais je vous laisse continuer. Il vous reste 1 minute 15 secondes de temps de parole.
Je rappelle que j'étais l'ardent défenseur ontarien de la Charte de la langue française au Québec.
Monsieur Beaulieu, je salue vos commentaires. Je suis très respectueux du Québec, j'y ai de la famille. Je respecte le fait français. Je respecte aussi le fait qu'on vit dans une minorité francophone partout au Canada et en Amérique du Nord. D'un autre côté, je ne suis pas prêt à entendre des discours qui ne mènent à rien. C'est ça qui me pose problème. Le fait qu'on ait des universités anglophones à Montréal et que, parce qu'on a des universités anglophones, on dise que toute l'anglicisation vient d'une université, c'est un faux débat.
Il faut voir la réalité des choses, il faut avoir un débat qui est vrai, et le vrai débat, c'est que nos jeunes utilisent maintenant des plateformes virtuelles, auxquelles ne s'appliquent ni le projet de loi no 96 du Québec, ni le projet de loi C‑13 du Canada.
Monsieur Lacroix, comme universitaire, et monsieur Bourdon, comme représentant d'un établissement postsecondaire, que faites-vous pour favoriser l'apprentissage du français sur ces plateformes virtuelles? C'est ça, mon débat.
C'est une excellente question, monsieur Drouin, mais votre temps de parole est écoulé.
Nous allons passer au troisième intervenant, le deuxième vice-président du Comité, du Bloc québécois.
Monsieur Beaulieu, vous avez la parole pour six minutes.
Merci, monsieur le président.
Ce que nous avons entendu de la part de M. Drouin, nous l'entendons normalement de M. Rodriguez ou d'autres députés libéraux. Quand nous demandons d'avoir un financement équitable ou de reconnaître que les francophones sont minoritaires partout au Canada, y compris au Québec, on nous dit que nous agressons les anglophones. Or, nous n'agressons pas les anglophones. Comme M. Lacroix l'a dit dès le départ…
J'invoque le Règlement, monsieur le président.
Je voudrais tout simplement indiquer au Comité permanent des langues officielles que le Bloc québécois n'a jamais défendu les francophones en situation minoritaire. Je sais que ce n'est pas vraiment un recours au Règlement, mais…
Attendez un instant, messieurs. Ça fait huit ou neuf ans que je siège au Comité permanent des langues officielles et je n'ai jamais vu une telle situation. Adoptons une démarche un peu plus civilisée. Nous sommes tout de même des représentants de nos circonscriptions, de notre coin de pays, et aussi du pays.
Monsieur Beaulieu, j'ai arrêté le chronomètre.
Le recours au Règlement de M. Drouin n'en est pas un.
Monsieur Godin, invoquez-vous aussi le Règlement?
Monsieur le président, j'interviens parce qu'un des témoins avait activé la fonction « Lever la main ». A-t-il le droit de parole ou non? Si oui, cédez-lui la parole. Sinon, demandez-lui de désactiver la fonction « Lever la main ».
D'accord.
Monsieur Bourdon, pourriez-vous désactiver la fonction « Lever la main »? Lorsque des questions vous seront adressées, à l'un ou à l'autre, vous pourrez y répondre ou non, à moins d'avis contraire.
Monsieur Beaulieu, je repars le chronomètre. Seulement 24 secondes de votre temps de parole sont écoulées et vous avez de nouveau la parole.
Merci, monsieur le président.
Monsieur Bourdon, je vais vous laisser l'occasion de finir votre commentaire.
Merci, monsieur Beaulieu. J'aimerais apporter certaines précisions pour faire suite aux commentaires de M. Drouin.
En 2022, Statistique Canada a réalisé une étude sur le Québec, dont les résultats sont très clairs: la fréquentation d'un établissement anglophone multiplie par 12 les probabilités qu'un diplômé travaille en anglais. On voit que la corrélation est très forte.
Je veux aussi répondre à l'affirmation de M. Drouin selon laquelle nous tenons un discours extrémiste. Malheureusement, cette affirmation m'a surpris de manière assez négative.
Je veux rappeler des faits très simples. Au Québec, l'anglais est enseigné comme langue seconde dans tous les établissements francophones à partir de la première année du primaire jusqu'à la fin des études au cégep. Des milliers d'heures de cours d'anglais langue seconde se donnent donc déjà dans les établissements francophones. Il est donc faux de dire que nous tenons un discours extrémiste.
Je tiens aussi à rappeler au Comité des arguments historiques au sujet des partisans de la loi 101. Quand a eu lieu le débat, en 1976, qui a mené à l'adoption de la Charte de la langue française, on traitait d'extrémistes, voire de fascistes, les partisans de cette loi. On s'est rendu compte, après son entrée en vigueur, que les allophones et les francophones devaient fréquenter le primaire et le secondaire en français. On a alors dit que les Québécois ne seraient plus bilingues et qu'on assisterait à une chute du bilinguisme étonnante, ce qui serait affreux. Pourtant, malgré tout, le bilinguisme a progressé au Québec.
Le fait de traiter d'extrémistes les gens qui voulaient renforcer les établissements francophones au Québec au moyen de la loi 101 était faux. C'était un discours monté en épingle.
Monsieur Lacroix, si j'ai bien compris, les seules études dont j'ai pris connaissance sur le financement des universités francophones comparativement aux universités anglophones à l'extérieur du Québec indiquent que les universités francophones sont en général sous-financées par rapport à leur poids démographique.
Si on qualifie d'extrémisme le fait de vouloir un financement équitable pour les établissements francophones, ce serait perçu par le Canada anglais comme étant très extrémiste. Avez-vous des commentaires à ce sujet?
J'ai mené cette étude il y a longtemps, et les chiffres ne sont pas à jour, malheureusement.
Ce qu'on observe, c'est que les établissements d'enseignement postsecondaire de langue française sont largement sous-financés partout au Canada. À l'extérieur du Québec, la situation est particulièrement grave. En Ontario, on parle de fractions, de petits pourcentages. Le financement se situe bien en deçà du poids démographique des francophones en Ontario, dont le taux d'assimilation est d'ailleurs maintenant supérieur à 45 %.
La corrélation entre le sous-financement des établissements d'enseignement et le taux d'assimilation est évidente, et elle tient partout au Canada, y compris au Québec. Il faut savoir que, au Québec, les francophones sont en train de se faire assimiler. Sur l'île de Montréal, 4,6 % des francophones sont passés du français comme langue maternelle à l'anglais comme langue parlée le plus souvent à la maison.
C'est le même processus qui est en cours dans la francophonie partout au Canada. Il est simplement plus avancé en Ontario qu'au Québec. Une des composantes importantes de ce processus est le sous-financement des établissements d'enseignement de langue française.
Ottawa n'est pas le seul responsable de ce sous-financement. Il y a un ensemble de facteurs en jeu, mais Ottawa est une composante à cause des sommes importantes que le gouvernement fédéral investit en recherche au Québec: on parle de centaines de millions de dollars par année. Cette incidence n'est pas négligeable.
D'accord.
Je ne sais pas si vous êtes au courant d'une étude réalisée il y a quelques années par Patrick Sabourin, de l'Institut de recherche sur le français en Amérique, qui était assez exhaustive. Elle démontrait l'incidence de la fréquentation des cégeps anglais à Montréal chez les allophones, mais aussi chez les francophones.
C'est une étude qui a été corroborée, par la suite, par l'Office québécois de la langue française. En fait, cette étude démontrait que la théorie selon laquelle les gens allaient au cégep et à l'université en anglais pour apprendre l'anglais était tout à fait fausse. Ces gens allaient au cégep et à l'université en anglais pour s'intégrer au monde anglophone, prenant donc une porte de sortie hors de la francophonie. Ce n'était pas un bain linguistique pour apprendre une langue qu'ils ne maîtrisaient pas.
Merci, messieurs Lacroix et Beaulieu.
Nous terminons par le tour de questions de six minutes de la représentante du NPD.
Madame Ashton, vous avez la parole pour six minutes.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Je souhaite la bienvenue aux témoins.
J'aimerais aussi faire part de mes préoccupations sur la façon dont mon collègue M. Drouin a posé…
Attendez un instant, madame Ashton. J'arrête le chronomètre, parce qu'il y a un recours au Règlement.
Monsieur Godin, la parole est à vous.
Excusez-moi de vous interrompre, madame Ashton.
Monsieur le président, je regarde l'horloge et il est 17 h 28. Il faudrait obtenir le consentement unanime du Comité pour prolonger la séance après 17 h 30.
Merci, monsieur Godin. Je n'avais pas vu l'heure. Le Comité devrait effectivement terminer sa réunion à 17 h 30.
Y a-t-il consentement unanime pour prolonger la réunion de quatre ou cinq minutes au maximum? La salle demeure disponible.
Des voix: D'accord.
Le président: C'est parfait.
Madame Ashton, je repars le chronomètre. Il s'est écoulé 18 secondes seulement. La parole est à vous.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Comme je l'ai dit, je veux aussi faire part de mes préoccupations sur la façon dont mon collègue M. Drouin a posé ses questions. Je pense que nous avons tous le droit de poser des questions, étant donné le sujet de cette étude et les points de vue partagés par les représentants du Québec en ce qui concerne les établissements postsecondaires francophones au Québec. Ce sont des points de vue qu'il faut entendre, même si nous sommes en désaccord.
Monsieur Bourdon, comme vous le savez, depuis un bout de temps, nous travaillons très fort sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles. Comment croyez-vous que cette modernisation aidera les communautés francophones à mettre sur pied des établissements scolaires francophones?
En ce qui concerne le Québec, je pense que M. Lacroix et moi avons le même message à transmettre. Nous disons qu'en finançant les universités et les cégeps anglais au Québec, le fédéral joue malheureusement un rôle qui va à l'encontre du français. Quand nous regardons l'étude qu'a menée Mario Beaulieu, entre autres, et que nous voyons que 95 % de l'argent dépensé au Québec par le fédéral dans le cadre de ses investissements dans la protection des langues officielles en situation minoritaire va à des projets menés par des établissements anglophones, nous constatons que cet argent renforce encore une fois ces établissements. Malheureusement, ceux-ci jouent un rôle délétère à l'égard du français au Québec. C'est ce que M. Lacroix et moi avons voulu démontrer.
Dans la perspective de la Loi fédérale, il faudrait vraiment qu'il y ait une vision asymétrique: ce n'est pas l'anglais qui a besoin d'aide, mais le français, et ce, autant hors Québec qu'au Québec. Je pense que c'est la direction que vous voulez prendre. Vous avez ce principe, mais comment appliquer cette asymétrie? Là est la question.
D'accord.
Je viens de l'Ouest canadien. Je représente une circonscription, ici, au Manitoba, qui occupe les deux tiers de la province.
Comme vous le savez, nous avons une communauté francophone très dynamique au Manitoba, mais, malgré tout cela, le français est toujours en déclin. Comment croyez-vous que nous pouvons renforcer les liens et la collaboration entre les universités francophones hors Québec et les établissements postsecondaires du Québec?
Je ne sais pas si M. Lacroix veut répondre à cette question, parce que, pour ma part, je m'intéresse beaucoup aux cégeps.
Vous pouvez tous les deux répondre à la question, tant du point de vue des cégeps que de celui des universités.
Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à cette question.
À mon avis, pour les francophones hors Québec, il faut des établissements qui offrent des programmes complets « par et pour » les francophones. Selon moi, c'est un concept important. Les établissements ne devraient pas offrir seulement des programmes d'un an, mais des programmes complets en ingénierie, en médecine ou en droit, entre autres. Il faut doter les établissements francophones de facultés lourdes qui mènent à des emplois rémunérateurs. Ça prend aussi d'autres choses.
Ce n'est peut-être pas la réponse à votre question, mais c'est un peu ce qu'il faut avoir, à mon avis.
C'est une réponse pertinente. D'autres témoins ont aussi parlé de l'importance d'offrir des programmes universitaires comme ceux que vous avez mentionnés, entre autres.
Monsieur Bourdon, avez-vous quelque chose à mentionner au sujet des cégeps?
Je dirais un peu la même chose que M. Lacroix. Ce que je vois dans le Canada hors Québec, c'est qu'on a des universités et des collèges qui n'offrent que certains programmes en français. Ce sont des établissements qui sont parfois fragiles, qui ont malheureusement été fragilisés, notamment en Ontario par des compressions budgétaires du gouvernement Ford. Hors Québec, il est donc sûr qu'il faut investir davantage. Il faut que les universités et les collèges aient le financement nécessaire pour offrir toute une gamme de programmes, y compris les plus convoités comme la médecine, l'ingénierie et le droit. C'est ce que je verrais, c'est clair.
Merci beaucoup.
Au cours de la présente étude, on a beaucoup parlé du rôle important des étudiants étrangers dans nos établissements francophones. Selon vous, comment les établissements comme les cégeps et les universités peuvent-ils s'affirmer comme chefs de file à l'échelle internationale en ce qui concerne l'éducation francophone?
Madame Ashton, je vous prie de m'excuser, mais vous avez largement dépassé votre temps. Je ne voulais pas vous interrompre et je vous ai laissé terminer votre question.
Messieurs Lacroix et Bourdon, vous n'êtes peut-être pas habitués. Même si vous avez déjà comparu, monsieur Lacroix, ce n'est pas votre cas, monsieur Bourdon. La réunion a été écourtée en raison du vote. Nous avons repris tardivement, puis il y a eu des objections, comme nous l'avons entendu et comme vous en avez été témoins. Je vous invite à nous communiquer par écrit ce que vous auriez aimé nous dire de plus. Pour nous, il est important de recevoir vos témoignages aussi bien écrits qu'oraux. Veuillez les faire parvenir à la greffière, qui retransmettra cette information à tout le monde.
J'aimerais brièvement profiter de mon privilège de président pour vous poser une question de statistique, au bénéfice du Comité. Elle s'adresse à M. Lacroix, mais peut-être que M. Bourdon peut y répondre aussi.
Vous disiez tantôt que 35 % du financement fédéral va aux établissements postsecondaires anglophones par rapport à un financement de 65 %, réduit à 61 %, aux établissements francophones. J'ai arrondi les chiffres, mais comment peut-on les décortiquer pour déterminer la partie de ce financement qui est liée aux langues officielles? Je ne vous demande pas de faire une recherche doctorale, mais, si vous avez les chiffres, quelle partie de cet argent-là est liée aux langues officielles?
D'autres parties de ce financement visent les sciences et la technologie. Si vous avez ces chiffres-là, il serait intéressant de savoir comment se répartit le financement du fédéral aux établissements postsecondaires francophones et anglophones entre les programmes de sciences et technologie, d'une part, et les programmes de langues officielles, d'autre part. Comprenez-vous le sens de ma question?
Oui, je le comprends.
Je ne pense pas que Statistique Canada fasse cette distinction dans ses chiffres. Le financement provient de la Fondation canadienne pour l'innovation et des trois fonds subventionnaires fédéraux, notamment en sciences humaines et en sciences et génie, mais je ne pense pas que les montants destinés aux langues officielles soient inscrits comme tels. Cela dit, il doit s'agir de petites sommes comparativement à ce qui provient des autres organismes.
Les montants dont parlent les témoins sont distincts de ceux provenant des programmes de langues officielles ou d'enseignement en langues officielles. Ces derniers sont en sus.
D'accord. Il faudrait que ça nous vienne des témoins, car vous n'êtes pas témoin, monsieur Beaulieu.
Messieurs les témoins, si vous avez de l'information supplémentaire à nous communiquer par écrit, je vous invite à nouveau à ne pas hésiter à le faire. Ce sera bien accueilli par le Comité.
Merci, tout le monde.
La séance est levée.
Explorateur de la publication
Explorateur de la publication

